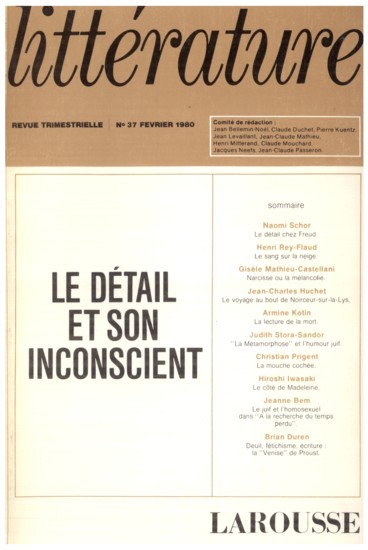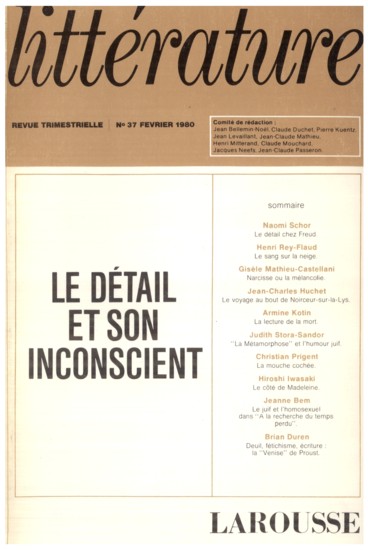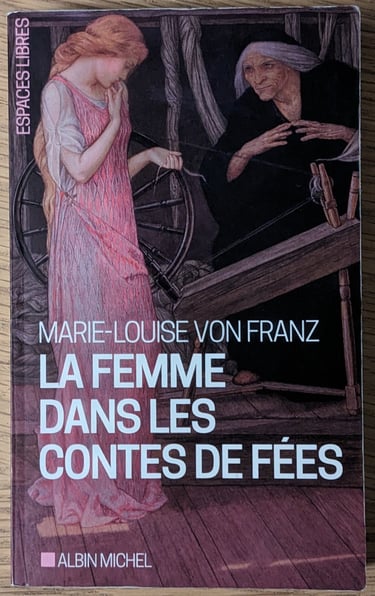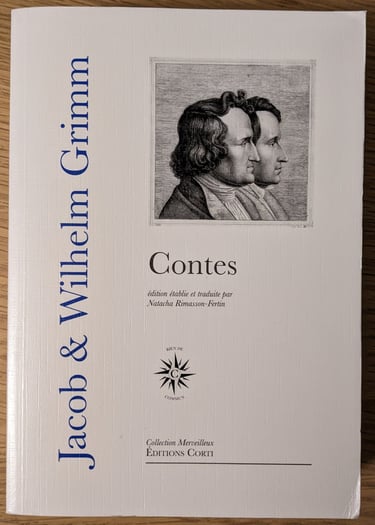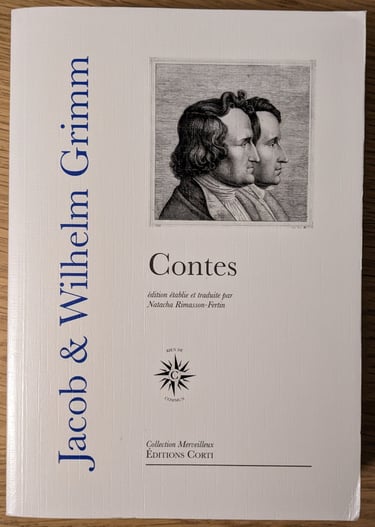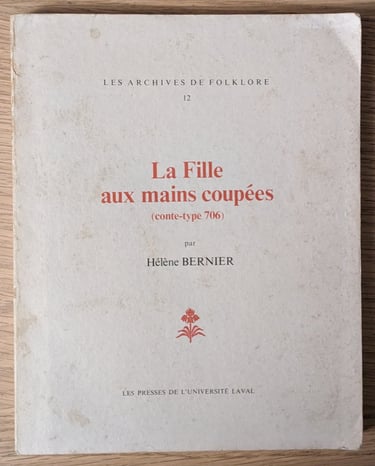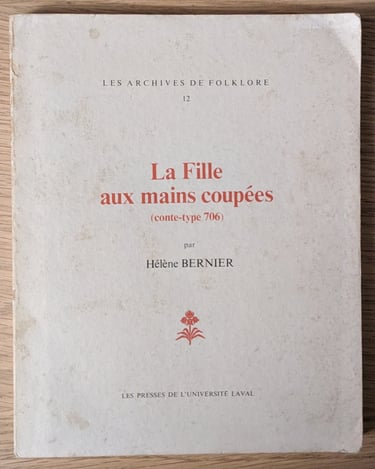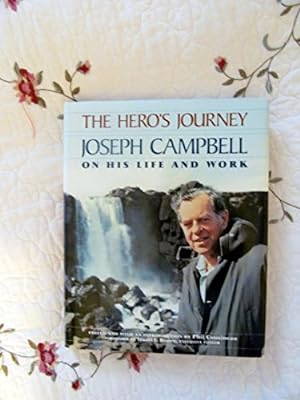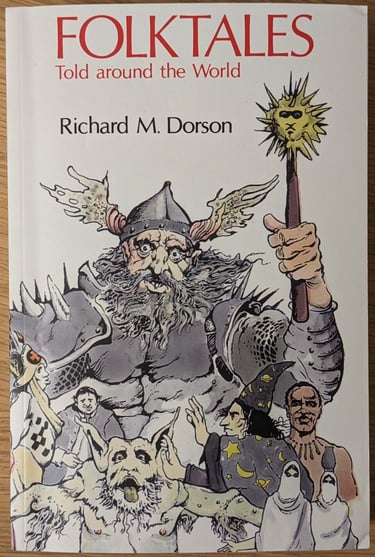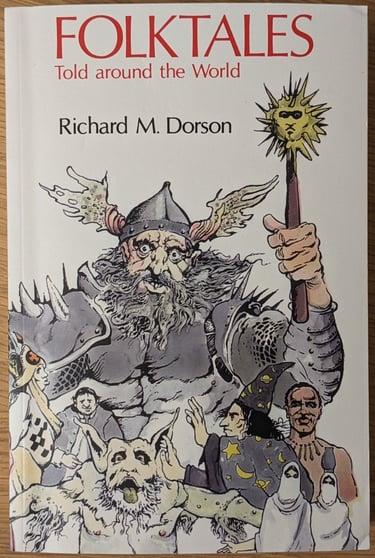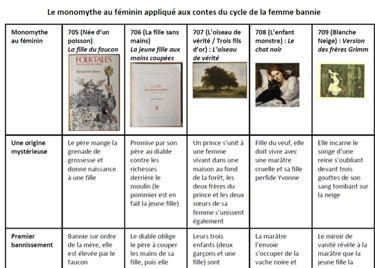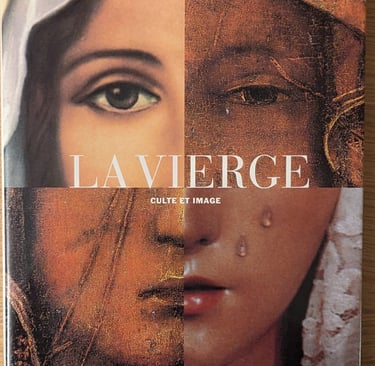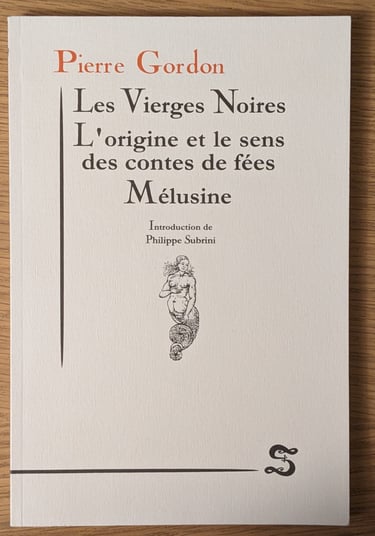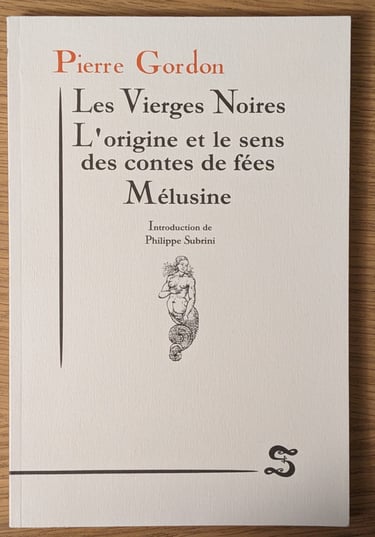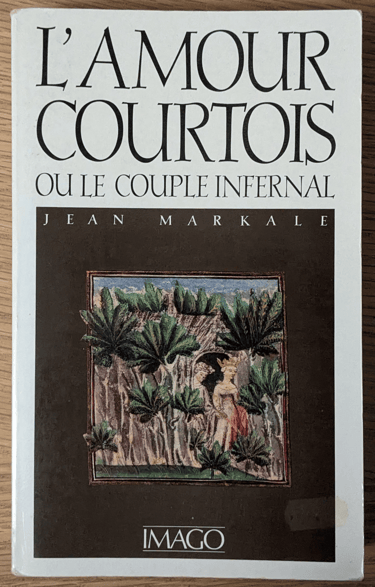6 tapisseries
L'ordre dévoilé de
La Dame à la Licorne
Contactez-moi / Livre d'or : ao.suzuki@6tapisseries.fr
Site mis à jour le 3 février

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Bienvenue
Soyez-le ou la bienvenue, entrez de votre bon gré, et laissez ici de la joie que vous y avez amenée. Avant que commence l'histoire, laissez-moi vous dire le pourquoi de ce site.
Après une année à la recherche d'un éditeur, j'ai abandonné le livre avec une couverture. C'est donc un livre en ligne. À y regarder maintenant, il y a des avantages, ce texte reste libre, rectifiable, accessible, avec la promesse de grandir encore, d'être le grand récit, en direct. J'espère alors que je garderai le soin avec lequel j'ai écrit en pensant justement qu'il n'y aurait pas de retouches possibles. En fait le temps passant j'ai abordé mon travail avec l'optique de l'éditeur, j'ai pensé à plaire. Et je pense avoir amélioré quelques formules, mais certainement la pensée s'est appauvrie. Sur cette année j'ai quand même enrichi le monomythe au féminin avec le développement des autres contes du cycle de la femme bannie. Je dois vous faire une promesse : à partir de maintenant le 16 janvier, je ne modifierai qu'un peu de forme. Ce qui viendra ira dans la rubrique À part.
Par livre en ligne s'entend habituellement ebook, mais je n'en lis presque pas. En revanche je scrolle pas mal sur mon téléphone, alors je me suis dit qu'un site serait sympa, à condition d'une interface mobile correcte. Je fais de mon mieux, ça limite l'emploi d'images, là aussi du coup il faudra une rubrique, surtout pour les détails des tapisseries ou pour l'imagier alchimique. Je fais au mieux, si vous en avez l'âme, vos conseils sont les bienvenus, vos encouragements aussi. C'est une éternité de cases à recaler, de réglages d'interlignes qui sautent à la conversion, une vraie tannée. De votre côté c'est l'occasion de tester la fonction "Ajouter à l'écran d'accueil" de votre navigateur mobile, vous aurez une belle icône de la dame et mon livre absolument à portée de main. Absolument libre, sans pubs, sans ligne de bonne conduite des réseaux, c'est mon site à moi.
Le site s'appelle 6 tapisseries, ça m'est venu dans le métro, avec un six en 6, j'espère que vous n'avez pas cherché avec six en six. Les tapisseries dites de La Dame à la Licorne sont au nombre de six et elles ont été retrouvées sans titre, sans histoire, sans notice. Je les appellerai les Tapisseries. Mettre six dans le titre, en chiffre, c'est un indice, une clé, car le symbole est la clé du mystère et les chiffres, les nombres, sont des symboles, et les tapisseries sont un mystère.
Ça aurait dû être un livre donc le style est soutenu et je vous invite à le lire dans l'ordre. Peut-être que vous sauterez des passages, que vous irez voir la fin, que vous regarderez les images. Libre à vous. C'est un livre que j'ai écrit entre deux portes, dans le métro, au café, la nuit. Peut-être aussi le lirez vous entre deux portes, un peu dans le métro bondé, encore un peu en descendant les poubelles, et ailleurs. Ces petits enclos au milieu de la tempête, sur votre téléphone, avec entre ces morceaux le temps de la pensée.
C'est gratuit, profitez-en, parlez-en, laissez une trace, déposez un caillou, envoyez moi un petit message (contact), un jour je ferais un livre d'or, mais là vous écririez chacune ou chacun en premier, sur une page blanche, lisant ce site comme s'il n'avait été écrit que pour vous.
Au sujet du pseudonyme :
- Suzuki est un nom de famille japonais courant, avec "suzu" de cloche et "ki" d'arbre. Suzuki évoque la cloche qui purifie l'air l'instant d'une prière, dans cet enclos de nature qu'est le temple shinto, un peu comme une île bleue sur des flots rouges.
- Aowashi est un prénom japonais rare, avec "ao" de bleu et "washi" d'aigle. C'est l'aigle bleu, invisible sur le fond bleu du ciel. Cet aigle matériel et invisible représente pour moi l'aigle de l'Hymne de la perle, le message adressé par ses parents célestes au prince plongé dans l'oubli, message qui lui rappelle son origine céleste et sa mission, ramener la perle.
Je vous souhaite une belle lecture.


"Entreprise folle et désespérée, que de s'écarter du chemin de sa propre vie pour chercher Dieu ! Se fût-on approprié toute la sagesse de la solitude et toute la vertu du recueillement, on manquerait à trouver Dieu.
L'homme qui cherche Dieu est bien plutôt comparable à celui qui, allant son chemin, souhaite que ce soit le bon chemin, c'est dans la force de ce vœu que s'exprime son aspiration."


Martin Buber. Je et Tu, 1923
Introduction
À Paris, au musée de Cluny, sont exposées six tapisseries rouges composées pareillement : sur une île bleue, une dame est entourée d’un lion et d’une licorne. Une jeune accompagnante sert la dame, sauf sur les deux tapisseries où elle touche la licorne. Il y a des oiseaux dans le ciel, des animaux et des fleurs dans l’herbe. Il y a aussi quatre espèces d'arbres, sauf sur la tapisserie avec un miroir où il n’y en a que deux. Sur la tapisserie où la dame dépose ses bijoux dans un coffret, il y a une tente ouverte sur le fronton de laquelle il est écrit « Mon seul désir ».
Comme l’indique l’héraldique de trois lunes montantes sur fond rouge, les Tapisseries furent tissées pour la famille lyonnaise Le Viste, entre 1450 et 1550. C’est dans les années 1840 qu’elles furent découvertes au château de Boussac, presque dévorées par les rats, et c’est Prosper Mérimée qui œuvra pour leur sauvegarde au musée de Cluny. Depuis, elles ont fait couler beaucoup d’encre et elles ont éveillé de bien beaux sentiments à de bien belles personnes qui s’accordent à dire qu’elles n’ont pas encore dévoilé tous leurs secrets.
L’on nous dit que les cinq premières tapisseries représentent les cinq sens : Toucher, Goût, Odorat, Ouïe et Vue ; et que la sixième, la plus grande, que j’appellerai Désir, avec la tente de « Mon seul désir », serait l’allégorie d’un sixième sens, le sens du cœur, libéré des illusions des cinq autres. « Mon seul désir » reste une énigme, il suscite des controverses sur le libre arbitre, à l’image des querelles de la Grâce. Il se dit qu’il s’agit de la caritas chrétienne, ou que c’est une devise courtoise, celle d’une soumission du prétendant aux désirs de sa dame. Mais sait-on encore ce qu’était l'amour courtois, ce fin’amor occitan, que l’on s’imagine aujourd’hui le petit doigt levé sur Radio courtoisie ?
Les Tapisseries sont troublantes, elles éveillent l’idée qu’il y a plus, toujours plus à lire dans les regards et dans les sourires de ces six dames, ou alors de cette même dame à différents moments de sa vie. Elles ont exercé sur moi une forte impression dès la première rencontre, une impression qui n’aura fait que croître jusqu’à ce que je sois conduit à les revoir. Alors, notant minutieusement les détails, je fis une découverte, simple, très simple, puis j’ai tiré doucement sur ce fil et peu à peu j’ai vu le voile se soulever de la face du mystère. Les jours suivants, j’ai été ébloui par la beauté, j’ai eu le sentiment de tout comprendre. Puis je n’ai eu de cesse de me questionner, après l’intuition a commencé un travail de documentation, d’élaboration d’une pensée justifiable et communicable.
Je me range volontiers du côté des fantasques, des hérétiques, des mystiques et des alchimistes. Si je vous livre aujourd’hui mon interprétation, ce n’est pas seulement pour signer de mon nom un nouveau continent, c’est parce qu’il s’agit d’un chemin que je parcours à la poursuite de la dame, et que ce chemin est d’une fabuleuse beauté, il me conduit sur des terres nouvelles, des terres qui ne me laissent pas sur le seuil du mystère. C’est le chemin spirituel tel qu’il est prêt à naître en chacun de nous, selon une entente gravée dans notre cœur, le dessin d’une plume tombée une nuit en Chine, une signature. C’est un chemin pour lequel il est inutile de chercher une continuité, une causalité, une tradition à la Guénon. C’est un chemin qui apparaît et disparaît à sa guise, irrespectueux des causalités de l’espace et du temps, qui nous conduit à l’étincelle éblouissante cachée dans ce qui est caché, œuvre du souffle du Saint-Esprit. Les Tapisseries nous indiquent le chemin de l’âme.
J’aimerais vous laisser ces paroles exaltées pour seule notice et vous envoyer voir les Tapisseries à Cluny, passer du temps en compagnie de ces dames, comme j’aime tant le faire. Peut-être voudrez-vous les voir ou les revoir avant de lire ce qui suit. Je vous en prie, faites-le. Vous trouverez cent choses qui ne seront ni ici ni ailleurs, des choses pour lesquelles vous ne trouverez pas de mot, bien des reflets, des idées, des intentions, dont vous ne saurez si c’est l’artiste ou si c’est votre cœur qui les y a mises. Peu importe, suivez votre intuition. Vous reviendrez peut-être à la lecture de cet humble travail sur six tapisseries qui sont entre le Moyen Âge et la Renaissance, ici aussi il y a une petite querelle, mais peu importe, l’âme et ses chemins sont d’étranges sujets d’étude, hors de l’époque et du lieu. À mesure que nous avancerons, nous regarderons monter l’aurore de sa gloire sans égal, l’aurore de sa bonté infinie, de ses océans de larmes, de son amour incandescent, à elle, la femme divine, la Sainte Vierge et la Vierge noire, la papesse, l’Isis, la dame assise, la licorne reposant sur ses genoux lorsqu’elle lui présente un miroir orné de perles. Ô Dame, je regarde moi aussi dans ce miroir que vous me présentez et je bascule allègrement dans notre reflet. Je parcours vers vous des océans de temps. Portés par votre regard, nous nous unissons et jouissons à la lumière de l’Éternel.
Me voilà bien présomptueux, mais il faut brûler de mille feux pour ne pas rester sur le seuil du mystère. Cher lecteur, j’espère surtout que vous passerez un agréable moment en ma compagnie.


Initiation
C’était un dimanche, peu après ma rentrée en classe de cinquième. Dimanche était jour d’angoisse, je pouvais passer des heures sur mes cahiers sans rien en tirer d’autre qu’un nœud terriblement insignifiant. Il y avait avec ça la perspective du devoir sur table du mardi, que j’entendais déjà gronder comme l’orage, dont je sentais déjà l’œil scruter mon ignorance, pétrifié. Mes sœurs étudiaient mieux, ma mère jardinait sur la terrasse et mon père occupait le salon. Son immense bureau baignait dans la fumée de pipe et les délires de clavecin. Il était le cœur battant de la terrible machine dominicale. Ce jour-là cependant, nous fîmes une sortie en famille.
Je ne garde pas de souvenir précis du reste du musée. C’était ennuyeux avec des pancartes à lire rapidement et dont il fallait se souvenir l'instant d'après, en regardant les reliques. Les Tapisseries étaient exposées dans une immense pièce ronde. Quelque chose d’étrange se produisit. Une chose dont je garderai toujours l’impression et qui me revient dans des rêves étranges. On me parlait d’une femme sur une île, parfois seule, parfois avec une accompagnante, entourée d’un lion et d’une licorne. On me parlait d’allégories des cinq sens. On me parlait même d’un sens du cœur. Moi, j’étais captivé par le rouge sur lequel étaient posés cent détails. J’étais dépassé par la multitude, incapable de tout voir, de tout associer, de concevoir quoi que ce fut de signifiant. J’étais béat dans un effort permanent de voir. Et lorsqu’enfin je voyais la dame toucher la corne, comment savoir que c’était ici qu’il fallait voir, qu’il n’y avait pas ailleurs une autre dame qui touchait une autre corne ? Ma confusion ne faisait qu’amplifier, j’étais littéralement noyé et pourtant je continuais de regarder, inlassable, presque toutes à la fois, les six gigantesques tapisseries. Les images échappaient à mon regard. Je demandais que l’on m’indique plus précisément, ne serait-ce que la licorne, que l’on me dise où regarder, mais rien n’y faisait. Je me souviens de la bienveillance de ma mère, habituée à mes moments lunaires. Je me sentais perdu dans le labyrinthe qui se dessinait dans l’immensité de la pièce circulaire. J’allais et je venais du regard, me demandant si nous resterions assez longtemps pour qu’un miracle s’opère et qu’enfin je voie ce qui se présentait à moi. Cette confusion allait naturellement avec l’idée qu’il y avait un sens, comme une résistance implique une force opposée. S’agissant d’une confusion absolue mêlant les six tapisseries, il devait y avoir un sens absolu unifiant les six tapisseries, caché, car si moi seul percevais l’immense confusion, moi seul pouvais concevoir l’immensité du mystère.
Plus tard je découvrirais Le Conte du Graal et je dirais aujourd’hui que j’étais comme Perceval regardant passer en procession le Graal et une lance qui saigne. C’est l’impression de ne pas avoir compris sur-le-champ, de ne pas avoir su regarder, mais que d’évidence c’était une chose sacrée qui se produisait là, une chose dont la lueur dépassait l’éclat du Soleil.
À l’évocation des Tapisseries, je garderais deux représentations. L’une est celle d’un sujet classique, de patrimoine, de sortie scolaire, de boutique de musée. L’autre est celle d’une tapisserie intérieure, intime, rouge et épaisse, d’une dame qui éveilla mon jeune désir et d’une licorne, animal fantastique, pur, puissant, fruit de l’imaginaire, une représentation qui fit vibrer des profondeurs inconscientes. Je compris un jour que cette tapisserie intérieure n’était pas le simple fruit de mon esprit, mais qu’elle était le sens véridique de l'œuvre qui s’était lentement révélé en moi. Je m’étonne encore d’à quel point l’effet mystérieux de l’aveuglement, un jour d’enfance, a fait grandir malgré moi cette étrange intimité. Peu à peu, la dame s’était tissée dans mon cœur sans demander mon accord. Ma relation avec les Tapisseries était telle que je ne voulais rien lire qui les concerne, je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas y penser autrement que comme une chose qui d’une certaine façon m’appartenait. Comme le moine fou de Mishima rêve du pavillon d’or, je gardais jalousement la promesse de la revoir identique à mes rêves. Il faudrait que se dévoile la nature de ce rêve, jusqu'alors resté indécis, impalpable, impropre à l’usage des mots.
Un jour d'enfance


Vingt-cinq années passèrent, des années d’étude puis de travail, d'amis puis de famille, de soucis et de joies. Vingt-cinq années qui m’éloignèrent de ce premier jour, de cette première rencontre avec les Tapisseries. Des années qui m'ont fait oublier ce pressentiment de secret d’un secret, des années qui m'ont fait oublier l’aura de mystère dont je serais le seul à détenir la clé. Il ne restait qu'une promesse amusante faite à l'enfant que j'avais été.
Pendant ces vingt-cinq années, je me suis intéressé à d’autres sujets, à mon métier bien sûr, mais dès que j’en avais le temps, j’allais chercher le plus loin possible des sentiers battus, un sujet me conduisant à un autre. Dernièrement, ça avait été l’exégèse de la culture populaire de Pacôme Thiellement qui m’avait conduit aux gnostiques de Jacques Lacarrière, puis aux cathares de René Nelli, puis par l’Occitanie, à l’amour courtois de Jean Markale. Depuis longtemps je m’étais intéressé aux vampires, plus récemment j’étais passé aux sorcières, j’avais découvert l’invention de leur culte du diable sous les tortures de l'Inquisition, un culte qui en cachait un autre, véritable quant à lui, un culte que l'on avait sciemment caché, un culte ennemi de l'Église patriarcale, le culte de la Déesse.
Voilà qui j’étais quand un dimanche de juillet, je suis retourné à Cluny avec ma compagne, mon amour, « ma » femme. Comme pour la première rencontre, c'était un dimanche, mais cette fois je sortais d'une nuit de travail. Au réveil d’une sieste, je me sentais d’une humeur bien spécifique à ces jours. C’est un état d’agréable nonchalance, dans lequel les idées émergent avec élégance, et où chaque détail prend un relief pénétrant. La grande aile du musée était en travaux, ce qui raccourcit notre visite aux bains romains, à une collection d’effigies du Christ et de la Vierge et surtout, aux Tapisseries. Nous y accédâmes par un couloir dont les murs, d’un bleu solennel, portaient des mots à l’éloge du sens du cœur. Je préférai regarder le parquet qui reflétait les losanges des vitraux. Puis nous découvrîmes une grande pièce, non pas ronde, mais carrée, couverte d’ombre et de tapisseries rouges.
De cette visite à Cluny, je me souviens de la blancheur des bains et de l’or des reliques, mais de la vue immédiate des Tapisseries il ne me reste pas grand-chose. Elles étaient splendides, bien sûr. Mais il n’y eut pas de révélation. Nous allâmes ensuite nous promener dans le quartier. J’étais un peu ailleurs, quelque chose se mettait en place dans mon esprit. Peu à peu, je sentis un élan grandir en ampleur, sans pouvoir dire où il allait. C’est seulement le soir que je regardai mes photos. Je procédai d'abord à une description méthodique, notant la position de la dame, du lion et de la licorne, les différentes espèces d’animaux, les oiseaux, leurs positions, les arbres, les fleurs, les motifs de la robe, la position assise ou debout du lion et de la licorne, ce qu'ils portaient, cape ou bouclier. Je remarquai le dessin étrange des boucliers de la tapisserie du toucher, je les décalquai, je les découpai et j’essayai de les agencer de différentes façons, comme des clés du mystère. Je pensai à toutes sortes de choses, je pensai à ce titre des Tapisseries de la dame à la licorne, un titre inventé des siècles après qu'elles furent tissées, je pensai que ces tapisseries nous avaient été léguées avec le mystère pour seule notice. J’eus l’impression de les voir d’un œil nouveau, dans une perspective inédite. L’ambiance première me rejoignit, les années s'évanouirent et je retrouvai la grandeur du mystère.
Je regardai les tapisseries dans l’ordre d’exposition actuel. De la gauche vers la droite avec Toucher, la dame touche la corne de la licorne ; Goût, la dame offre une dragée à une perruche ; Odorat, la dame tresse une couronne de fleurs ; Ouïe, la dame joue de l’orgue ; Vue, la dame présente un miroir à la licorne ; enfin Désir, la plus grande, la dame dépose ses bijoux dans un coffret devant une tente ornée de l’inscription « Mon seul désir ». Les guides nous proposent cette explication des cinq sens extérieurs et du sixième sens, le sens du cœur. Une explication qui nous enseigne que les enseignements d’une vie sensible mènent la dame à abandonner ses bijoux, ses richesses, ses vanités, à se libérer de la corruption des cinq sens, pour atteindre le libre arbitre et la caritas chrétienne. Je ne pus me détacher de l’idée que cela était faux, qu'il fallait pousser plus loin, que les Tapisseries avaient plus à nous enseigner. Je ne pouvais accepter de laisser à l'écart cinq merveilleuses tapisseries, qu'elles ne soient que le faire valoir de cette sixième.
La seconde lecture de « Mon seul désir » est celle de l'amour courtois, d'un prétendant qui se soumet au désir de sa dame. L’amour courtois est une émancipation de la femme : libre, elle agit selon son seul désir, et de ce seul désir elle accorde ou elle refuse à son homme. Pour gagner les faveurs de sa dame, il accomplira mille prouesses, il se dépassera, au point qu’à la fin il aura changé pour elle. L’amour courtois change l’homme, il change aussi la femme, devenue l’unique maîtresse, l’unique motif de désir, elle change dans le regard de l’homme et se voyant ainsi idéalisée, elle accepte volontiers d’incarner l’idole. Le désir premier de la dame guide le désir second du prétendant, deux désirs qui entrent en symbiose, deux désirs qui unissent le masculin et le féminin par une sublimation qui élève le couple à un état inédit, une résolution des dualités, une révélation, une renaissance. Or une épreuve qui nous change pour nous conduire à des réalités autrement inaccessibles, c’est une initiation. Et qui dit initiation dit rite. Et qui dit rite dit ordre. D’où cette question que je me suis posée : dans quel ordre faut-il regarder les Tapisseries ?
Sur chaque tapisserie figurent des lapins, plus ou moins nombreux, de deux sur Toucher à une dizaine sur Vue et sur Goût. Par conséquent, j'ai pensé qu’ils devaient être importants, que si l’on cherchait un sens dans les Tapisseries, une clé du mystère, ils devaient avoir quelque chose à nous dire. Autre indice de leur importance, le lapin est le seul animal, avec le lévrier, à être présent sur chacune des tapisseries. Je vis d’abord dans les lapins une allusion à l’acte sexuel, puisque nul n’ignore leur fécondité et que l’on dit « faire l’amour comme des lapins ». C'était une première idée, une toile de fond des Tapisseries : le véritable érotisme, l’amour charnel, comme les animaux qui ne connaissent pas le péché.
J’ai ensuite eu la vision d’un jeu, de vignettes que l’on s’amuserait à ranger dans l’ordre selon un indice, et que cet indice était les lapins. Puisqu’ils se multiplient, ils sont de plus en plus nombreux, à moins que les prédateurs dévorent les lapins entre les tapisseries, mais il faut bien partir de quelque part. La voilà donc, la grande révélation, l’ordre des Tapisseries : avec deux lapins, Toucher ; avec quatre lapins, Odorat ; avec six lapins, Ouïe ; avec sept lapins, Désir ; avec dix lapins, Goût ; enfin avec onze lapins, Vue.
Elles étaient dans l’ordre, mais elles ne me dirent rien ce premier soir. Il était près d’une heure du matin et le lendemain j'avais travail. C’était comme une clé à moitié, une clé qui avait seulement ouvert sur une pièce plus grande, plus obscure. Il me fallut plusieurs jours et plusieurs nuits, d’étude et de rêve de tentures rouges, pour révéler les Tapisseries comme dans une chambre photographique. J’ai écrit un premier texte que j’ai publié sur Facebook, presque sans retour. J’ai lu les livres sérieux, ceux édités par Les musées nationaux. [1,2] J'ai lu Les floraisons intérieures de Jacqueline Kelen [3] et un instant j’ai songé à m’incliner d’humilité. Puis j’ai repris, il manquait l’ordre, les lapins, et c’était une raison suffisante pour continuer. Je me sentais de plus en plus investi d’une mission, d’un devoir. J’avais le sentiment qu’elles avaient quelque chose de grand à me révéler et que c’était d’autant plus extraordinaire qu’elles étaient là, toutes les six, à la vue de tous, avec leurs joyeux lapins bondissants, et qu'il m’appartenait de révéler ce chemin. Quel orgueil ! Pourtant il me faudrait de l’humilité pour aider les Tapisseries à se révéler, sans parler à leur place.
Vingt-cinq années après


Les tapisseries sont immenses. La dame est d'une longueur qui l’élève et nous agenouille à ses pieds. Des tapisseries de soie et de laine tissées en fragments de couleur, des fragments qui morcellent l’image, ce sont des maillons, signifiants comme les mots d'une histoire. Six tapisseries, six scènes similaires, qui se déroulent dans un ailleurs, sur une île bleue flottant sur un rouge dont on ne sait si c’est la terre portant les fleurs ou le ciel portant les oiseaux. La dame ne pose pas, elle agit, elle touche la corne et la lance, elle tresse une couronne, elle joue de l'orgue, elle dépose ses bijoux, elle offre une dragée à la perruche, elle présente son reflet à la licorne. Nous sommes conduits dans un ailleurs, celui d’une île bleue sur un mille fleurs rouge mariant la terre et le ciel, et pourtant la dame est réelle, elle est présente, car elle participe à une relation, avec son accompagnante mais surtout avec un lion et une licorne, deux bêtes puissantes, dangereuses, et pourtant paisibles aux côtés de leur dame.
Que symbolisent le lion et la licorne qui entourent la dame ? Comme plus tard avec les nombres, je m’en tiendrai à ce que nous dit Le dictionnaire des symboles de Chevalier [4]. Et encore, je serai obligé d’opérer un tri dans le Chevalier, m’en tenant autant qu’il se peut au médiéval.
Si toutes les symboliques pouvaient être aussi évidentes ! Le lion est le roi. Il est le légitime représentant du faste du souverain, de la force physique, de la force morale, de la justice. Aux vertus cardinales il manque la tempérance, le lion est fougueux, dangereux, il incarne aussi les excès du pouvoir, la méfiance du despote, la cruauté du tyran. Sa crinière lumineuse fait de lui le digne représentant de l’or et du Soleil, au sens propre comme au sens alchimique.
Au lion dont la symbolique relève de l'expérience tangible des peuples, s’oppose la licorne, mystérieuse. Au Moyen Âge, la licorne était à la lisière du réel, il y avait des doutes remontant à l’Antiquité, il y avait des témoignages décevants, le récit d’un rhinocéros des Indes, ou une corne, juste une corne de narval. À l’époque le monde était plus grand, il restait des terres inexplorées, le doute restait permis. L’on se permettait de penser qu’elle était là, toute proche, à l'orée du bois, mais qu’elle fuyait à notre approche, farouche licorne qui n’acceptait nul autre contact que celui de la pureté inaltérée, celle des charmes et des senteurs d’une jeune vierge. Il circulait aussi des récits de chasse à la licorne, lors de laquelle elle se révélait terriblement dangereuse et capable, de sa corne, de vous transpercer le cœur. Il y avait même des récits de licornes piégées, prises au filet tendu auprès de la vierge. Voici en résumé la légende de la licorne que l'on espérait voir un jour, dans une blancheur éblouissante, dresser sa corne vers les Cieux.
La licorne est un paradoxe. Étrangement la langue française a changé l’« unicorne » masculin en « licorne ». Elle tient du mâle, de l’étalon fougueux, débridé, nu, dont la corne en érection en appelle à la libido. En même temps elle est blanche, elle n’aspire qu’à la pureté, la vierge, et sa corne unique appelle à l’Un, d’après Chevalier elle est « la flèche spirituelle qui évoque la révélation divine et la descente du divin dans la créature ». Il y a de l’Immaculée Conception et de la chasteté courtoise dans la licorne. De cette combinaison de fécondité et de virginité, d’érotisme et de pureté, naît une scène, une dynamique insoluble ici, mais qui s’accomplit pleinement dans des résonances inconscientes. Considérer la licorne dans son entièreté, c’est se permettre une plongée dans les profondeurs irrationnelles, c’est accepter qu’existent en nous des réalités intangibles, des réalités psychiques. Le succès sans cesse renouvelé de l’animal mythique ne nous dit pas tant une chose d’elle, il nous dit une chose de nous. La licorne existe-t-elle ? Bien sûr ! Quel malheur cependant que la licorne ait été castrée, enfouie dans l’ombre, pour nous laisser cette licorne de petites filles, là où l’animal mythique suscitait savamment une dynamique ambivalente et subversive. La licorne incarne une réalité écrite sur le versant irrationnel de l'être, qui transparaît dans le cœur, dans l’instinct, dans le sentiment, dans les perspectives de l’âme.
L’opposition du lion et de la licorne dans les Tapisseries met en exergue deux forces adverses. Le lion est la force tangible, rationnelle, du corps et de la morale. La licorne est la force intangible, irrationnelle, instinctive, spirituelle et érotique. Ensemble ils rejouent la rivalité du cœur et de la raison.
Les Tapisseries dans l'ordre


Dans sa robe noire brodée d’or, la dame, rayonnante, porte un regard ardent sur le lointain, sa chevelure blonde détachée sous un diadème. D’une main elle porte l’étendard familial et de l’autre elle caresse la corne. Comme le lion, la licorne porte une targe, ce bouclier muni d’une encoche pour maintenir la lance du tournoi. Il y a donc eu un affrontement, il y a eu une opposition des principes incarnés par le lion et la licorne. Il y a eu une rencontre réelle, non projetée, du rationnel et de l’irrationnel. La dame a pris conscience de ces formes adverses de réalité, ces principes, ainsi que du choix qui s'imposait à elle. Et c’est la licorne qui est sortie victorieuse du tournoi, c’est elle qui a gagné son cœur. La dame découvre la soif spirituelle, elle voit au-delà de la tapisserie, d’un regard chargé d’allégresse, d’ambition, d’élan. La licorne sourit. Le lion est à l’écart, l’air perdu et les yeux ronds, car pour la première fois certainement, la raison n’a pas sa place dans le cœur de la dame.
Dans le ciel, le faucon tombe sur l’oie qui écarte les ailes, sur le dos, comme pour le recevoir. Les bêtes sauvages représentent la passion animale, entravées par des chaînes et des colliers qui figurent l’interdit. La tapisserie nous parle de deux passions, la passion spirituelle, triomphante, et la passion charnelle, moitié contenue par les chaînes des fauves, moitié libre comme l’oie qui s’offre au faucon.
Il ne faudrait pas oublier les lapins, deux lapins qui seront bien fertiles. À mesure que nous la regardons, la tapisserie s’emplit de désir. Désir que la dame suscite en nous, elle nous envoûte, par son regard, par son audace, par sa tenue, par cette chaîne qui ceint ses reins et qui semble bien facile à défaire. Désir de la dame, cette soif, ce désir qui habille la robe dont les dorures dessinent l’aurore sentimentale.
Toucher


Le doigt levé sur son ouvrage, la dame tresse une couronne de fleurs. Les cheveux attachés sous un court voile doré, une heureuse sérénité émane d’elle. Un sourire se devine à ses lèvres, comme pour garder un secret si près de s’enfuir. Serait-ce la couronne appelée à servir un mariage d’amour ? Serions-nous témoins de cet instant solennel où l’accompagnante aide sa dame dans les derniers préparatifs de la noce ? Et qui serait l’heureux prétendant ? Toucher indiquait le triomphe de la licorne, en effet le lion porte à présent un écu tandis que la licorne a conservé sa targe. Les animaux sont tranquilles. Le singe sent une rose, en haut dans l’herbe rouge, une grue et une pie se regardent, le lion a retrouvé sa majesté, fier qu’il est de sa dame. Elle songe à ce qui l’attend, une vie de douce allégresse dans les bras de son amour nouveau, sa licorne. Elle a fait le choix irrationnel de la passion et du spirituel.
À mieux y regarder, quelque chose d’étrange couve à l'arrière-plan. Le singe sent la rose du mauvais côté. Le héron laisse pénétrer la pie voleuse. Surtout, il y a l’accompagnante qui tient étrangement son plateau, sous son bras, comme pour aller au champ. Une accompagnante dont la posture n'a rien de la jolie révérence, dont le regard n’est pas habité par l’admiration de sa dame. C'est un regard étrange, détaché, dédaigneux. L’accompagnante rompt l'ambiance énamourée de la scène. Elle semble dire que comme les fleurs, un jour la dame fanera et perdra son doux parfum. C’est une beauté, une joie, un état qui ne connaîtra qu’un temps. Ici tout embaume, un parfum doux, mais volatile, périssable comme la fleur coupée de la couronne, qui finira au mieux desséchée dans le coffre des regrets. La jeunesse passera, inexorablement. La dame, qui a connu la passion spirituelle accompagnée d’une touche d'érotisme sur Toucher se réjouit à présent des promesses de l’amour. Mais tout périra, à moins qu’elle ne dépasse les règles de notre monde.
Odorat


L’air grave, la tête inclinée sous son voile noir, la main alourdie par sa longue manche qui dessine une pointe cruelle, la dame joue de l’orgue. De l’autre côté, l’accompagnante la regarde en actionnant lessoufflets de l’instrument. La menace est partout, un renard est prêt à bondir sur l’agneau, le lionceau sur un lapin et encore un renard sur un lapin. Les proies regardent ailleurs. Refusent-elles de voir ? Comme la femme qui refuse de regarder la licorne. Une licorne étrange, déplacée, qui dérange, sa croupe derrière l’accompagnante et les pattes enlacées sur la lance, le regard endiablé, lubrique. La licorne a une liaison avec la jeune accompagnante.
C’est l’infidélité, c’est l’amour qui blesse. Tous entendent l'orgue qui emplit la tapisserie, la musique pénètre tout, inexorablement, comme un charme. C’est une triste complainte qui plane et donne à chacun l’air absent et inquiet. Le lion est tendu, il ne sait que faire, il semble paralysé, certainement voudrait-il pleurer. Les tuyaux de l’orgue dessinent une descente de la sculpture du lion vers celle de la licorne. C’est inéluctable, c’est une descente de la haute raison vers l’âme déchue. Le lien sacré du mariage est rompu. Voilà où sa quête a conduit la dame, perdue, honteuse, abandonnée.
Dans le ciel rouge, le faucon est en position de chasse et l’oie chute. Une scène qui rappelle le passage du Conte du Graal dans lequel Perceval, arrivant au campement du roi Arthur, s’arrête devant ce spectacle et s’oublie : des oies sauvages, éblouies par l’aveuglante clarté de la neige, sont prises en chasse par un faucon. Une oie tombe, blessée, Perceval s’approche, mais le temps qu’il arrive, l’oie reprend son vol, laissant derrière elle trois gouttes de sang sur la neige. Trois gouttes de sang qui lui rappellent le vermeil des joues de Blanchefleur, son amour qu’il vient d’abandonner.
La licorne, dans sa symbolique ambivalente, a basculé du spirituel au charnel. Elle a oublié la dame, elle a trouvé plus jeune, plus vierge. Et que fait la dame, abandonnée par l’élan spirituel ? Elle joue de l’orgue. C’est sûrement une complainte mélancolique, une de ces mélodies qui subliment la douleur en une mélopée apaisante. Les notes de l’orgue portatif médiéval, vous les entendrez jouer aujourd’hui par Catalina Vicens, enchanteresse de ce monde. Ce sont de longues notes mêlant le métal vibrant à la chaleur du bois, des notes qui se chevauchent dans un mouvement incessant, dans une respiration, dans un souffle. Ce sont les mêmes notes qui baignent Ouïe. La musique dépasse le langage dans une expression intime de l’âme, dans un état que les mots pourraient qualifier d’apaisement, de langueur, ou mieux de blues, cette musique de la douleur. Voilà une drôle d’affirmation, mais faisant fi des siècles, je dirais que la dame joue du blues, cette musique nonchalante, détachée, recélant une joie à contretemps, comme une consolation, comme une fuite dans un ailleurs qui soulage subitement toutes tensions. La musique ne connaît pas de limite, surtout celle qui vient de l’intérieur, celle qui vient de l’âme.
Cela devait arriver, le parfum d’Odorat était voué à se dissiper. L’accompagnante n’est pas la cause, elle est l’élément précipitant de la rupture, elle est le catalyseur, elle est le sel. Elle joue un rôle subtil, elle qui actionne le soufflet de l’orgue, un soufflet qui rappelle l’alchimiste entretenant le feu sacré dans l’espoir du Grand Œuvre. L’accompagnante, par l’adultère brûlant qu’elle insuffle, attise l’Œuvre alchimique qui opère dans ce beau foyer qu’est le cœur de la dame, dame qui sublime sa souffrance en notes spirituelles, des notes qui font descendre sur elle les radiances de l’âme.


Ouïe
La dame dépose ses bijoux dans le coffret tenu par son accompagnante. C’est une cérémonie, un sacerdoce. Avec ses bijoux elle se libère du besoin de plaire, elle quitte les obligations de son rang. Elle est sur le point de pénétrer dans l'intimité de la tente. Allégoriquement, elle abandonne les illusions des cinq sens en échange de la pureté du sens intérieur, sous la célèbre notice : « Mon seul désir ». Dans le ciel, le faucon est tenu captif par des chaînes tandis que l'oie a retrouvé la posture de Toucher. Le lévrier porte un collier tandis qu’un gentil petit chien trône sur un coussin brodé. Détachée de la passion, la dame exerce son désir, son seul désir. Mais quel désir ?
« Mon seul désir ». C’est la clé du mystère, le sens caché des Tapisseries que l'on nous indique à la visite du musée. Cette devise au sens de « céder à ses envies » nous conduirait vers des champs spirituels bien étranges, il faudrait ouvrir les grimoires d’Aleister Crowley à la page de sa devise licencieuse « Do what thou wilt shall be the whole of the Law ». Fort heureusement, « désir » était compris autrement au XVIe siècle, il se rapprochait du « bon vouloir » de Rabelais, tout proche du libre arbitre.
Jean Patrice Boudet décline la compréhension de « Mon seul désir » selon deux lectures, celles de la tempérance et de l’intempérance. [5]
« six sens, cinq dehors et ung dedans qui est le cuer, lesquels nous sont baillez à gouverner comme six escoliers » écrivait Jean Gerson dans Moralité du cœur et des cinq sens. La lecture en tempérance est celle de la caritas chrétienne, les ornements de la tente figurent les larmes de la compassion et le sens du cœur naît du renoncement aux sens physiques pour ouvrir son cœur à la prière et à la dévotion. Seul le sens du cœur serait apte à saisir la beauté de l’âme et sa maîtrise serait la clé de la rédemption.
« De cœur loyal, content de joie ; Ma maîtresse, mon seul désir; Plus que quiconque vous veuille servir ; En quelque place que je sois » chantait Charles d’Orléans. La lecture en intempérance est celle de la morale courtoise, les ornements de la tente figurent les flammes du désir charnel. La dame soumet son prétendant à son désir, son seul désir. Quel sera ce désir ? Où la dame le conduira-t-elle ? Est-ce un désir de vice ou de vertu ? Le dominera-t-elle, comme les chaînes et le collier le suggèrent ? Ou élèvera-t-elle son âme sous la tente bleue ?
Deux lectures divergentes, cependant invitées sous une même tente, une même tapisserie, cela ne vous rappelle-t-il pas la symbolique ambivalente de la licorne, pure et charnelle, spirituelle et érotique ?
Ce désir indépendant des sens, indépendant du dehors, suggère le libre arbitre. Et qu’est-ce que la liberté ? C’est la moitié de la philosophie qu’il faudrait relire. Restons-en au Moyen Âge, on distinguait alors deux formes de liberté, celle qui s’oppose à la volonté de Dieu et celle qui s’y accorde. Si elle s'écarte de Sa volonté, que ce soit pour goûter les plaisirs des cinq sens et des sept péchés, ou simplement pour faire l'expérience de la liberté, alors c’est une liberté illusoire dont le tentateur tire les ficelles. Si la liberté est au contraire l’aptitude de résister à la tentation, comme semble le faire la dame en déposant colliers et bracelets dans le coffret, pour vivre en action comme en pensée selon la volonté divine, alors c’est une liberté qui conduit à un ailleurs, un havre de vertu, habité par la Grâce, à l'abri de la tente, détaché du monde. C’est librement, de son seul vouloir, que la dame agit selon la volonté de Dieu.
Il y a aussi ce que Platon dit de l’âme dans Phèdre, lorsqu’il la représente sous la forme d’un attelage composé d’un cheval noir figurant l’espèce pulsionnelle, attirée par les plaisirs du monde ; et d’un cheval blanc figurant l’espèce raisonnable, aspirant à la beauté et au monde des Idées. Le cocher représente l’esprit tentant de concilier ces deux penchants. Ainsi les cinq sens seraient le cheval noir, pulsionnel, et le sens du cœur serait le cheval blanc, aspirant à la beauté de l’âme et au monde des Idées. Vivre comme Désir nous y invite, sous la tente, absolument libéré des cinq sens, ce serait certes vivre dans un monde où nul cheval noir ne viendrait tirer l’âme vers le bas, mais ce serait vivre dans un monde sans monde, un monde qui n’est pas le nôtre.
Où en serait la dame à l’issue de cette ultime tapisserie ? Elle aurait enchaîné son amant le faucon, elle aurait abandonné le monde, pour se cloîtrer dans une béatitude digne d’une nonne. Elle accomplirait de belles œuvres de charité, elle inciterait à la prière et à la vie pieuse. Ce serait cependant un aveu d’échec, comme s’il ne pouvait y avoir de salut que hors de ce monde. Est-ce une réponse à la hauteur de l’élan fougueux de Toucher ? La tapisserie de Désir représente-t-elle une fin en elle-même, ou est-elle une étape, un équilibre temporaire ?
C'est un état contraint, il faut les cordes tendues aux arbres pour maintenir la tente dressée, les chaînes aux serres du faucon, le collier au cou des lévriers. C’est un état qui ne peut tenir éternellement, un état qui est promis à la fatigue, à l'usure, au relâchement, à l'abandon des vœux pieux qui laisseront place à une caricature de la vie pieuse, faite de prières désincarnées dans les cernes et de contritions habitées par le vice. La tente doit être un rite de passage, elle ne doit pas être une fin. Elle est un rite de renaissance de la dame qui se défait de la tyrannie des sens. Elle en sortira grandie, autrement libérée, elle deviendra libératrice, elle rompra les chaînes du faucon sur Goût et conduira la licorne au-delà du seuil du mystère sur Vue.
Une autre raison qui me pousse au-delà du sens du cœur est la suivante : celui, ou celle, qui aura mis tant de génie à l’élaboration de ces fantastiques tapisseries qui combinent allègrement les symboles, cette histoire sans mot, impérissable, intemporelle, aurait-il mis la clé de l’œuvre ici, en évidence, sur le fronton de la tente ? Il y a plus, beaucoup plus dans les Tapisseries. C’est mon impression première, mon intuition, mon guide, mon envie de suivre le chemin d’une famille de lapins blancs qui nous conduit plus profond, toujours plus profond dans le terrier, jusqu’à l’envers du miroir. Préférez-vous le chemin indiqué par la tente de la privation ? Un chemin qui méprise cinq des plus belles tapisseries du monde médiéval ? Ou préférez-vous, comme Alice ou Néo, poursuivre le lapin blanc ?


Désir
L’accompagnante, agenouillée sous sa longue robe bleue, tient des deux mains le pied d’une lourde coupe d’or remplie de dragées blanches. Elle est comme l’enfant de chœur tenant le ciboire rempli d'hosties. Elle porte un regard plein d’admiration sur sa dame qui saisit doucement une dragée, sans détourner le regard de la perruche posée sur son gant. La perruche, tenant précieusement dans sa patte une dragée, fait montre de sa beauté et déploie ses ailes. La dame est vêtue de différentes teintes d’or et la brise soulève son voile bordé de perles. Son regard est chargé de calme et de douceur, de savoir et de sagesse, ce regard est un geste, un souffle, qui nous rappelle aux mystères antiques. Les animaux sont paisibles, libérés, le lapin sautille, le singe mange un fruit et le lévrier le regarde. Le petit chien a perdu son piédestal, il est relégué sur le pan de la robe. Un animal étrange figure à gauche de la dame, avec une barbiche et une queue panachée, il pourrait s’agir d’une jeune licorne dont la corne n’a pas encore poussé. La dame partage la liberté qu’elle a acquise et chacun passe des jours heureux. Elle ne fait plus elle-même l’expérience des sens, elle devient l’initiatrice qui offre la dragée à la perruche, au centre de la scène.
Une scène, une cérémonie, que la pie risquerait de troubler, oiseau voleur qui déroberait volontiers les dragées. Mais le faucon veille, à bien y voir il fond déjà sur la pie. Un faucon qui a quitté ses chaînes, mais qui reste attaché à sa dame, car elle porte un gant bien particulier, un gant qui n’est pas fait pour tenir la douce perruche, c’est un gant de fauconnerie. Le faucon, haut dans le ciel, est à présent au service de sa dame, c’est pour elle qu’il chasse la pie du ciel.
Le lion et la licorne sont debout comme des hommes. Leurs capes, attachées au cou par trois pierres précieuses, sont soulevées par le vent comme le voile rose de la dame. Le lion rugit, la gueule béante. La licorne, elle, semble réservée, absente, elle regarde à droite, au-delà, hors de la tapisserie. Lion et licorne, cœur et raison, œuvrent ensemble à l’épanouissement de l’être. Dans l’harmonie du jardin caché derrière une barrière de roses, sous la protection du faucon, la fragile perruche goûte une précieuse dragée. Comme dans le poème de Baudelaire, « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ».


Goût
Lorsque j’ai compté les lapins, deux constats m’ont confirmé dans ma démarche : que Désir ne soit pas la dernière et qu'il s'agisse justement de cette tapisserie qui me trouble tant. Cette tapisserie accède au divin, et c’est une divinité qui ne s’inscrit pas dans nos schémas, c’est une divinité antérieure. La dame nous invite dans un monde que sa seule présence suffit à créer.
L’ambiance est empreinte de silence et d’une étrange sérénité. Le lion et la licorne sont nus et les animaux sont à l’écart. L’unique étendard est porté par le lion et sa pointe est émoussée, car on ne pénètre pas armé dans un temple. La scène est solennelle, au centre figurent trois visages, la dame, la licorne, et son reflet. Le lion regarde ailleurs, à gauche, à l'opposé de la licorne sur Goût. La licorne plonge le regard dans son reflet, dans le miroir que la dame lui présente, et elle sourit. La dame lui offre la connaissance d’elle-même, c’est la spiritualité qui se découvre, qui s’objective, qui se manifeste. La licorne est allongée sur les genoux de la dame qui la caresse. C’est une relation charnelle, affectueuse, doucement érotique, d’un amour transcendant par lequel le couple parvient à déchirer le voile du réel. Il n’y a plus d’oiseaux dans le ciel, car il n’y a pas d’équivalent à ce qui se révèle ici. Le couple accède à l’union mythique des opposés, le mâle et la femelle, le bien et le mal, la matière et l'esprit. C’est la syzygie, la Sofia, qui accède à la transcendance dans la chambre nuptiale.
Sous la robe, les volutes florales ont laissé place à un étrange lichen bleu. Un lichen dont les froissements doivent faire d’étranges mouvements hypnotiques. Ce lichen bleu est le motif des robes des accompagnantes, ainsi la dame, dans son ultime accomplissement, s’identifie à la novice, elle est l’alpha et l’oméga. Une robe du même bleu que la tente de Désir, la dame est elle-même le lien avec les Cieux, elle est un temple.
Les yeux mi-clos, elle voit à la lumière de l’esprit et guide la licorne qui a les yeux grand ouverts sur le miroir. La dame lui dévoile le versant intérieur de son être. Ce miroir est symbole de vérité et d’au-delà, il n’est pas celui de Narcisse, c’est un miroir qui a plus à nous montrer que l’apparence. La licorne y découvre une licorne entourée de blanc à gauche et de noir à droite. Dans une image dualiste, elle est le mélange, le jumeau cosmique manichéen. Et si nous voyons la licorne dans le miroir, cela signifie qu’elle nous regarde. Le couple nous invite dans son au-delà. Ou mieux, cette licorne, c’est nous-même.


Vue
Voici ce que nous ont révélé les Tapisseries, vues selon l’ordre indiqué par les lapins. Parfois je me laisse aller à toutes les interprétations, porté par le vent mystique, mais il y a du bien, beaucoup de bien dans le doute, dans la recherche de preuves, de corrélations, de sources concordantes. À peu près tout ce qui suit est né du doute. Dans quelle mesure parviendrai-je à soulager vos esprits sceptiques ? Accepterez-vous de me suivre dans mes étranges cheminements spirituels ? Combien serez-vous encore à m’accompagner à l’issue des nombreuses vallées qui nous attendent ? Peut-être que vous volez déjà à mes côtés et que nous volerons d’un commun accord, peut-être que vous ne savez simplement pas, que je ne vous ai pas laissé le temps de vous demander, alors continuez, il y a du divin dans la contemplation. Sans savoir de qui je tiens la main, je vous invite à me suivre, à faire compagnon d'aventure, à la poursuite d'indices qui nous feront parcourir de fabuleuses contrées de l'âme. Commençons par ce premier indice, la noce, évoquée dans Odorat. Une mariée se doit de revêtir une robe, un voile, et des bijoux.
Au sujet des robes, Jacqueline Kelen fait référence au motif de grenade. Je pense plutôt que ce sont des artichauts. [4] Si aujourd’hui ce motif n’a rien d’exotique, bien qu’il soit fort original, rappelons qu’il fut introduit en France tout juste à l’époque des Tapisseries. Un artichaut qui ne fait que pousser depuis Toucher, montant peu à peu jusqu’à atteindre les hanches. Avez-vous déjà vu un artichaut que l’on a laissé fleurir à sa guise ? C’est immense, il pousse toujours plus haut par une double floraison, par une fleur jaillie de l’intérieur d’une fleur. C’est une renaissance, comme la dame renaît de l’épreuve entre Désir et Goût. J'aime plus encore le motif du lichen sur le velours hypnotique de la dame de Vue, littéralement astral.
Regardons les voiles. Sur Toucher, les cheveux de la dame sont détachés sous la splendide couronne qui semble venir du lointain Orient. Elle porte un voile sur les deux tapisseries suivantes, sur Odorat il est d’un lin clair et léger, sur Ouïe il est d’une lourde toile noire qui masque l’arrière de son visage. Sur Désir c’est justement dans un voile que la dame dépose les bijoux dans le coffret, elle s’affranchit doublement, de l’homme et des richesses. Ses cheveux sont tressés en une couronne ornée de fleurs, elle s’est anoblie elle-même. Sur Goût elle porte un léger voile rose bordé de perles que soulève la brise sous une fine couronne de fleurs. Sur Vue elle a un voile noir mêlé à une couronne mêlant sa chevelure aux perles.
Quant aux bracelets, ils sont à la fois symbole de richesse et de captivité, comme les fers du prisonnier. Sur Toucher, la dame ne porte pas de bracelets. Sur Odorat et sur Ouïe, elle porte aux poignets les mêmes bracelets d’or avec des pierres précieuses, cependant le métal d’Ouïe est plus terne, les pierres sont plus petites. Sur Désir, tandis que la dame ôte ses bijoux, elle garde les bracelets qu’elle a remontés au-dessus de ses coudes. Sur Goût et sur Vue, elle s'en débarassée.
Toucher est l’amour au premier regard, la dame est libre, elle n’a ni voile ni bracelet. Odorat est le vœu d’un amour pur et éternel, la dame porte ses bracelets comme une joyeuse captive et son voile est léger. Ouïe est l’adultère, le lourd voile noir serait plus digne du deuil et les bracelets me rappellent les fers de l’esclave. Désir est l’affranchissement de la dame, elle dépose son voile avec ses bijoux dans le coffret et elle a remonté ses bracelets, bientôt elle les aura définitivement quittés. Goût est l’harmonie, la dame porte à la fois le voile et la couronne de fleurs, c’est un voile léger que soulève la brise, comme le vent spirituel soulève le voile de la face du mystère. Vue est au-delà. Est-ce seulement un voile ? Le tissu noir brodé de perles, mêlé aux cheveux blonds, évoque la nuit qui se mêle au jour, le céleste au terrestre, sous l’égide de la perle, symbole de l’âme.
Nous avons entamé le chemin, un chemin qui nous conduira bien au-delà des Tapisseries, de fil en aiguille, franchissant les cultures et les époques, nous nous laisserons bercer par les digressions, les voyages qui formeront notre jeunesse spirituelle, un chemin qui dessinera peu à peu un paysage, un contexte, un voisinage aux Tapisseries, qui permettra de mieux les voir, mieux les situer, mieux les comprendre. Nous devrons nous efforcer de nous plonger mentalement cinq siècles en arrière. Nous avons déjà commencé à le faire en nous détachant des grilles habituelles de lecture des Tapisseries, il faudra faire de plus grands efforts, nous mettre à la place de l’artiste se référant à la symbolique des nombres, à la place du châtelain devant ses Tapisseries, à apprendre du chemin universel de l’âme tel qu’il se dessine dans de profondes œuvres mystiques persanes. Pour penser comme à l'époque des Tapisseries, pour avoir les mêmes références, les mêmes lectures, nous évoquerons les modes et les coutumes de la haute société, la fauconnerie, le Conte du Graal, l'alchimie, les contes populaires, et l'amour courtois. Pour aller toujours plus loin, nous invoquerons les lois irrationnelles de l'être, la psychologie des profondeurs de Jung, les contes de fées et les souvenances lointaines d’un culte à la Déesse. Le plus difficile sera de combiner le rationnel d'une analyse méthodique à l'irrationnel de la contemplation, pour ne pas perdre de vue l’essentiel, nous laisser guider par le cheminement de l'âme.


Un premier fil, la noce
En quête de concordances
Le chemin des lapins est celui d’un calcul élémentaire, amusant, qui consistait à compter les petits lapins blancs cachés sur les six tapisseries, jusque dans le moindre recoin, jusque dans la frange du bas qui semble avoir été rongée. De ce travail, de cette presse, résultent six petites gouttes, six petits nombres : deux, quatre, six, sept, dix, onze. Ils nous indiquent l’ordre des Tapisseries, c’est déjà quelque chose, mais pourquoi ces six nombres, pourquoi pas un, deux, trois, quatre, cinq, six ? Cela aurait peut-être été trop évident, mais il se peut aussi que le créateur ou la créatrice ait choisi ces six nombres pour leurs valeurs intrinsèques. Peut-être que ces nombres sont en eux-mêmes des indices pour résoudre l’énigme des Tapisseries, peut-être qu’il y aura une jolie concordance entre la signification que revêtait chacun de ces nombres au temps des Tapisseries, et notre chemin.
C’est avec réticence que j’ai abordé l’idée d’une symbolique des nombres. Bien que j’aie un certain goût pour l’occulte, j’ai une aversion pour l’astrologie, la numérologie et autres arts divinatoires. Qu’il est dommage de laisser le mystère choir dans la boue quotidienne, la richesse, l’amour et la santé, trio digne d’un « travail, famille, patrie ». La numérologie est aussi l’art du bricolage des nombres, pauvres nombres qui se font tordre le cou par des aligneurs de coïncidences et autres scientifiques adorateurs du nouveau nombre d’or, le très haut « p < 0,05 ».
Et puis, après avoir tourné autour des arts divinatoires, j’ai appris que comme le tarot, les nombres avaient deux usages : un usage divinatoire (numérologique), et un usage symbolique (arithmosophique). La symbolique de certains nombres va d’elle-même. Par exemple, Un est l’unique, le divin ; Deux est la polarité, qu’elle réalise une opposition destructrice ou une union féconde ; Quatre est la matrice d’organisation, la stabilité préalable au développement de l’étendue des possibles (comme les quatre pattes des animaux, les quatre pieds d’une table, les quatre points cardinaux, les quatre humeurs, les quatre vents, ou les quatre saisons). L’origine de la symbolique des nombres suivants est moins évidente. Ce qui importe est que cette symbolique soit partagée, qu'elle constitue un fond culturel, dans la Bible, dans les Évangiles et dans les œuvres du Moyen Âge. Il existait un langage, des conventions, un signifiant des nombres qu’il est légitime de rechercher dans les Tapisseries.
J’avais aussi conscience d’avoir beaucoup à perdre dans la bataille. N’ayant personne avec qui échanger sur mon sujet, il fallait que je teste moi-même mes hypothèses et pour cela, me confronter à d’autres schémas. Ma lecture des six tapisseries étant posée, il me fallait trouver une grille de comparaison, établie a priori, pour ne pas céder à la tentation de changer de source en cours de route pour trouver à tout prix la concordance. Pour m’en tenir à une interprétation unique, j’ai choisi d’utiliser le Dictionnaire des Symboles de Chevalier et Gheerbrant, simplement parce qu'il m’a été vendu chez Gibert avec ce commentaire : « voilà, le Chevalier, il faut commencer par-là, c’est la base ». En espérant que l’auteur des Tapisseries connaissait l’arithmosophie, et qu’il ait mis du sens dans les lapins, cela m’a semblé être une méthode suffisamment rigoureuse. Maintenant, voyons si ça colle !
2 - Toucher
Deux symbolise le dualisme (masculin et féminin, bien et mal, ombre et lumière) à l’origine de tout dynamisme, qu’il soit créateur ou destructeur. Deux est aussi le symbole de la mère et de l’individualisation « comme tout progrès ne s’opère que par une certaine opposition, tout au moins par la négation de ce que l’on veut dépasser, deux est le moteur du développement différencié ou du progrès. Il est l’autre en tant qu’autre. De même, si la personnalité se pose en s’opposant, comme on l’a dit, deux est le principe moteur sur la voie de l’individualisation. »
Le principe de dualité concorde avec ma lecture de Toucher : la dualité fertile des lapins, la dualité rivale de la licorne et du lion (ils portent les targes du tournoi), la dualité négatrice (la pulsion de l’animal sauvage qui est entravée par les chaînes). En revanche, la symbolique de la mère ne fonctionne pas, la dame me semble particulièrement jeune, audacieuse, séduisante. Je suis surtout convaincu par le Deux de l’individualisation : la dame s’affirme, déterminée dans son entreprise, son regard porte au loin sur un avenir assurément victorieux (nous reparlerons à peu près d'individualisation avec le processus d’individuation de Jung). La dame s’extrait du familier pour pénétrer dans la quête du mystère.
4 - Odorat
Quatre symbolise ce qui est solide, tangible, sensible, ce qui est stable, tout ce qui décline la totalité du créé. Symbole du carré, du terrestre, Quatre constitue la croix de la plénitude et de l’universalité. « Il existe quatre points cardinaux, quatre vents, quatre piliers de l’Univers, quatre phases de la lune, quatre saisons, quatre éléments, quatre humeurs, quatre fleuves au Paradis, quatre lettres dans le nom de Dieu (YHVH) et du premier des hommes (Adam), quatre bras de la croix, quatre évangélistes, etc. (…) Cette totalité du créé est en même temps la totalité du périssable. »
Quatre est un socle, un sacerdoce, comme le sacrement du mariage. Ensemble, la dame et la licorne sont promises à tous les développements, tous les possibles, tous les épanouissements. La seconde dimension du Quatre fait aussi écho dans Goût, dans ce qui se joue à l’arrière-plan dans le couple du héron et de la pie, dans le regard de la servante, c’est le périssable, la couronne de fleurs qui fanera, le parfum qui se dissipera, comme jeunesse passera.
6 - Ouïe
Six est associé au sceau de Salomon, l’étoile de David : deux triangles opposés forment une étoile à six branches inscrite dans un cercle. L’opposition des triangles représente la conjonction de deux opposés et Six symbolise « l’opposition de la créature au Créateur dans un indéfini. (…) Il peut pencher vers le bien, mais aussi vers le mal, vers l’union à Dieu, mais aussi vers la révolte. Il est le nombre des dons réciproques et des antagonismes, celui du destin mystique. » La perfection virtuelle de l’étoile inscrite « peut avorter et ce risque fait de six le nombre de l’épreuve entre le bien et le mal. » Six est le nombre néfaste de l’Apocalypse, il fait référence à Néron le sixième empereur et 666 est le nombre de la Bête.
La dimension néfaste du Six est évidente sur Ouïe : la dame souffre, l’oie chute, les lapins sont sur le point d’être dévorés. Six nous parle d’une séparation de la créature de son Créateur et en effet la dame est séparée de la licorne, sa spiritualité, son lien avec le Créateur. Six nous parle d’épreuve et en effet, perdue, la dame peut se perdre, abandonner sa quête, ou elle peut chercher des ressources nouvelles, une lumière nouvelle qui la ramènera sur le chemin. C’est ce qu’elle fait en sublimant sa souffrance par l’intermédiaire de l’orgue en une mélopée de larmes apaisantes. Portée par une musique spirituelle, la dame retrouve le chemin de l’âme, elle renoue avec la spiritualité, là où elle aurait facilement pu s’abandonner à la haine ou à une tristesse sans retour.
7 - Désir
Sept est la totalité, en référence aux « sept jours de la semaine, aux sept planètes, aux sept degrés de la perfection, aux sept sphères ou degrés célestes, aux sept pétales de la rose, aux sept têtes du naja d’Angkor ». Sept est aussi la totalité de la vie morale, « en additionnant les trois vertus théologales, la foi, l’espérance et la charité, et les quatre vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la justice et la force. » Sept est une totalité en mouvement, à l’image de la Lune, dont le cycle est divisé en quatre périodes de sept jours, en une succession de totalités dans un cycle infini. « Sept indique le sens d’un changement après un cycle accompli. »
Comme le Sept, Désir représente un premier accomplissement, une victoire de la dame sur les sens, sur les pulsions, sur le faucon. La dame est promise à l’expérience du sens du cœur, celui de la caritas chrétienne, autrement dit de la totalité de la vie morale, dont Sept est aussi le symbole. La dame s’apprête à rencontrer Dieu dans l’ascèse et la prière sous la tente, comme le septième jour est celui du pacte entre Dieu et l’homme : le septième jour de la Genèse, Dieu contemple sa création et le septième jour de la semaine l’homme se tourne vers le Seigneur. Au jour du sabbat, la dame s’apprête à renouveler l’Alliance par ses prières sous la tente, selon son seul désir.
Sept n’est pas une fin en soi, il est en mouvement, il ouvre sur une nouveauté. La dame pourrait arrêter son chemin ici, comme les gardiens du temple l’y encouragent, mais le Sept nous invite à lui demander de continuer. C’est ici qu’une faille s’est ouverte ce jour de mon enfance et qu’ensuite le chemin des lapins s’est imposé à moi. Quelque chose me révolte dans ce sens du cœur. C’est un bien qui demande un mal nécessaire pour exercer sa charité, c’est un bien qui vit sur le péché, c’est un bien qui tire sa force du rabaissement des passions de l’âme. L’expérience de Désir est celle d’un équilibre instable, celle d’une dame privée de ses sens, celle d’un cœur séparé de ses passions, celle d’un corps séparé de la nature. Mais voilà, qu’est-on en droit d’espérer après ? « Sept comporte cependant une anxiété par le fait qu’il indique le passage du connu à l’inconnu : un cycle s’est accompli, quel sera le suivant ? »
10 - Goût
Dix était la Tetraktys sacrée des pythagoriciens : la somme des quatre premiers nombres (10 = 1 + 2 + 3 + 4). Dix constitue la pyramide formée de bas en haut par le Quatre de la matrice organisationnelle, le Trois de la trinité, des trois niveaux du monde (céleste, terrestre et infernal), des trois niveaux de l’être (corps, esprit et âme), le Deux de la première manifestation d’Adam et Ève, des ténèbres et de la lumière, et au sommet l’Un, le non manifesté. C’est pourquoi Chevalier nous dit que « (Dix) a le sens de la totalité, de l’achèvement, celui du retour à l’unité, après le développement du cycle des neuf premiers nombres. (…) L’ensemble constitue la décade, ou la totalité de l’univers créé et incréé. » En un mot, Dix est l’harmonie.
Voici la promesse du Dix à la tapisserie de Goût, celle d’une « totalité de l’univers créé et incréé », offerte à celles et à ceux qui oseront quitter le confort du premier accomplissement que figure le Sept de Désir. Ici les opposés s’allient dans la totalité. La dame a quitté sa tente, elle est avec son accompagnante dans un jardin de roses. Elle a libéré le faucon, le gant de fauconnerie indique qu’il reviendra, fidèle. Le lion et la licorne sont victorieux, eux qui s’étaient affrontés sur Toucher, eux qui s’étaient dévêtus pour Désir, ils portent à présent des capes qui volent allègrement au vent du mystère, comme le voile rose bordé de perles de la dame. Contrairement à l’achèvement fragile de Désir, qui tenait à la réclusion de la dame, au renoncement des cinq sens et à l’enchaînement du faucon, celui de Goût est une allégresse inébranlable, la perruche est protégée par le faucon qui chasse la pie, la dame et l’accompagnante sont dans une alcôve défendue par les épines des roses. C’est une totalité en harmonie, unifiant le charnel au spirituel, la raison à la passion, la trinité du corps, de l’esprit et de l’âme. Et que se passe-t-il ici ? La dame, devenue l’initiatrice pour les deux derniers sens, offre une dragée blanche comme l’hostie à la perruche qui déploie ses ailes. Cette étrange dragée, à y voir de plus près, ressemble à une perle et la perruche n’est pas n’importe quel oiseau, elle parle, elle est l’oiseau du verbe. C’est une liturgie bien étrange qui se déroule sous nos yeux.
11 - Vue
Chevalier définit Onze ainsi : « S’ajoutant à la plénitude du dix, qui symbolise un cycle complet, le onze est le signe de l’excès, de la démesure, du débordement, dans quelque ordre que ce soit, incontinence, violence, outrance de jugement ; ce nombre annonce un conflit virtuel. (…) Son ambivalence réside en ceci que l’excès qu’il signifie peut être envisagé, soit comme le début d’un renouvellement, soit comme une rupture et une détérioration du dix, une faille dans l’univers. C’est en ce dernier sens qu’Augustin pourra dire que le nombre onze est l’armoirie du péché. (…) D’une façon générale, ce nombre est celui de l’initiative individuelle, mais s’exerçant sans rapports avec l’harmonie cosmique, par conséquent d’un caractère plutôt défavorable. »
Onze est une faille dans l’univers, un dépassement de la perfection de la création. Onze est un interdit, il prétend s'affranchir des limites de la condition humaine. Onze est un ailleurs, il prétend franchir le seuil du mystère pour se fondre dans la dimension de l’incréé. Onze est un pari, il est un pas dans l’inconnu, dans la promesse de la transcendance. Onze est à la hauteur de Vue, il est le vent qui porte la licorne au-delà, sous l’œil mi-clos de la dame, dans un miroir orné de perles.
40 et 6
Les six tapisseries totalisent quarante lapins. D’après Chevalier, Quarante est « le nombre de l’attente, de la préparation, de l’épreuve ou du châtiment. (…) ce nombre marque l’accomplissement d’un cycle, d’un cycle toutefois qui doit aboutir, non pas à une simple répétition, mais à un changement radical, un passage à un autre ordre d’action et de vie. » Au nombre de quarante, les Tapisseries sont placées sur le Panthéon spirituel, par le nombre de la maturité, les quarante jours et quarante nuits de Moïse sur le Mont Sinaï, les quarante jours qui suivent la Résurrection, les quarante ans de Mahomet recevant la Révélation, ou les quarante ans de Bouddha commençant à prêcher.
Les Tapisseries sont six, le nombre de l’épreuve de la séparation de la créature de son Créateur, qui nous oblige à trouver en nous la force de changer cette épreuve en une lumière qui nous guidera. Souvenons-nous que le chemin de l’âme n’est pas toujours bordé de roses.
Je viens d’interpréter le nombre total de lapins et de tapisseries. L’artiste était-il à ce point génial ? Ou est-ce un cadeau que nous font les nombres ?
La symbolique des nombres


Dans leur édition de La Dame à la Licorne de 2018, [2] Élisabeth Taburet-Delahaye et Béatrice de Chancel-Bardelot nous révèlent la disposition des Tapisseries au château de Boussac d'après les relevés effectués par l’architecte Morin en 1842. [6] Les Tapisseries étaient exposées dans deux pièces adjacentes du premier étage : Toucher, Odorat et Ouïe étaient dans la grand' salle; Cœur, Goût et Vue étaient dans la salle à manger. Cette répartition concorde avec l’ordre indiqué par les lapins. L'ordre concorde aussi en considérant qu'une réception commence dans la grand’ salle pour continuer dans la salle à manger, ce qui place les fenêtres derrière nous.
Imaginons-nous au château, dos aux fenêtres, la grand’salle est à droite et la salle à manger est à gauche, avec les portes jouxtant les fenêtres, ce qui donne la disposition suivante :
En entrant dans la grand' salle, nous verrons Toucher, puis Odorat, puis Ouïe, c'est parfait. En continuant à gauche vers la salle à manger, ce sera Goût, puis Désir, puis Vue, ce qui ne concorde pas. À moins que le miroir indique une interversion, un petit piège, puisque le chemin des lapins serait celui des initiés. Mais honnêtement, je ne peux pas défendre cette idée. Surtout, cette étude de l’ordre des Tapisseries à Boussac pourrait bien s’avérer inutile, puisqu’elles y sont arrivées au XVIIIe siècle. L’ordre a-t-il été respecté dans le déménagement ? Le chemin des lapins était-il déjà perdu ? Il s’agissait tout de même du troisième héritage des Tapisseries qui sont passées des Le Viste aux Robertet, aux La Roche-Aymon, puis aux Rilhac qui les amenèrent à Boussac. Nous voyons sur les plans que la dimension des tapisseries correspond aux encadrements des murs. L’ordre des Tapisseries à Boussac peut donc être le simple fruit du hasard, chaque tapisserie ayant été trouver un emplacement à sa mesure.
La présence tout près d’ici du prince Djim (surnommé Zizim), second fils de Mahomet II, emprisonné à Bourganeuf de 1483 à 1488, a été la source de beaucoup d’excitation et de fantasmes. Il est pourtant assez improbable que des tapisseries d’un tel luxe aient été commandées pour un prisonnier. La présence du prince Djim à Bourganeuf est cependant un indice de la proximité culturelle de l’Orient à l’époque. Rappelons que les Tapisseries sont datées de la toute fin du Moyen Âge, « autour de 1500 », à mon avis entre 1500 et 1515, nous verrons plus loin pourquoi. Lorsque les Tapisseries furent tissées, nous étions au début du brassage culturel de la Renaissance, dans ce qu’il avait de plus brut, les œuvres et les idées nous arrivaient toutes neuves, elles n’étaient pas encore la copie d’une copie. S’il y avait une chose à faire de cette proximité avec l’Orient, ce n’était donc pas dans les signes directs, tels qu’une lune ottomane qui s'avérera être l’héraldique des Le Viste, mais dans la projection mentale, dans la mise en perspective dans l’œil et la pensée de celui ou celle qui venait de découvrir, de s'imbiber de certaines idées, de certaines lectures.
Cette idée de référence à l’Orient vint se mêler à une note que j’ai prise au nombre Sept dans le Chevalier : « sept différentes étapes sur la voie mystique sont symbolisées par Attar, dans son célèbre poème intitulé Le Langage des Oiseaux, par sept vallées : la première est celle de la recherche (talab) ; la deuxième est celle de l’amour (eshq) ; la troisième est celle de la connaissance (ma’rifat) ; la quatrième est celle de l’indépendance (istigna) ; la cinquième est celle de l’unité (tawhid) ; la sixième, celle de l’émerveillement (hayrat) ; et la septième, celle du dénuement (faqr) et de la mort mystique (fanâ). » Bien qu’il y ait une vallée de trop, j’ai pressenti une familiarité entre les sept vallées et les six tapisseries avec « recherche » pour Toucher et le début de la quête, « amour » pour Odorat et la noce, « connaissance » pour Ouïe et l’épreuve, « indépendance » pour Désir et « Mon seul désir » du libre arbitre, « unité » pour Goût et l’harmonie, enfin « émerveillement, dénuement et mort mystique » pour Vue et la transcendance. Alors voici la suite du chemin : le Langage des oiseaux, ou plutôt le Mantic Uttaïr, de Farid Uddin Attar.
La disposition des Tapisseries au château


Cela vous surprendra peut-être que je vous conduise si loin des Tapisseries, en Perse, au XIIe siècle, avec le Mantic Uttaïr puis en des temps bien plus anciens, certainement antéchristiques, avec l’Hymne de la perle. Il y avait plus proche, par exemple le Miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porète ou le Livre des œuvres divines d'Hildegard de Bingen, mais ces œuvres ne me parlaient pas de la même façon, elles ne m’offraient ni les perspectives ni les clés qu’il me fallait pour dévoiler les mystères de Goût et de Vue. C'est de l'emplacement du Mantic et de l'Hymne, de leurs perspectives, que j’ai redécouvert les Tapisseries. Voilà leur apport majeur, leur distance qui montre les constantes, les invariables culturels, humains, spirituels.
C’est d’abord le hasard qui a mis ces œuvres sur mon chemin, pour le Mantic, ça aura été la citation du Chevalier, pour l’Hymne, le film Knight of cups de Terrence Malik. Je les ai souvent recroisées, dans des lectures, dans des émissions, elles me sont vite devenues familières. Elles s’entremêlèrent bien vite avec les Tapisseries, je vis surgir des concordances, et elles se confondirent dans l’écho de mes pas. Ces œuvres parlent toutes deux de transcendance, de dépassement de notre monde pour pénétrer dans l’autre monde, celui où Il réside. Dans le Mantic, l’intermédiaire est un miroir, dans l’Hymne c’est une perle. Un miroir, comme dans Vue et une perle, comme dans Goût, deux artéfacts de la rencontre, de la bascule dans l’autre monde.
Il y a les objets, comme une surface, et il y a le mouvement, la dynamique spirituelle. Le Mantic et l’Hymne nous dévoilent pleinement leur chemin vers la révélation et la transcendance. Ce sont deux histoires fort simples qui dévoilent peu à peu l’audace de leur discours, la quête d’oiseaux à la recherche de leur roi, la quête d’un prince à la recherche de sa perle. Des histoires que l’on conterait volontiers à un enfant, comme on emmène les enfants en visite scolaire voir les Tapisseries. Derrière ces belles histoires se trament la révélation, la manifestation de l’âme, avant la transcendance, la rencontre véritable de Dieu.
Voyage en Perse


C’est au poète persan Farid Uddin Attar que l’on doit, en 1177, le Mantic Uttaïr, une œuvre composée de 4500 distiques et dont le titre est traduit par le Langage des oiseaux (traduction de Joseph Héliodore Garcin de Tassy, que nous citerons ici) [7], le Cantique des oiseaux (traduction de Leili Anvar), ou encore la Conférence des oiseaux (traduction d’Henri Gougaud). Un titre qui fait référence au roi Salomon qui, guidé par la huppe, dira avoir appris d’elle la langue des oiseaux.
Je ne ferai qu’effleurer la surface de l’océan spirituel du Mantic, je ne m’arrêterai pas sur chacune des deux cents paraboles et des soixante discussions, débats et négociations des oiseaux avec la huppe. Nous volerons droit sur les sept vallées de la quête spirituelle jusqu’au Simorg, comme s’il eût été aisé de voler en ces cieux. Il le faut bien, si je compte un jour finir ce livre, et si je compte véritablement laisser aux Tapisseries la place qu’elles méritent.
Attar, « le parfumeur de ce monde » (puisque « attar » signifie « parfumeur » en persan), nous invite à entreprendre la quête mystique, à ne pas nous contenter de Sa connaissance, mais à chercher Sa rencontre. Il nous met en garde, la quête mystique est une quête de l’inaccessible. La plus haute érudition aura pour seul effet d’égarer le disciple, car Dieu est inaccessible aux sens et à la raison. Le disciple perdra son égo au point de se dégoûter de lui-même, de s’anéantir, de ne plus rien être d’autre qu’amour pour Lui. Et si l’amour du disciple pour Lui continue de grandir malgré les mille souffrances de l’anéantissement, alors peut-être, peut-être y aurait-il une chance que Lui, son ami, l’aime en retour : « tu dois connaître Dieu par lui-même, et non par toi ; c’est lui qui ouvre le chemin qui conduit à lui, et non la sagesse humaine. » Pour illustrer ces paroles, ce chemin, Attar nous parle d’oiseaux, ces messagers du ciel.
C’est un monde peuplé d’oiseaux de différentes espèces et de différentes personnalités, qui ont différents plaisirs, différentes spiritualités, qui servent différents maîtres et qui trouvent leur bonheur de différentes façons. Ce sont des oiseaux qui n’ont pas de roi qu’ils aimeraient ensemble. Un jour une huppe vient à leur rencontre et leur révèle qu’il existe, au-delà des sept vallées de la quête spirituelle, un oiseau nommé Simorg, leur roi légitime, celui qui est « près de nous et nous en sommes si éloignés ». La huppe les invite à tout abandonner pour suivre le long chemin des sept vallées. Elle ne leur cache pas que beaucoup abandonneront, que beaucoup se perdront, que beaucoup mourront avant de franchir la septième vallée. Quant à ceux qui y parviendront, blessés, presque morts, ayant souffert mille peines, alors peut-être, peut-être seulement feraient-ils la rencontre de leur roi, de leur ami, le Simorg. Par deux fois les oiseaux refusent de la suivre. D’abord ils disent être déjà comblés, chacun ayant déjà son objet personnel d’amour. La huppe leur répond simplement que le Simorg mérite bien plus d’être aimé. Ils la croient tant elle parle avec justesse, mais après avoir accepté de la suivre, ils se ravisent. Cette fois, ils disent à la huppe toute l’étendue de leurs imperfections et de la bassesse de leurs âmes, eux qui déjà savent se contenter des plaisirs de ce monde. La huppe doit à nouveau les convaincre, chacun leur tour. Ces allocutions puis le chemin des sept vallées sont entrecoupés de deux cents paraboles. Lire le Mantic est incroyablement long, car chaque discours, chaque négociation, chaque parabole mérite que l’on s’arrête pour réfléchir. Les arguments de la huppe sont d’une magnifique éloquence : « À quoi servirait ton âme, si elle n’avait un objet à aimer ? Si tu es un homme, que ton âme ne soit pas sans maîtresse ». L’on ne sait de qui parle la huppe, de Dieu ou du Simorg, elle parle surtout d’ami et d’être aimé. C’est ainsi que mille oiseaux voleront à sa suite sur le chemin des sept vallées de la quête spirituelle.
Le Mantic Uttaïr
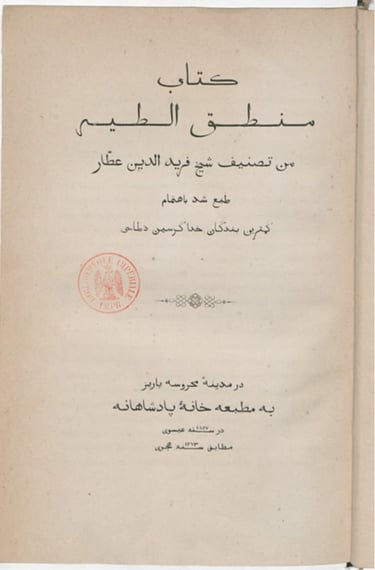
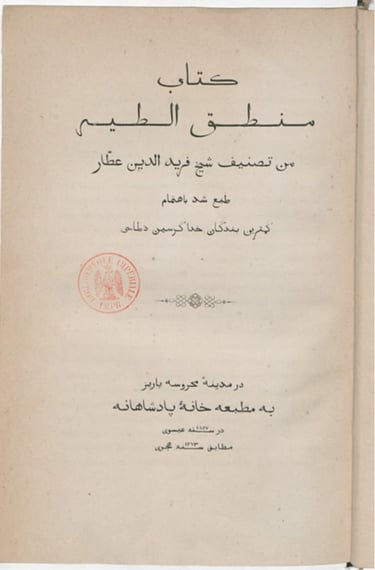
1 - Vallée de la Recherche - Toucher
« Cent choses pénibles t’assailliront sans cesse. À chaque instant tu auras à éprouver en ce lieu cent épreuves ; le perroquet du ciel n’est là qu’une mouche. Il te faudra abandonner en effet tes richesses et te jouer de tout ce que tu possèdes. Il te faudra entrer dans une mare de sang en renonçant à tout ; et quand tu auras la certitude que tu ne possèdes plus rien, il te restera encore à détacher ton cœur de tout ce qui existe. »
Le ton est donné. Nous sommes loin du faste et de l’allégresse de Toucher. Le dépouillement rappelle peut-être le renoncement de Désir, mais il est bien plus radical. En fait, rien dans les Tapisseries ne fera écho à la violence du Mantic. Malgré les fauves enchaînés de Toucher, les prédateurs menaçant les lapins et l’amour qui blesse d’Ouïe, le contact des Tapisseries est d’une douceur inégalable. Le contraste entre les deux œuvres ne fera que croître au long des sept vallées, il sera une différence cruciale. Ces peines sans cesse renouvelées n’empêcheront pas cependant le Mantic de nous conduire en des lieux sublimes, de nous récompenser à la hauteur de nos efforts :
« Lorsque ton cœur sera ainsi sauvé de la perdition, tu verras briller la pure lumière de la majesté divine, et, lorsqu’elle se manifestera à ton esprit, tes désirs se multiplieront à l’infini. Y aurait-il alors du feu sur la route du voyageur spirituel et mille nouvelles vallées plus pénibles à traverser les unes que les autres, que, mû par son amour, il s’engagerait comme un fou dans ces vallées et se précipiterait comme le papillon au milieu de la flamme. Poussé par son délire, il se livrera à la recherche figurée par cette vallée ; il en demandera à son échanson une gorgée. Lorsqu’il aura bu quelques gouttes de ce vin, il oubliera les deux mondes. Submergé dans l’océan de l’immensité, il aura cependant les lèvres sèches, et il ne pourra demander qu’à son propre cœur le secret de l’éternelle beauté. Dans son désir de connaître ce secret, il ne craindra pas les dragons qui cherchent à la dévorer. »
La vallée de la Recherche est un chemin de fougue et de résolution. Le disciple est invité à braver tous les feux et tous les dragons, comme le lion et la licorne qui portent les targes du tournoi, comme la dame qui porte l’étendard chevaleresque.
L’entrée de la vallée, lieu de la violente épreuve et du dépouillement, même s’il est difficile de la concilier avec l’atmosphère de Toucher, est comparable à l’image des fauves entravés. Il faut éteindre la bête pour continuer à avancer et être récompensé par le triomphe de la passion spirituelle. La dame ne semble-t-elle pas voir briller la pure lumière de « sa majesté divine » ? Ne semble-t-elle pas animée de mille désirs ? Ne semble-t-elle pas déterminée à s’engager comme une folle dans le feu de mille nouvelles vallées ? Cet étendard n’a-t-il pas la pointe acérée de Saint Michel pourfendant l’effroyable dragon ? Mais ce n’est pas assez, cette vallée ne suffit pas, cette tapisserie ne suffit pas, elles ne sont qu’une porte qui s’ouvre sur d’autres vallées, d’autres tapisseries, d’autres étapes de la quête.
2. Vallée de l’Amour - Goût
« Pour y entrer il faut se plonger tout à fait dans le feu ; que dis-je ? on doit être soi-même du feu, car autrement on ne pourrait y vivre. L’amant véritable doit être en effet pareil au feu ; il faut qu’il ait le visage enflammé ; qu’il soit brûlant et impétueux comme le feu. Pour aimer il ne faut pas avoir d’arrière-pensée ; il faut être disposé à se jeter volontiers dans le feu de cent mondes ; il ne faut connaître ni la foi ni l’infidélité, n’avoir ni doute ni certitude. Dans ce chemin, il n’y a pas de différence entre le bien et le mal ; avec l’amour, ni le bien ni le mal n’existent plus. »
C’est une déclamation fougueuse, à proprement parler enflammée, qui met à mal la raison en rejetant la foi comme l’infidélité, la certitude comme le doute. Celui qui comprendra pleinement ce passage aura certainement dû mettre au feu sa raison. Il aura agi sans hésiter, comme la dame confiante en sa licorne s’apprête sereinement à prononcer les vœux du mariage. Un mariage spirituel qui devient par l’assise du Quatre la nouvelle matrice morale de la dame. Elle s’en remet aux mains spirituelles et elles seules lui diront ce qui sera bon et ce qui sera mauvais. Voyez l’étendue de la promesse: « L’existence de l’amour est peu à peu complètement détruite par l’ivresse même de l’amour. Si tu possédais la vue spirituelle (du monde invisible), les atomes du monde visible te seraient aussi dévoilés ; mais si tu regardes avec l’œil de l’intelligence (humaine), tu ne comprendras jamais comme il faut l’amour. » Quelle promesse ! Celle d’un amour tel qu’il changera toute chose en sa véritable nature spirituelle.
Et voici comment s’achève la vallée : « Dans cette vallée, l’amour est représenté par le feu, et sa fumée c’est la raison. Lorsque l’amour vient, la raison fuit au plus vite. La raison ne peut cohabiter avec la folie de l’amour ; l’amour n’a rien à faire avec la raison humaine ». Le lion de la raison a perdu devant l’amour de la dame pour la licorne spirituelle. Il y a bien quelque chose de l’éblouissement et du fanatisme dans ce vœu sans retour qui abandonne toutes autres choses aux flammes. Qu’adviendrait-il si l’amour venait à nous quitter, si l’élan mystique venait à faiblir ?
3. Vallée de la Connaissance - Ouïe
Cette vallée n’a ni commencement ni fin, elle est un labyrinthe : « La connaissance spirituelle a là différentes faces. Les uns ont trouvé le mihrab [dans la mosquée, le mihrab est la niche orientée vers La Mecque], les autres l’idole. » Cette vallée est une épreuve. Le disciple, perdu, doit retrouver lui-même le chemin spirituel. N’est-ce pas justement ce qui se joue sur Ouïe ? La dame, dans l’épreuve de l’adultère, de l’amour qui blesse, du désert spirituel, trouve en elle-même la force de changer sa douleur en une mélodie qui élève son âme. Comme l’indique le Six, c’est une épreuve qui aurait pu échouer, la dame aurait pu sombrer dans la haine, sur le versant néfaste du Six et, en répondant au mal par le mal, s’écarter de la voie spirituelle.
Voici la récompense offerte à celui qui triomphera de l’épreuve : « Quand le mystère de l’essence des êtres se montrera clairement à lui, la fournaise du monde deviendra un jardin de fleurs. L’adepte verra l’amande bien qu’entourée de sa pellicule. Il ne se verra plus lui-même, il n’apercevra que son ami ; dans tout ce qu’il verra, il verra sa face ; dans chaque atome il verra le tout ; il contemplera sous le voile des millions de secrets aussi brillants que le soleil. Mais combien d’individus ne se sont pas perdus dans cette recherche pour un seul qui a pu découvrir ces mystères ? Il faut être parfait si l’on veut franchir cette route difficile et se plonger dans cet océan orageux ».
C'est une fabuleuse transformation de lui-même qui attend le disciple, doué d’une perception nouvelle, d’un sixième sens. Il percevra l’essence du monde, il verra même son âme, puisque par ami il s’entend Dieu et voir Dieu en soi, selon le Mantic, c’est voir son âme dans laquelle est Dieu. Il verra scintiller les secrets de derrière le voile sur la face du mystère. Dans quelle mesure cet extrait s’applique-t-il aux Tapisseries ? Jusqu’à quel point partagent-elles les mêmes mécanismes que le Mantic ? Il y a bien sûr cette perception nouvelle, ce sixième sens, comme le sens du cœur de « Mon seul désir ». Il y a une résonance entre la perception de l’essence des choses, du tout dans l’un, avec le monde des Idées de Platon auquel est rattaché ce sens du cœur. Dans la vue de sa propre âme et des lumières derrière le voile, il y a de l’extase qui récompense la piété et les prières sous la tente de « Mon seul désir ». L’issue de la vallée de la Connaissance nous a conduits tout droit, comme le fait Ouïe, au cœur de Désir.
4. Vallée de l’Indépendance - Désir
Les noms concordent, indépendance rime avec libre arbitre. La vallée de l’Indépendance est « La vallée où il n’y a ni prétention à avoir ni sens spirituel à découvrir. De cette disposition de l’âme à l’indépendance il s’élève un vent froid dont la violence ravage en un instant un espace immense. » Un dénuement, comme la dame qui se libère de l’illusion des sens, mais un dénuement si intense, si brut, qu’il nous éloigne de l’ambiance des Tapisseries. « Les sept océans ne sont plus alors qu’une simple mare d’eau ; les sept planètes, qu’une étincelle ; les sept cieux, qu’un cadavre ; les sept enfers, de la glace brisée. » Relevons déjà cet indice, cette concordance avec Désir, le Sept de l’achèvement qui ouvre sur un renouveau.
Alors que le dénuement de Désir permet à la dame d’agir selon sa seule volonté, son seul désir, le dénuement de la vallée de l’Indépendance conduit à l’anéantissement de toute action et de toute volonté : « Ici ni ce qui est nouveau ni ce qui est ancien n’a de valeur ; tu peux agir ou ne pas agir. » La faille entre les Tapisseries et les vallées continue de s’élargir. Les vallées exigent du disciple d’anéantir toujours plus, ce sont sept océans et sept planètes qui doivent sombrer, là où les Tapisseries proposent une fuite dans ce qui est tout proche. Comme disent les alchimistes, « l’or est dans la poussière du chemin ».
5. Vallée de l’Unité - Goût
À nouveau, les noms concordent, unité rime avec harmonie. Cependant l’unité de la vallée n’est pas celle d’une synergie unifiante, elle est celle de la masse colossale, dense, constituée par la fonte de toutes les limites, des parties comme des tout, de toutes les identités :
« Du dépouillement de toutes choses et de leur unification. Tous ceux qui lèvent la tête dans ce désert la tirent d’un même collet. Quoique tu voies beaucoup d’individus, il n’y en a en réalité qu’un petit nombre ; que dis-je ? il n’y en a qu’un seul. Comme cette quantité de personnes n’en fait vraiment qu’une, celle-ci est complète dans son unité. »
Sur le chemin spirituel du Mantic, cette fonte dans l’unité est essentielle, c’est en elle que s’opérera la rencontre, en une âme collective, la daena persane : « La partie deviendra le tout, ou plutôt elle ne sera ni partie ni tout (…) L’être que j’annonce n’existe pas isolément ; tout le monde est cet être ; existence ou néant, c’est toujours cet être. »
6. Vallée de l’Étonnement, vallée du Dénuement et de la Mort - Vue
La vallée de l’Étonnement est celle « où l’on est en proie à la tristesse et aux gémissements. Là, les soupirs sont comme des épées, et chaque souffle est une amère plainte. Ce ne sont que lamentations, que douleurs, qu’ardeur brûlante ; c’est à la fois le jour et la nuit, et ce n’est ni le jour ni la nuit. » Seul le disciple pleinement consentant à sa fonte dans l’unité saura franchir la vallée de l’Étonnement : « Comment, dans son étonnement, l’homme pourra-t-il avancer jusqu’en cet endroit ? Il restera stupéfait et se perdra dans ce chemin. Mais celui qui a l’unité gravée dans le cœur oublie tout et s’oublie lui-même. » Ces dernières vallées me terrifient, elles me rappellent avec nostalgie la douceur de la dame de Vue, son regard, sa caresse.
La septième vallée est celle du Dénuement et de la Mort :
« Dont il est impossible de faire l’exacte description. Ce qu’on peut considérer comme l’essence de cette vallée, c’est l’oubli, le mutisme, la surdité et l’évanouissement. Là tu vois disparaître, par un seul rayon du soleil spirituel, les milliers d’ombres éternelles qui t’entouraient. (…) S’il lui est jamais permis de revenir de cet anéantissement, il connaîtra ce que c’est que la création, et bien des secrets lui seront dévoilés. »
Voici la récompense de celui qui reviendra de l’anéantissement, de la fonte dans le néant : la révélation des secrets de la création, de la connaissance du monde antérieur à la manifestation, de ce qui se trame dans l’autre monde. Le chemin des sept vallées a beau être radical en comparaison à celui des Tapisseries, l'objectif est identique : l’expérience du surnaturel, du sur-naturel (de la sur-nature chère à Pierre Gordon), ce qui est au-dessus de l’ordre naturel, l’expérience de l’autre monde. C’est le dépassement de Vue par la bascule dans le reflet sous l’œil mi-clos de la dame, dépassement de l’ordre cosmique qu’indique également le Onze. Du dénuement il y en a, bien sûr, sur Vue, le lion et la licorne sont nus, les animaux sont à l’écart, l’ambiance est solennelle. Et il y a de la mort, puisqu’une initiation est une mort, antérieur à une renaissance spirituelle, à une renaissance dans le spirituel.
Sept vallées comme six tapisseries ?
Nous avons plusieurs fois évoqué la différence de forme, d’ambiance, entre la violente pénitence des vallées et la douceur onirique des tapisseries. Il y a cependant une trame semblable, la fougue de la rencontre du disciple avec la voie spirituelle (vallée de la Recherche - Toucher), puis l’engagement entier, la confiance absolue dans cette voie (vallée de l’Amour - Odorat), ensuite la mise à l’épreuve du disciple contraint de retrouver la voie spirituelle par lui-même et en lui-même (vallée de la Connaissance - Ouïe). Les vallées suivantes (de la Connaissance, de l’Unité, de l’Étonnement, du Dénuement et de la Mort) marquent la divergence du chemin du Mantic d’avec celui des Tapisseries. Dans le premier chemin le disciple perd son égo, il se fond dans l’océan de la totalité, dans le second la dame se surpasse et devient l’initiatrice. Mais la finalité est identique, parvenir à la transcendance, pénétrer dans l’autre monde.
Quel soulagement ! Les Tapisseries ne sont pas seules, je leur ai trouvé une famille, une patrie. Attar fait preuve d’un talent sans égal pour mettre en mots la quête mystique, la quête qui ne se satisfait pas d’une connaissance de Dieu, mais qui a l’audace du dépassement dans le souhait intense d’être aimé de Lui, dans une rencontre de Lui par lui-même et en nous-même. Voici pour les profondeurs. En surface, le Mantic et les Tapisseries partagent quelques points communs, trois surtout : le faucon, l’âme et le miroir.
Les sept vallées de la quête spirituelle


Rappelons-nous du rôle du faucon dans les Tapisseries : d’abord, il séduit l’oie (la dame) sur Toucher ; il la chasse et l’oie chute sur Ouïe, c’est l’amour qui blesse de Perceval s’oubliant devant trois gouttes de sang sur la neige; il est enchaîné sur Désir, la dame se libère au prix de la captivité de l’amant; et il est libéré sur Goût, uni à la dame par l’art de confiance de la fauconnerie, en son nom il chasse la pie, il protège le prodige, la dame offre à la perruche la précieuse dragée, à moins que ce soit une perle...
Il y a trois faucons dans le Mantic. Le premier, le faucon royal, reçoit une curieuse mission : « Attache à ta patte la lettre de l’amour éternel, mais ne la décachette pas jusqu’à l’éternité. » Le second faucon, alors qu’il s’est révolté contre son maître, est sommé par la huppe de la façon suivante : « Ôte ton chaperon, regarde librement, et, lorsque tu te seras dégagé des deux mondes, tu te reposeras sur la main d’Alexandre. » La huppe interprète le commandement ainsi : il faut d’abord se libérer pour choisir son véritable maître. Le troisième faucon venait, sans initiation préalable, « dévoiler le secret des mystères » aux oiseaux. Son roi l’envoie chasser avant de le reprendre sur son bras, le faucon est heureux de vivre ainsi tout proche de son souverain. La huppe lui répond qu’un vrai roi est sans égal et qu’il devrait être impossible de s’en approcher sans se brûler, et que le Simorg ne se laisse pas approcher à moins de nous être d’abord anéanti.
Le faucon


La perle et le miroir sont au centre des deux dernières tapisseries, celles qui dépassent la totalité de Désir. Alors que la dame fait elle-même l’expérience des quatre premiers sens (en comptant le sens du cœur), elle révèle le goût à la perruche et la vue à la licorne.
C’est peut-être la plus grande liberté que je prends dans mon interprétation des Tapisseries, la prémisse la plus fragile de mon raisonnement, la carte la plus glissante du château : j’assimile la dragée de Goût à une perle et cette perle à l’âme, comme trois degrés de lecture de l’œuvre : littéral (la dragée), allégorique (la perle) et spirituel (l’âme). Ici je pourrais me défausser sur Jacqueline Kelen, c’est elle qui m’a soufflé ces degrés de lecture de la dragée, dans Les floraisons intérieures. J’ai été bien facile à convaincre que ce ne puissent être de banales dragées que la servante présente à sa dame dans un calice. La perruche tiendrait une dragée dans son bec pour la croquer au lieu de la garder précieusement entre ses griffes. Surtout, d’une rondeur et d’une blancheur parfaites, elles sont représentées de la même façon que les perles qui bordent le voile de la dame. Et s’il n’y avait à voir que l’immense calice, le ciboire, hors de son contexte, nul doute que nous reconnaîtrions une centaine de perles. Si l’on accepte qu’allégoriquement la dame fait le don d’une perle à la perruche, et non le don d’une dragée, d’une friandise, si la première partie est acceptée, alors la suite, le symbole de l’âme, est inévitable. C’est Chevalier lui-même qui le dit. La perle, cette pureté née de concrétion à partir d’une crasse, d’un grain de sable, qui grandit et se manifeste dans le cœur fermé de l’huître, est un magnifique symbole de l’âme, ce fragment divin au cœur de chacun d’entre nous.
Le mot « perle » apparaît une dizaine de fois dans le Mantic, malheureusement pas en référence à l’âme, mais en référence à la richesse, associée à la soie, à l’or ou aux diamants. Il est aussi question de perle dans l’Épilogue :
« J’ai répandu les perles de l’océan de la contemplation ; je m’en suis parfaitement acquitté, et mon livre en est la preuve ; mais si je me louais trop moi-même, quelqu’un approuverait-il l’éloge que je ferais de moi ? (…) Je resterai, sinon par moi-même, du moins par les perles poétiques que j’ai répandues sur la tête des hommes, jusqu’à la résurrection. J’ai laissé un souvenir sur la langue des mortels jusqu’au jour du compte, et mon livre sera ce souvenir. »
Attar parle du trésor, du nectar, de la manifestation la plus pure, les perles coulant comme les centaines de paraboles et de discours métaphoriques du Mantic. À mon regret, le Mantic ne considère pas que la perle symbolise l’âme, il préfère utiliser un autre symbole, le miroir. Il y a cependant une perle centrale, puisque Farid (prénom d’Attar) signifie perle en iranien.
Le thème de l’âme est le cœur même du Mantic. L’âme contient Dieu : « L’âme est cachée dans l’homme et tu es caché dans l’âme. Ô toi qui es caché dans ce qui est caché ! ô âme de l’âme ! tu es plus que tout et avant tout. Tout se voit par toi et on te voit en toute chose. » L’idée paraît d’abord insaisissable, un Dieu morcelé en autant d’âmes qu’il y a d’hommes. Mais pour Attar ce morcellement n’est qu’apparence, que tromperie de l’égo. Celui qui atteindra l’anéantissement dans l’unité saura que les âmes ne sont qu’une et qu’il n’y a qu’un amour. Attar parvient presque à nous représenter la nature de l’âme. Qui y parviendrait ? Il s’en approche cependant par trois représentations.
La première représentation de l’âme est le dessin de la plume :
« Chose étonnante ! Ce qui concerne le Simorg commença à se manifester en Chine au milieu de la nuit. Une de ses plumes tomba donc alors en Chine, et sa réputation remplit tout le monde. Chacun prit le dessin de cette plume, et quiconque la vit prit à cœur l’affaire. Cette plume est actuellement dans la salle des peintures de la Chine, et c’est pour cela que le Prophète a dit : « Allez à la recherche de la science, fut-elle à la Chine ». Si la manifestation de cette plume du Simorg n’eût pas eu lieu, il n’y aurait pas eu tant de bruit dans le monde au sujet de cet être mystérieux. Cette trace de son existence est un gage de sa gloire ; toutes les âmes portent la trace du dessin de cette plume. »
C’est la signature divine. De copie en copie de la plume, comme nous sommes les enfants des enfants du premier des hommes, le premier témoin de Dieu, nous portons tous la signature divine. C’est une promesse faite pareillement à chacun de nous. Alors celui qui saura regarder dans son âme et qui saura lire l’image de l’image, aura la trace de Son passage, la certitude de Son existence.
La seconde représentation de l’âme est le talisman :
« Bien des gens connaissent la surface de cet océan ; mais ils en ignorent la profondeur. Or il y a un trésor dans cette profondeur, et le monde visible est le talisman qui le protège ; mais ce talisman des entraves corporelles sera enfin brisé. Tu trouveras le trésor quand le talisman aura disparu ; l’âme se manifestera quand le corps sera mis à l’écart. Mais ton âme est un autre talisman ; elle est pour ce mystère une autre substance. »
Attar laisse planer une ambiguïté sur la définition du terme de talisman, il nous indique cependant qu’il en existe deux formes, le talisman qu’est le corps qui occulte et le talisman qu’est l’âme qui révèle. D’après le Littré [8], « talisman » vient de l’arabe « telsam » qui signifie « figure magique, horoscope ». C’est déroutant, pourquoi l’âme, de nature divine, devrait-elle être magique ? Littré nous indique ensuite que le talisman est une pierre ou un objet métallique sur lequel sont gravées des figures ou des caractères qui ont des propriétés extraordinaires « suivant la constellation sous laquelle ils ont été gravés ». Nous revenons à la signature, à la copie du dessin de la plume, la trace de Son existence. La réaction qui s’opère dans notre âme serait-elle la découverte de la signature divine ? Ou l’opération magique serait la rencontre de Dieu lui-même ? Alors, l’âme est-elle la preuve de Son existence, la clé de la rencontre ou le lieu de Sa rencontre ? Elle est les trois, comme nous allons le voir avec la troisième représentation de l’âme : le miroir.
La perle et l’âme


À l’issue des sept vallées, il sera impossible d’avancer. Il restera trente oiseaux, ou plutôt ce qu’il restera de trente oiseaux. Ils auront tant brûlé d’amour pour leur ami qu’il ne restera pas un cheveu d’eux-mêmes, il ne restera que cendre, il ne restera même que cendre de cendre. Alors viendra un chambellan qui, au nom du Simorg, leur refusera l’entrée. Les oiseaux lui répondront qu’obtenir une réponse de la majesté suprême, même s’il doit s’agir d’un refus, c’est déjà être comblé d’honneurs. Ainsi vient l’instant de la rencontre :
« Le chambellan de la grâce leur ouvrit la porte, puis il ouvrit encore cent rideaux, les uns après les autres. Alors un monde nouveau se présenta sans voile à ces oiseaux : la plus vive lumière éclaira cette manifestation. (…) Le soleil de la proximité darda sur eux ses rayons, et leur âme en fut resplendissante. Alors dans le reflet de leur visage ces trente oiseaux (sî morg signifie trente oiseaux) mondains contemplèrent la face du Simorg spirituel. Ils se hâtèrent de regarder ce Simorg, et ils s’assurèrent qu’il n’était autre que sî morg. Tous tombèrent alors dans la stupéfaction ; ils ignoraient s’ils étaient restés eux-mêmes ou s’ils étaient devenus le Simorg. Ils s’assurèrent enfin qu’ils étaient véritablement le Simorg et que le Simorg était réellement les trente oiseaux (sî morg). Lorsqu’ils regardaient du côté du Simorg ils voyaient que c’était bien le Simorg qui était en cet endroit, et, s’ils portaient leurs regards vers eux-mêmes, ils voyaient qu’eux-mêmes étaient le Simorg. Enfin, s’ils regardaient à la fois des deux côtés, ils s’assuraient qu’eux et le Simorg ne formaient en réalité qu’un seul être, ce seul être était Simorg, et Simorg était cet être. Personne dans le monde n’entendit jamais rien de pareil. Alors ils furent tous plongés dans l’ébahissement, et ils se livrèrent à la méditation sans pouvoir méditer. Comme ils ne comprenaient rien à cet état de choses, ils interrogèrent le Simorg sans se servir de la langue ; ils lui demandèrent de leur dévoiler le grand secret, de leur donner la solution du mystère de la pluralité et de l’unité des êtres. Alors le Simorg leur fit, sans se servir non plus de la langue, cette réponse : « Le soleil de ma majesté, dit-il, est un miroir ; celui qui vient s’y voit dedans, il y voit son âme et son corps, il s’y voit tout entier. » »
Les oiseaux franchissent le seuil et rencontrent le Simorg qui est l’immense miroir constitué de leurs trente âmes réunies. Comment cela fonctionne ? Nous ne pouvons le comprendre, il n’y a jamais rien eu de semblable, il n’y a pas de mots pour le dire. Le miroir, tout de même ! Quelle fantastique émotion j’ai eue quand à l’issue des sept vallées j’ai découvert que le Simorg était le miroir de l’âme ! Comme sur Vue, le miroir reflète l’âme et nous la révèle. Le Mantic ajoute que l’âme est aussi le miroir lui-même.
La rencontre du Simorg, le reflet du miroir des âmes réunies de trente oiseaux, est le point culminant du Mantic. Attar avait en réalité déjà parlé de miroir : « par excès de bonté, il a fait un miroir pour s’y réfléchir. Le miroir, c’est le cœur. Regarde dans le cœur et tu y verras son image. » et « Si tu chéris la beauté de ton ami, sache que ton cœur en est le miroir. Prends ton cœur et contemples-y sa beauté ; fais de ton âme un miroir pour y voir l’éclat (de Dieu). » Le cœur, l’âme, est à la fois le talisman en tant que clé qui ouvre, qui dévoile le mystère, et le talisman en tant que lieu de la rencontre, sous la forme d’un miroir dans lequel se reflète l’éclat de Dieu. Pour voir l’éclat de Dieu dans le miroir, il faut avoir perdu son égo, il faut avoir éteint jusqu’à sa dernière lumière, il faut avoir éteint son égo, pour révéler ce qui brille en nous, l’étincelle de Dieu cachée dans l’âme.
Pour revenir aux Tapisseries, nous pouvons dire que la perle et le miroir représentent deux dimensions de l’âme. La perle est la manifestation de l’âme, sa révélation, son expérience individuelle. Elle est la preuve de l’existence de l’âme, la foi absolue, pure, la prémisse indispensable, la clé de la rencontre. Le miroir projette l’âme sur un monde vu à sa propre lumière. Et celui qui regardera le reflet de l’âme dans le miroir, dans un jeu de perspectives de l’âme dans l’âme, sera allé à la rencontre de Dieu. Dans les Tapisseries, c’est un miroir orné de perles que la dame présente à la licorne, l’artéfact le plus parfait. Cette lecture bien ficelée laisse cependant de côté l’essentiel, la dame, et son regard, qui sont d’évidence indispensables à la bascule dans l’autre monde.
Le miroir


Il est tentant de faire entrer les Tapisseries dans des cadres établis, de contraindre la dame à suivre le chemin des sept vallées. Ce serait une erreur, évidemment. Avant tout, il y a cette intuition que ce que nous disent les Tapisseries, nulle autre œuvre ne nous l’a dit, du moins avec cette acuité.Il faut aussi tenir compte des circonstances, des cultures. Je ne me réfère qu’à un fragment du Mantic, j’ai laissé de côté plus d'une centaine de discours et de paraboles, de discours d'Attar, tant de références religieuses, dogmatiques. Le Mantic se réclame de l'universel, il est cependant de notre monde, d'une expression particulière de la mystique, le soufisme. Les Tapisseries ne peuvent s’expliquer par la mystique qu’à condition de l'aborder dans sa dimension la plus intrinsèque, la plus universelle, pour leur laisser ce qui leur appartient, leur atmosphère, leur vision, leur culture. Nous avons toutefois besoin de parents, de compatriotes, d’exemples, d’ambiances propices à leur compréhension, et là est la place du Mantic, un exemple de chemin sacré sans prêtre ni église, un exemple de spiritualité intérieure. J’aimerais dépasser la mystique, dépasser la marche de la manifestation vers la rencontre de Dieu, j’aimerais laisser les Tapisseries nous parler d’elles-mêmes.
Les Tapisseries et le Mantic se distinguent par l'atmosphère terrifiante qui règne sur l'œuvre d’Attar. Les sept vallées sont battues par des vents violents, les oiseaux doivent brûler leur corps, brûler tout ce qu’ils possèdent, perdre la raison, perdre l'égo, se fondre dans l’unité, afin de peut-être rencontrer le Simorg dans le miroir de leurs âmes réunies. Le Mantic nous met en garde contre toute joie, contre tout plaisir. Dans la parabole Reproche de Dieu à un sofi, un sofi est retiré depuis quarante ans dans l’adoration de Dieu (en référence au Quarante de la maturité spirituelle) lorsqu’un jour il trouve du charme dans le chant d’un oiseau qui « était doux, ses accents étaient agréables ; il y avait cent secrets dans chacune de ses notes. » Et alors que le sofi s’oublie dans la joie, Dieu lui reproche son infidélité.
Les Tapisseries n’en sont que plus belles, d’une allégresse onirique. Quel plaisir de les retrouver, majestueuses et accueillantes. Chaque tissage est là pour nous parler, ce sont chaque fois de nouvelles merveilles qui accueillent notre regard. Elles ne nous demandent pas de nous dégoûter de nous-même, elles nous invitent à aimer la fleur, l’oiseau, la robe, les capes au vent. Les Tapisseries vibrent au vent de l’amour, que ce soit l’amour d’un oiseau, d’une femme ou d’une perle, l’amour est un, il est une manifestation commune de l’âme. L’amour de Dieu ne se trouve pas dans le désamour du monde. Les Tapisseries nous invitent à tout contempler, c’est même de cette contemplation que naît le sentiment, l’envie de voir plus et le regard est conduit peu à peu au mystère. Ce mystère, j’espère en être un petit peu l’exégète, en souvenir de la fascination d’un jour d’enfance. Les Tapisseries ne nous demandent pas de nous fondre dans l'âme collective, mais elles ne nous abandonnent pas.
Le Mantic nous promet que l’objet de notre amour nous aimera en retour. Parlant d’amour, quel amour plus naturel que celui de l'autre, d'un homme, d'une femme, d’une dame ? C’est une dame qui, sur le chemin des Tapisseries, nous accordera son amour en retour, nous fera le don de la perle, nous prendra sur elle et, nous caressant doucement la crinière, nous accompagnera dans l’au-delà du miroir. Il nous reste du travail pour décrypter, pour vivre les deux dernières scènes. Nous avons émis des hypothèses, la perle de la manifestation de l'âme, le miroir de la rencontre, mais il faut laisser les Tapisseries nous parler dans leur propre langage, nous dire si elles sont d'accord, et comment opèrent ces puissances mystérieuses dans les mains de la dame.
Une dernière chose. Là où le Mantic nous conduit, Attar lui-même ne sait trop nous dire ce qui suit, après la mort spirituelle et la renaissance dans le miroir de l’âme collective. Comment survivre à l’illumination ? C’est un défi. C'est certainement le pourquoi des poètes maudits, du renoncement de Rimbaud et de la folie de Nerval, eux qui ont conduit le verbe à son au-delà. Attar nous promet d’écrire un nouveau livre consacré à la question. Concernant les Tapisseries, je sens qu’elles nous garantissent un après. Je pense qu'elles fonctionnent comme un jeu de l'oie, avec ses retours en arrière, ses échelles et ses puits, ses retours à la case départ. Il faut reprendre le chemin, j’espère depuis l’audace de Toucher, ou de la confiance d’Odorat, mais souvent ce sera Ouïe, le désert de la foi qui suit les grandes contemplations. Retrouver le chemin, sans cesse, garder l’espoir, passer par l’ascèse de Désir pour parvenir à l’harmonie de Goût et alors, au plus inattendu, viendra la révélation, avec la perle. Peut-être qu’ensuite la rencontre dans le miroir sera fulgurante, avant de chuter, oubliant notre patrie céleste, gardant en notre cœur la nostalgie de la lumière et la souffrance de l’exil. Reviendra l'envie, la soif, puis l'équilibre, l'oscillation, avant de basculer à nouveau.
Conclusion sur le Mantic Uttaïr
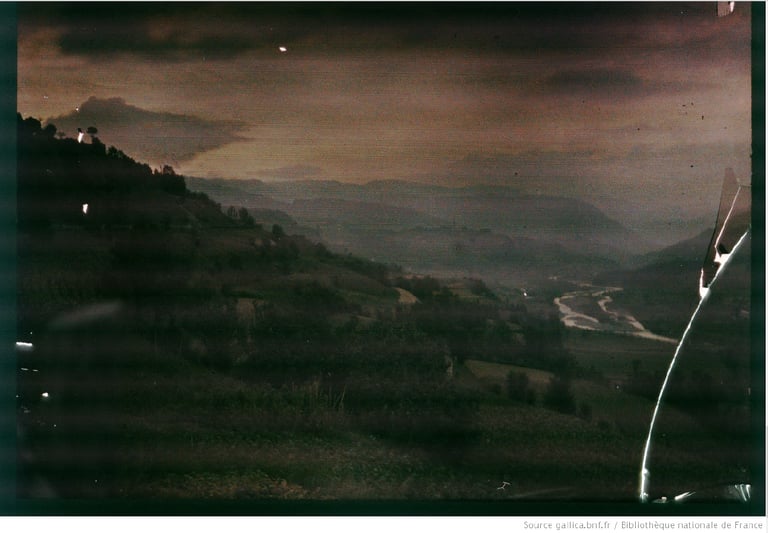

Revoyons la scène de Goût : dans la sérénité de l’harmonie des contraires, la dame offre une perle à la perruche. La licorne regarde en dehors de la tapisserie, vers la suite, vers Vue où avec la dame elles basculeront ensemble, au-delà. Quel est ce don précieux que la dame, libérée par Désir, est en train de faire à la perruche ? La perle est cette impureté, ce grain de sable, cette crasse qui dans le cœur fermé de l’huître se couvre de nacre et lentement se sublime. Dire que la perle est un symbole de l’âme ne nous avance pas dans la compréhension de l’âme. Qu’appelons-nous l’âme ? L’âme perle, manifestation de la perfection de l’ineffable, perd de sa pureté à l’épreuve des mots. Tel est le symbole, par lui-même signifiant. Nous pouvons toutefois nous aider d’ambiances et de récits. Au sujet de la perle de l’âme, l’évidence nous conduit à l’Hymne de la perle.
La version syriaque de l’Hymne de la perle (également traduit Chant de la perle) est datée de 936 après J-C. Il semble toutefois qu’à quelques détails près, le récit remonte à l’époque Parthe (au plus tard 226 après J-C) et on en trouve une version dans les Actes de Thomas (Évangile apocryphe d’origine présumée syrienne du début du IIIe siècle). En tant que mythe, elle pourrait même être plus ancienne encore, anté-christique. Je vous encourage à lire la version de l’Hymne traduite par Jacques-Étienne Ménard et publiée dans la Revue des sciences religieuses en 1968 [9], plus poétique que la version des Actes de Thomas publiée à la Pléiade. L’analyse de l’œuvre en préface et les notes de Ménard sont un véritable ouvrage en elles-mêmes, de véritables mines d’or creusées dans les profondeurs du mystère. L’auteur supposé de l’Hymne est l’apôtre Jude Thomas, qui l’aurait écrite étant emprisonné aux Indes. La version des Actes de Thomas serait donc l’originale, mais l’Hymne, en tant que mythe, a plus d’un auteur, elle a vécu plusieurs vies avant d’être arrêtée par l’écriture, elle a réuni ce qui se trouvait de plus profond, de plus intime, parmi ces générations d’âmes descendant d’Alexandrie.
Comme le Mantic, l’Hymne a ce don troublant de saisir par les mots ce dont la nature est de nous échapper. L’Hymne est une histoire fabuleuse écrite à la première personne, un poème de cent cinq vers que je vous invite à lire et à relire pour l’avoir tout entier à l’esprit, comme une image, sans début ni fin. Lisant l’Hymne, nous devenons fils de roi nous-même, ou plutôt nous nous souvenons que nous sommes fils de roi, nous nous souvenons de notre mission sur cette terre, ce pays de l’exil, et que cette mission est écrite dans notre cœur, sous la forme d’une entente passée avec nos parents célestes. Lire l’Hymne c’est entendre le cri de l’aigle qui tire du profond sommeil. L’Hymne, comme la gnose, combine le médium et le message, le signifiant et le signifié.
L’Hymne est l’histoire d’un prince qui, alors qu’il est encore enfant et qu’il vit dans la joie et les richesses du Royaume de son père, doit quitter sa région de l’Orient à la demande de ses parents qui concluent avec lui une entente qu’ils écrivent dans son cœur. Le prince a pour mission de descendre au fond de l’Égypte et d’en rapporter l’unique perle, cachée au fond de la mer sous la garde du serpent qui écume. En récompense il pourra revêtir son manteau resplendissant et sa toge, et avec son frère il héritera du Royaume. Le prince descend jusqu’en Égypte en passant par le port de Mésène, puis les villes de Babel et de Sarbūg. Il s’établit en Égypte où il attend que le serpent s’endorme. Il revêt les vêtements des Égyptiens pour éviter qu’ils ne le découvrent et qu’ils n’excitent le serpent contre lui. Cependant les Égyptiens le découvrent, peut-être par la dénonciation d’un noble « oint d’Orient » à qui le prince s’est confié. Ils le lient à leurs perfidies et ils lui font manger de leur repas. Le prince en oublie qu’il est fils de roi, il en oublie la perle, et sombre dans un profond sommeil.
Témoins de ses mésaventures, ses parents et tous les rois d’Orient lui écrivent une lettre lui rappelant son ascendance royale et sa mission ici-bas. La lettre prend la forme d’un aigle qui se pose près de lui. La lettre se fait parole et « à la voix de son cri », le prince se réveille et se lève de son sommeil. Il défait le sceau de la lettre, la lit et constate qu’elle dit vrai, qu’elle est identique à l’entente gravée dans son cœur. Il se souvient qu’il est fils de roi et de l’entente passée avec ses parents. Il pratique des rites magiques pour endormir le serpent en prononçant les noms de son père, de son jumeau et de sa mère. Après s’être emparé de sa perle, il remonte vers le Royaume, guidé par la lumière de la lettre. Il revêt le vêtement royal qui lui ressemble comme un miroir, avec lequel il ne fait qu’un, comme les serviteurs ne font qu’un, car ils portent le sceau du Roi des Rois. La remontée, il s’entend aux Cieux, se fait par le contact du plus dévoué des serviteurs. Cette remontée ne peut se résumer et je n’ai d’autre choix que de citer entièrement cette cinquième partie du poème, La remontée :
« Et je vis en plus que tout en lui
était secoué par les mouvements de ma connaissance,
et comme à parler,
je vis aussi qu’il s’apprêtait.
J’entendis le son de ses mélodies
que dans sa descente il murmurait :
« C’est moi le plus dévoué des serviteurs
que l’on a dressé au service de mon Père,
j’ai senti aussi en moi
que ma stature, comme ses œuvres, a grandi. »
Et dans ses élans royaux
il tend de tout son être vers moi
et dans la main de ses donateurs
se précipite pour que je le prenne ;
et mon amour me presse
de courir à sa rencontre et de le recevoir.
Je tendis (mon corps) et le reçus,
je me parai de la beauté de ses couleurs,
et ma toge miroitante de couleurs,
je me vêtis tout entier d’elle tout entière.
Je l’endossai et je suis remonté
à la porte du salut et de l’adoration.
Je courbai la tête et j’adorai
la splendeur de mon Père qui l’avait envoyé vers moi,
dont j’avais suivi les ordres,
comme il avait accompli ce qu’il avait promis.
A la porte de ses satrapes
je me mêlai à ses Grands ;
car il se réjouit à mon sujet et me reçut
et j’étais avec lui dans son Royaume,
et dans l’invocation de son trône
tous ses serviteurs l’acclamaient,
parce qu’il m’avait promis
de (re) venir avec lui à la porte du Roi des Rois,
et avec l’offrande de ma perle
de paraître avec lui devant notre Roi. »
L'Hymne de la perle


L’Hymne est une pure expression du sentiment gnostique. La gnose, cette religion qui avait perdu ses textes sacrés avant que quarante-huit Évangiles soient exhumés du désert d’Égypte en 1945. La Bibliothèque de Nag Hammadi. Selon la gnose, notre âme céleste a été faite prisonnière de la matière. Nous sommes étrangers à ce monde, exilés, loin, très loin de notre patrie céleste. Nous vivons endormis et frappés par l’oubli de notre origine, dont nous gardons cependant la nostalgie de la lumière. Cette nostalgie est le lien précieux à notre patrie natale. L’étincelle qui scintille dans notre âme est le fragment divin caché en chacun de nous. La gnose, la connaissance, est à la fois contenu et contenant, forme et message, car par la pureté de sa vérité, les révélations de notre origine divine et de notre mission ici-bas nous renvoient à nos souvenirs oubliés et à ce qui est gravé dans notre cœur. Ce rappel, ce réveil, que l’on qualifie d’anamnèse, nous rappellera notre mission ici, sur cette terre de l’exil. La révélation de la gnose nous met face à notre responsabilité de rencontrer Dieu de notre vivant, dans la révélation de l’âme, notre lien avec Lui. Et comme le prince de l’Hymne, le temps venu, lorsque notre âme resplendira de sa pleine lumière, elle nous guidera hors du labyrinthe, jusqu’à notre patrie céleste.
L’aigle est la gnose elle-même. Roi des oiseaux, messager du ciel, il est lui-même le message et le messager, lettre et parole, voix et cri. Il tire le prince de son sommeil, il lui rappelle son origine céleste et sa mission de retrouver la perle. Le prince s’assure que ce message est conforme à l’entente que ses parents ont gravée dans son cœur et il embrasse la lettre, l’aigle d’amour. La concordance entre le message de la lettre et l’entente gravée dans son âme a quelque chose de divin, comme ces nombreux moments où la succession des Tapisseries, la symbolique des nombres, ou les vallées d’Attar, m’ont confirmé sur mon chemin par la brillance de la concordance. Puis la lettre se change en lumière et elle guide le prince vers son royaume d’Orient, passant par Sarbūg dont le nom s’apparente à sarbuka qui en arabe signifie labyrinthe. Image du labyrinthe qu’emploient souvent les gnostiques pour décrire notre vie de confusion, ballotés que nous sommes par les violences du monde, dans ce que Philip K. Dick qualifie dans son Exégèse de « prison de fer noir ».
Retrouvons l’aigle des Tapisseries. Il appelle avec l’oie à l’amour fougueux sur Toucher, puis à l’amour qui blesse sur Ouïe. Sur Désir, son sacrifice, son enchaînement, est le prix de la libération de « Mon seul désir », la mise sous silence des pulsions, ou la soumission de l’amant dans une lecture courtoise. Le faucon de Goût est-il l’aigle de la gnose ? Je ne crois pas. Le faucon chassant la pie et la dame portant un gant de cuir font référence à la fauconnerie, cet art de confiance. Nous avons toutefois le droit de nous demander : que cela signifierait-il si le faucon était l’aigle de la gnose ? Le faucon a repris son vol et la dame porte la perruche sur son gant. Aurait-il déjà révélé à la dame un secret qu’elle révèlerait à son tour, sous la forme d’une perle, à la perruche, l’oiseau du verbe ? Aussi, l’aigle royal de l’Hymne ne vous rappelle-t-il pas le faucon royal du Mantic à qui était adressée cette mission : « attache à ta patte la lettre de l’amour éternel, mais ne la décachette pas jusqu’à l’éternité » ?
L'aigle


La perle de l’Hymne est l’âme du prince. C’est une telle évidence pour Jacques-Etienne Ménard qu’il ne prend pas la peine de le justifier. Il se contentera de nous rappeler que dans la tradition mandéenne, l’âme est « la pure perle » et que la perle est la nitufta, « la larme qui est tombée du ciel dans la mer », larme qui me rappelle la larme de Sofia de la Pistis Sofia, perdue loin, très loin du Plérôme. L’âme est une parcelle divine en chacun de nous, elle est l’étincelle que nous avons pour devoir d’attiser. Le roi missionne le prince d’aller chercher l’unique perle et lorsque le prince arrive près du dragon, il attend que le serpent s’endorme, alors il dit « je lui ravirai ma perle ». Le prince considère donc que cette perle est la sienne avant même qu’il l’ait ravie au serpent écumant. C’est donc qu’il est venu reprendre ce qui lui appartient. Cette perle est unique, car il n’y a qu’une perle qui puisse appartenir à ce prince, puisque cette perle est la manifestation de son âme. Au terme de l’Hymne, le roi conduit le prince sur le seuil du Roi des Rois dont la porte s’ouvrira à lui par le présent de la perle. La perle, l’âme révélée, est la clé qui ouvrira la porte du seuil du mystère.
Une critique faite aux gnostiques par les pères de l’Église, tels qu’Irénée de Lyon ou Hippolyte de Rome, est leur orgueil dans une démarche autonome de l’homme vers Dieu. Pourtant, comme dans le Mantic, le disciple a besoin que Dieu vienne à lui, qu’il accepte de l’aider, de lui dispenser son amour, sa connaissance, sa grâce. Pour que le prince parvienne à la perle, il faut que le roi intercède en sa faveur et lui adresse la lettre d’amour, le souvenir, l’anamnèse, le cri de l’aigle royal qui tire du profond sommeil.
La perle


Le miroir apparaît quand, remontant vers le Royaume, le prince revêt le vêtement royal qu’il avait quitté dans sa descente :
« Subitement, dès que je le rencontrai,
tel mon miroir, le vêtement resplendissant me ressembla :
tout entier, je le vis en moi-même tout entier
comme moi-même tout entier, je me retrouvai en lui,
car deux nous étions dans la division,
mais un à nouveau étions-nous dans une unique forme ».
Le vêtement n’est pas un miroir, il est si identique au prince qu’il pourrait être un miroir. Dans les textes en vieil et en moyen iranien, le vêtement représente la partie de l’âme restée au ciel, le prince mêle ainsi la part terrestre de son âme à sa part céleste, il se mêle à son double, à son reflet céleste. À cette évocation explicite du miroir s'ajoutent d’autres miroirs dans l’Hymne par la profusion des doubles du prince : son jumeau avec qui il héritera du Royaume, le noble oint d’Orient à qui il se confiera en Égypte et le plus dévoué des serviteurs de son Père.
Le prince, s’il ramène l’unique perle du fond de la mer, héritera du royaume d’Orient avec son jumeau. Cela n’a-t-il surpris que moi, que son frère reste tranquillement au Royaume alors que le prince descend dans les profondeurs de l’Égypte affronter un serpent écumant ? Et ce frère mériterait tout autant d’hériter du Royaume ? Cela est en fait légitime, puisqu'à Royaume céleste, jumeau céleste. Le jumeau n’est autre que la part céleste de l’être, comme Mani en appelait souvent à son jumeau, ou que dans l’Évangile de Thomas (Évangile gnostique appartenant à la Bibliothèque de Nag Hammadi, sans lien avec les Actes de Thomas, l’Évangile apocryphe dont est tiré l’Hymne), Thomas parle au nom de jumeau du Christ. Le prince et son jumeau ne forment qu’un.
Le second double est le confident que le prince rencontre en Égypte :
“Mais je vis là un fils de ma race, un fils de nobles, d'Orient,
un beau jeune homme gracieux,
fils d'oints ; il vint s'attacher à moi,
et je fis de lui mon confident,
mon compagnon à qui je communiquai mon affaire.
Je le mis en garde contre l'Égypte
et contre le contact des êtres impurs.”
Que fait-il là ? Qui est-il au juste ? Le prince descend du Royaume céleste et ce confident est fils de sa race, il serait donc lui aussi originaire du Royaume ? Ou serait-ce un homme d’en bas qui se ferait passer pour tel, un homme dont la beauté et la grâce lui donneraient l’allure d’un prince ? Il séduit le prince et s’attache à lui, le prince lui dit « son affaire », cette incroyable affaire, son origine céleste, sa mission, il lui dit aussi sa méfiance des Égyptiens. Le prince se confie à lui et peu après il sera démasqué. Ce fils de nobles est un traître. Il est le double du bas, il est vêtu de la beauté d’ici, la séduisante jeunesse, il est entreprenant, il s'attache au prince et lui extorque des secrets. Le prince a un jumeau divin et il a un jumeau terrestre, le dénonciateur. Est-on si loin de « l’accusateur » ou de « l’adversaire », autant de noms du diable ?
Le troisième double est « le plus dévoué des serviteurs que l’on a dressé au service de (son) Père ». Le plus dévoué des serviteurs du père n’est-il pas le fils ? Le roi lui-même a un double, puisqu’il conduit le prince à la porte du Roi des Rois. Il y a toujours un double au-dessus et un au-dessous et c’est en se mêlant à ces doubles que le prince monte ou descend entre le ciel et la terre. Le serviteur est le double du prince, double physique puisqu’ils partagent l’aventure : « j’ai senti aussi en moi que ma stature, comme ses œuvres, a grandi » et double psychique puisqu’ils partagent leurs pensées : « tout en lui était secoué par les mouvements de ma connaissance ». Le prince et le serviteur se rencontrent comme l’objet et son reflet dans le miroir. Le serviteur se précipite vers le prince et lui tend la main. Relisons : « Je tendis (mon corps) et le reçus, je me parais de la beauté de ses couleurs, et ma toge miroitante de couleurs, je me vêtis tout entier d’elle tout entière ».
Imaginez la scène, la tension, le contact, la fusion subite. Le prince, vêtu de sa toge miroitante, miroir dans le ciel, a basculé dans l’invisible céleste. La rencontre de deux êtres semblables, l’un montant de la terre et l’autre descendant du ciel, se pressant l’un vers l’autre, n’est-elle pas l’objet et son reflet qui se rapprochent jusqu’à se tendre dans une longueur décuplée à l’instant où ils se touchent à la surface du miroir ? Le prince bascule dans le royaume céleste lorsque son esprit franchit la surface du miroir et vient habiter son reflet. Passé de l’autre côté, j’imagine la montée du prince comme l’objet et le reflet s’éloignent à une vitesse décuplée. Plus l’esprit du prince se détache de son enveloppe charnelle, plus son corps s’éloigne de la surface, et plus son reflet s’élève. Mais, de l’objet et du reflet, quel est celui qui guide l’autre ?
Il y a donc du miroir, ou au moins du double et du reflet, dans les trois œuvres, le Mantic, l’Hymne et les Tapisseries. Dans le Mantic et dans l’Hymne, c’est en s’oubliant, en quittant son enveloppe terrestre que l’oiseau et le prince basculent dans leur reflet et font la rencontre du Simorg ou du Roi des Rois. Cela ne nous dit pas comment opère le miroir de Vue, mais nous sommes déjà confirmés dans le caractère sacré de la scène, dans le fait que c’est ici que le chemin s’achève, que la licorne perçoit l'invisible.
Avant de quitter l’Hymne, j’aimerais parler du serpent écumant. Pourquoi est-il si proche de la perle ? Et s’il révélait une dimension nécessaire de la quête mystique ?
Le miroir


Lorsqu’il arrive en Égypte, le prince attend que le serpent s’endorme pour lui dérober sa perle. Le serpent ne s’endort pas et le prince oublie sa mission, c’est lui qui sombre dans le sommeil. Ce n’est qu’une fois ramené au souvenir par l’aigle céleste que le prince parvient à endormir le serpent en prononçant sur lui le nom véritable de ses parents. Le serpent des profondeurs, ce dangereux serpent écumant, gardien de la perle, évoque le dragon, gardien du trésor, comme le dragon Fafnir garde l’or rouge, l’or maudit de la saga des Nibelungen. À la différence de Siegfried qui n’hésite pas à tuer le dragon pour lui ravir son or, le prince de l’Hymne se contente d’endormir le serpent. La suite donnera raison au prince puisque Siegfried, après avoir tué le dragon par une basse ruse, après avoir goûté de son sang qui lui fera connaître le secret de la langue des oiseaux, après que les corbeaux lui auront révélé les plans de son oncle contre lui, après avoir tué son oncle, après avoir sauvé Brunhild la valkyrie des rideaux de feu et du sommeil dressés contre elle par son père Odin, après avoir appris d’elle les runes secrètes d’amour et de vie, Siegfried connaîtra la mort promise par l’or maudit du dragon, et ce sera sang pour sang, jusqu’à ce que le sang royal soit à jamais épuisé de la contrée. Le trésor, s’il est acquis par le sang, par une union meurtrière de l’homme et du dragon, est un or maudit qui répandra le mal pour le mal.
La perle est la pureté parmi les puretés, elle est l’étincelle divine manifestée. Près d’elle veille le serpent écumant, semblable à un dragon. Ce dragon que l’on ne peut tuer, qui parfois s’apaise, mais qui mérite d’être excité contre nous par ceux qui nous mêleraient à leurs perfidies, ce dragon que la prière, la magie du nom des parents endorment, c’est notre dragon intérieur, notre part d’ombre, qui fait autant partie de nous que notre part de lumière, la perle. Le prince ne songe pas à le tuer, car le serpent écumant est une part intégrante de lui-même.
Nous connaissons maintenant l’issue du chemin de la perle. Mais quel serait le chemin du dragon ? À quoi ressemblerait l’épiphanie du mal ?
Le Mantic nous enseigne dans une de ses paraboles la définition du mal au sens mystique, c’est dans Entretien de Dieu avec Moïse : « Dieu dit un jour à Moïse en secret : « Demande un bon mot à Satan ». Quand donc Moïse vit Éblis sur son chemin, il lui demanda de dire un bon mot. « Garde toujours en souvenir, répondit le diable, ce seul axiome : ne dis pas moi, pour ne pas devenir comme moi. » » Le mal au sens mystique, c’est l’égo. Le chemin du dragon serait celui qui, au lieu de chercher Dieu dans la pureté de l’âme, irait le chercher dans une autodéification. Et cet individualisme spiritualisé dans une toute-puissance, dans la satisfaction extravagante des désirs, des besoins et des pulsions sous des capes de soie rouge comme autant d’offrandes à la divinité intérieure, elle existe, elle s’appelle satanisme, luciférisme, ou voie de la main gauche. Ce sont des cultes de la part d’ombre, qui la glorifient et la nourrissent par la satisfaction de toutes les envies et de toutes les pulsions, comme autant d’offrandes au dieu autoproclamé de l’égo. C’est un triomphe assumé de l’ombre, un droit à tous les excès au nom d’un culte de soi qui s’affublera au besoin de légendes et de costumes. C’est le culte de l’ange de lumière, le plus beau des anges, déchu pour s’être mesuré à Dieu, pour avoir refusé de suivre ses lois, pour avoir eu l’audace de la licencieuse liberté. « Do what thou wilt shall be the whole of the Law », tel était le credo d’Aleister Crowley. Il est évident que « Mon seul désir » qui accompagne le geste de la dame qui dépose ses bijoux, ses vanités, devant la tente de la prière, est une liberté qui va dans l’autre sens, qui se libère des tentations et des pulsions pour accéder à une autre dimension du libre arbitre.
Y a-t-il un espoir de sortir grandi d’un culte de soi ? Ce culte d’un dieu autoproclamé de l’égo, dont les offrandes et les prières sont l’assouvissement des désirs et des pulsions, conduira immanquablement son disciple à en devenir l’esclave, victime de ses excès, comme les diablotins enchaînés du quinzième arcane majeur du tarot. Plus encore que ces dépendances visibles, c’est une voie qui conduit à la destruction de la faculté d’aimer, tout tourné que l’on devient vers soi. Je citerai l’exemple d’Anton Zlatan Lavey, fondateur de l’église de Satan. Fils de Narcisse, il passa ses dernières années coupé du monde, acariâtre, dans une triste solitude.
La crainte du mystique n’est pas tant de devenir sataniste que de tomber dans l’autodéification sans le savoir. Le mystique lui-même, celui qui cherche Dieu de toute sa ferveur, risque de s’égarer dans les méandres de son esprit. Alors c’est dans l’écho de sa pensée qu’il entendrait la voix de Dieu. Il penserait être accompagné quand il serait seul. La crainte de tout mystique, de tout prétendant au Royaume, doit être de trouver l’ombre quand il pense avoir trouvé la lumière. Et dans un miroir qui n’a pas été ouvert par l’artéfact de l’âme, que verrait-il ? Il ne verrait qu’une reproduction de ce monde, il se plongerait dans sa contemplation, il se verrait dieu lui-même au lieu de rencontrer Dieu. Le saurait-il ? Dans le Mantic, Attar nous met en garde : « Ce que tu dis et ce que tu sais, c’est ce que tu es. Se connaître soi-même, c’est exister cent fois. Mais tu dois connaître Dieu par lui-même, et non par toi ; c’est lui qui ouvre le chemin qui conduit à lui, et non la sagesse humaine. » Mais comment savoir ?
L’Hymne nous enseigne que le prince ne peut à lui seul déjouer le serpent. C’est par l’aide de ses parents qu’il l’endort, par la magie, par la prière, en prononçant les noms véritables du Père, de la Mère et du Fils. Il faut prier et attendre que Dieu nous réponde. Je pense naturellement à cette prière, la seule acceptée par les christias, ceux qu’on nomma les cathares, le Notre Père. Et ce don qu’il nous fait en retour, ce charme protecteur qui endort le dragon et nous livre la perle, c’est la Grâce qui nous guide, c’est le sceau du Saint-Esprit.
Le serpent écumant


Nous voici arrivés au terme d’une longue digression. La symbolique des nombres, par une référence au Sept dans le Chevalier, nous a conduits aux sept vallées d’Attar, qui par l’évocation de l’âme, nous a conduits à l’Hymne. Nous avons ainsi retrouvé le miroir et la perle, comme sur Vue et sur Goût. Que nous ont appris ces digressions ? J’espère d’abord qu’elles vous auront plu, que vous y aurez appris des choses, qu’elles vous auront conduits à des questions, peut-être même, à des contemplations. Les nombres ont concordé avec les Tapisseries. Il y a de la magie dans la concordance. La concordance des sept vallées ne se fait qu’à moitié à la surface, mais elle apparaît dans le fond, par le miroir de l’âme de trente oiseaux dans lequel se manifeste le Simorg, miroir qui signe le caractère transcendant de la scène de Vue.
Le miroir, le fantastique miroir, qui permet de rester physiquement sur le seuil et de basculer spirituellement de l’autre côté, dans le sur-naturel. C’est le miroir de l’âme dans lequel Dieu se reflète en nous. Miroir que l’on retrouve dans l’Hymne par l’idée de double et de bascule dans le reflet. Je reste ébloui par la rencontre du serviteur qui s’approche du prince comme un objet de son reflet et qui, à leur contact s’étirant entre les deux mondes, reçoit en lui le prince qui poursuit sa montée.
Il y a la perle, la manifestation de l’âme. La découverte de la perle est une révélation, une connaissance inébranlable de la réalité des dimensions spirituelles, de la réalité de Dieu. La perle est aussi un artéfact, comme elle ouvre la porte du Roi des Rois, c’est très certainement elle qui ouvrira la surface du miroir de Vue.
Peut-on se référer au Mantic et à l’Hymne pour comprendre les Tapisseries ? Les Le Viste ou leur artiste avaient-ils connaissance de ces œuvres ? Il est trop tard pour le leur demander. Seuls les écrits restent. Les écrits et les tapisseries. Il faudra faire avec l’incertitude. Le plus prudent sera de dire qu’ils ne les connaissaient pas, qu’il n’y a pas de parenté directe. Il nous faudra redécouvrir le faucon, la perle et le miroir comme les Tapisseries voudront nous les raconter. Cependant, par le Mantic et par l’Hymne, nous aurons agrandi le champ de nos possibles, nous aurons ouvert notre esprit aux clés de quêtes spirituelles intérieures, nous aurons des questions nouvelles à adresser aux Tapisseries. Nous aurons aussi plus d’espace, plus de recul, pour intégrer les Tapisseries dans des perspectives nouvelles.
La principale leçon est celle d’une vérité universelle et éternelle, que Sa signature est en chacun de nous, que chacun de nous porte en son cœur le souvenir de son origine et de sa mission ici. Le Mantic, l’Hymne, les Tapisseries, sont nés similaires en différents lieux et en différentes époques, car ils découlent de la signature divine gravée sur notre âme, comme le cœur du prince garde l’entente passée avec ses parents célestes, comme chaque âme porte la copie de la peinture de la plume du Simorg tombée une nuit en Chine. Ce ne sont pas des filiations à la Guénon. Pour reprendre l’expression de Jacqueline Kelen, ce sont des floraisons intérieures.
Conclusion sur l'Hymne de la perle


Art et pensée
entre Moyen-Age et Renaissance
Maintenant, laissons les Tapisseries nous parler, librement, dans leur langue… Que se passe-t-il ? Rien, absolument rien. J’ai souvent l’impression que ce sont elles qui me regardent, résolues à garder le silence, pour l’éternité. Tandis que je vieillirais et que je mourrais devant elles, impassibles, elles me contempleraient encore. Je ressens alors l’urgence de l’ouvrage, l’urgence de trouver la clé, maintenant, de mon vivant. Je me mets à l’étude, je lis, je relis, un peu sur les Tapisseries, surtout sur l’époque, sur l’ambiance, l’alchimie, la chevalerie, le Graal, l’amour courtois, la dame, la femme, la Déesse.
De ces lectures, il est advenu un premier résultat, très concret. Lorsque j’ai vu Ouïe, j’ai rapidement fait le lien entre l’amour qui blesse et Perceval qui s’oublie devant trois gouttes de sang sur la neige. Je ne fais pas honneur à ma culture en avouant qu’alors je n’avais même pas lu Le conte du Graal, j’avais seulement lu l’article d’Henri Rey-Flaud Le sang sur la neige : analyse d’une image-écran de Chrétien de Troyes [10], suite à une mention des trois gouttes de sang sur la neige dans Le sang : Mythes, symboles et réalités de Jean-Paul Roux [11], que j’avais lu en espérant y trouver la clé du mystère des vampires, j’y reviendrai. Jacqueline Kelen aussi a pensé aux trois gouttes de sang. Au temps des Tapisseries, cela devait être une évidence, chacun devait penser à Perceval en voyant le faucon chasser l'oie. Quelles autres références, quelles autres évidences étais-je en train de manquer ?
Pour ajuster mon répertoire au temps des Tapisseries, j’ai choisi de m’intéresser à quatre sujets : la fauconnerie, puisque la dame porte un gant de fauconnier sur Goût ; le Conte du Graal bien sûr, en reprenant l’analyse d’Henri Rey-Flaud; l’alchimie, puisque j’ai vu une allusion alchimique dans le soufflet d’Ouïe; et l’amour courtois, puisqu'il est évoqué pour la lecture en intempérance de Désir. L’amour courtois ouvre sur une dimension extraordinaire, tellement extraordinaire que je crains qu’elle n’éteigne la clarté du reste. Je vais donc le traiter à l’écart, après une mise en perspective du principe féminin par la psychologie des profondeurs, les contes de fées et les cultes isiaques, des lumières indispensables à une véritable compréhension de ce qu’a pu être le fin’amor occitan.
Retour aux Tapisseries


La fauconnerie, cet art importé d’Orient par les croisades, connut son âge d’or à la fin du Moyen Âge. Technique de chasse venue des steppes mongoles, elle devint chez nous l’apanage de la noblesse. Noblesse de titre, puisque des décrets la réservaient à la seigneurie. Noblesse de cœur, puisque le fauconnier devait présenter des qualités, physiques, mais surtout morales, pour dresser le sauvage faucon au service de ses désirs, ses seuls désirs. La fauconnerie était un effort permanent de soumettre celui qui restait irrémédiablement sauvage, le faucon que Buffon décrit en ces termes dans son Histoire Naturelle [12] (citation que je dois à l’excellent ouvrage de Corinne Beck et Elisabeth Rémy [13]) :
« Lorsqu’on jette les yeux sur les listes de nos nomenclatures d’Histoire naturelle, on serait porté à croire qu’il y a dans l’espèce du Faucon autant de variétés que dans celle du pigeon, de la poule ou des autres oiseaux domestiques : cependant rien n’est moins vrai ; l’homme n’a point influé sur la nature de ces animaux ; quelqu’utiles aux plaisirs, quelqu’agréables qu’ils soient pour le faste des princes chasseurs, jamais on n’a pu en élever, en multiplier l’espèce : on dompte à la vérité le naturel féroce de ces oiseaux, par la force de l’art et des privations : on leur fait acheter leur vie par des mouvements qu’on leur commande ; chaque morceau de leur subsistance ne leur est accordé que pour un service rendu : on les attache, on les garrotte, on les affuble, on les prive même de la lumière et de toute nourriture, pour les rendre plus dépendants, plus dociles, et ajouter à leur vivacité naturelle l’impétuosité du besoin ; mais ils servent sans attachement ; ils demeurent captifs sans devenir domestiques ; l’individu seul est esclave, l’espèce est toujours libre, toujours également éloignée de l’empire de l’homme ».
L’homme n’a pas pu changer l’espèce qui a gardé au fond l’impétuosité de sa race. La soumission d’un naturel féroce par la privation rappelle les chaînes aux serres du faucon sur Désir, et le caractère artificiel de leur attachement rappelle le serpent écumant de l’Hymne, qui n’est qu’endormi par les prières du prince.
La fauconnerie


De arte venandi cum avibus, le plus réputé des traités de fauconnerie, aurait été écrit et illustré entre 1241 et 1248 par Frédéric II de Hohenstaufen, empereur du Saint Empire, roi de Sicile, le Stupor mundi ou l’Empereur endormi, celui dont on ne put accepter la mort. Un traité qui nous enseigne la fauconnerie dans ses moindres détails, les différentes espèces de faucons, leurs caractères, leurs goûts, la façon de les capturer, de les dresser, de les soigner et, chose essentielle, de les entraîner à la chasse.
Le dressage du faucon, que l’on qualifiait d’affaitage, commençait par un ensemble de privations par lesquelles le fauconnier soumettait le faucon. Il était contraint au jeûne, il était privé de sommeil, il était privé de la vue par son chaperon, il était enchaîné à une souche et s’il s’agitait, il était aspergé d’eau glacée. Ces soins, ou plutôt ces châtiments, n’étaient administrés que par une seule et même personne qui, elle seule, serait son fauconnier (fauconnier est invariable, il peut aussi bien s'agir d'un homme que d'une femme; la fauconnière est la besace contenant la viande avec laquelle il gratifie son faucon). Aussi grand fut le prince, il ne pouvait se contenter d’acquérir un faucon, fut-il parfaitement dressé. Il devait s’investir avec constance à ses côtés, jour et nuit, partager la fatigue du dressage, savoir lui passer le chaperon, le châtier, le dominer. Il devait aussi le soigner, lui donner le bain, lui choisir un bloc à sa mesure pour se reposer, et lui trouver de la viande à son goût, celle que plus tard il irait chasser. Peu à peu le fauconnier prendrait le faucon sur son gant, il lui ôterait son chaperon, il l’habituerait aux chevaux et aux aboiements des chiens, il lui apprendrait à reconnaître le cri de son maître. Peu à peu s'installerait une relation mêlant soumission et confiance, dans la privation et dans le réconfort, la relation unique du fauconnier avec son faucon. Après l’affaitage, le faucon serait dit assuré, prêt pour son premier vol pour bon. Pour la première fois, il volerait librement avant de revenir au cri d’appel de son fauconnier.
Dans Le livre du roy Modus et de la royne Racio, vers 1377, Henri de Ferrières nous parle non pas du dressage du faucon, mais des qualités requises du fauconnier. Il devait avoir une bonne santé, de l’adresse, des sens exercés, une forte voix pour se faire entendre de loin, ne pas avoir de gestes brusques, ne pas s’emporter, ne pas s’enivrer, ne pas trembler et surtout savoir porter le faucon, car « le poing du porteur peut améliorer l’oiseau comme il peut le gâter ». Le roi Modus (modus qui signifiait « la bonne manière ») insistait sur les qualités morales : « les aimer parfaitement, leur être aimable, en être curieux ». Le fauconnier devait se mêler à son sauvage faucon, il devait apprendre de lui. Comme écrira Luis Racionero dans Le troubadour alchimiste : « Il n’y avait ni acharnement ni malveillance dans sa soif de destruction, c’était sa manière d’être. (...) Il (le faucon) fait ouvertement et le plus naturellement du monde ce que nous faisons en nous cachant. Il dévore le cerveau du plus faible, et cela lui plaît ». [14]
Le faucon, sauvage, jamais domestiqué, mais entretenu dans cette relation de soumission et de confiance, est comme cette part sauvage qui nous habite, cette pulsion que nous tenons soumise, mais qui demeure toujours prête à resurgir et à reprendre possession de nous. Il est comme le serpent écumant de l’Hymne que le prince ne peut qu’endormir. Le faucon des Tapisseries n’est pas celui de l’anamnèse, porteur de la lettre d’amour universelle. Il appartient à l’ombre.
Sur Désir, la dame soumet le faucon, sa part d’ombre, qu’elle vienne de l’extérieur par les désirs des sens, par la menace, par l’abandon et l’injustice, ou de l’intérieur, des pulsions. Pour maîtriser son ombre, la dame doit la fréquenter comme le fauconnier fréquente son faucon, jour et nuit, elle doit la nourrir, elle doit la soigner, elle doit connaître ses besoins. Alors peu à peu, elle pourra ôter le chaperon et défaire les chaînes. Elle saura reconnaître l’ombre dans le monde qui l’entoure, elle saura maîtriser son ombre et se défendre de celle d’autrui. Alors l'ombre lui viendra en aide en empêchant la pie d’atteindre la roseraie, l’abri du miracle de la perle. La dame de Goût est un fauconnier, elle a donc acquis les aptitudes physiques et morales énoncées dans le Modus, elle appartient à la véritable noblesse. En tenant elle-même l’étendard de Toucher, privilège réservé aux chevaliers, nous savions qu’elle était de noblesse de rang, voilà qu’elle appartient à la noblesse de cœur.
Regardons encore une fois les oiseaux dans le ciel des Tapisseries. Sur Toucher, tout est exalté, victorieux, immédiat, l’oie se prête au faucon, la pulsion est assouvie par un bref rapprochement dans la dualité. Le faucon est absent d’Odorat, il a été remplacé par ce piètre chasseur qu’est le héron, pas même capable d’éloigner la pie. La dame n’a pas encore fait de l’ombre son alliée, elle est à la merci de la première menace venue. Le héron est la proie de choix du faucon et il serait bien incapable de protéger la dame d’une offensive de l’ombre, il est bien incapable de prévenir la scène d’Ouïe. Derrière la promesse d’engagement du mariage et le quaternaire structurant du Quatre, la senteur sera fugace comme la jeunesse, la dame est fragile et elle l’ignore. Sur Ouïe, le faucon fond sur l’oie, c’est l'amour qui blesse, l’abandon, la douloureuse rencontre de l’ombre. Mais la dame résiste, elle trouve en elle-même la faculté de sublimer l’ombre en lumière par les mélodies de l’âme. Sur Désir, le faucon est enchaîné et l’oie a recouvert son splendide. C’est l’affaitage, la dame contraint le faucon autant qu’elle se contraint elle-même, elle se prive des richesses et des plaisirs des sens, sous la tente de l’ascèse. Sur Goût, le faucon est lié à la dame par le gant de fauconnerie. C’est une révélation sacrée qui se déroule sous la roseraie, sous sa protection. Non seulement la dame a-t-elle appris à maîtriser sa part d’ombre, son faucon, pour se protéger; mais dans l’affaitage de Désir, elle s’est mêlée à son faucon, elle a partagé sa façon de penser et sa façon d’agir. La dame a quitté l’illusion d’Odorat selon laquelle rien ne risquerait de menacer un vœu si pur. Elle ne sera plus jamais dupe, elle sait à présent reconnaître la noirceur, elle qui a côtoyé l’ombre. Pour parler comme Henri Laborit dans Éloge de la fuite, la dame a rétabli son homéostasie. Elle a résolu les tensions, elle a rétabli l’équilibre intérieur, entre ombre et lumière, avec au centre cette roseraie qui abrite le miracle du verbe.
Différentes illustrations de la poésie courtoise représentent une dame tenant un faucon sur son poing. À pied ou à cheval, elle est souvent accompagnée de son courtisan. L’on nous dit que le faucon symbolise les qualités courtoises de l’amour. [13] Il y a la rapidité du faucon saisissant sa proie, c’est l’homme séduisant sa dame. Il y a la dame aux mœurs farouches qui, comme l’oiseau sauvage pris au piège, doit être soumise par la douceur. Il n’y a pourtant rien de courtois dans ce prétendant qui se saisit de la dame et l’affaitage n’a rien de doux. Ces illustrations nous rappellent qu’il a bien existé des dames fauconniers, comme dans les Tapisseries. Mais que dire d’une dame tenant une perruche sur son gant de fauconnerie ?
À quelle espèce appartient le faucon des Tapisseries ? C’est une espèce employée pour la fauconnerie en France et ses ailes courbées ne sont pas celles du faucon pèlerin. Il s'agit donc d’un hobereau ou d’un émerillon. Comme le faucon des Tapisseries, le hobereau ressemble à un martinet, avec ses ailes effilées et sa queue courte. Le hobereau était réputé pour la chasse au héron qu’il tuait d’un choc en plein vol. Calme héron que l’on retrouve sur Odorat, impassible devant la pie. Les vœux pieux du mariage d’Odorat manquent de l’impétuosité, de la fougue de Toucher, il manque la pulsion, il manque l’ombre. La dame est endormie dans un monde d’illusions et elle se fie pour sa défense au pauvre héron qui n’a d’intérêt que pour les poissons. Par la suite, la dame dressera à son service le faucon, le prédateur de la pie, le prédateur du héron, le plus grand prédateur qui soit ici, le prince du ciel. L’autre espèce que nous avons évoquée est l’émerillon, que l’on nomme aussi « le faucon des dames » et dont le nom livresque est « falco columbarius ». C’est aller chercher loin, mais tout de même, elle est là, la colombe du Saint-Esprit.
Le dressage du faucon - de l'affaitage au vol pour bon


L’apprivoisement de la perruche
Les monarques du Moyen Âge ne nous ont pas légué le moindre ouvrage sur l’art du dressage, ou plutôt du patient apprivoisement de la perruche. La page du site Aérien sur l'apprivoisement de la perruche [web1] m'a cependant permis de me faire une idée du sujet. La perruche est un oiseau craintif qui s’apprivoise jour après jour, avec constance, par de douces paroles, puis de légères caresses et des graines ou des sucreries, avant de tenter de la prendre sur son doigt. Si la perruche s’envole, elle peut se perdre et ne jamais revenir. En contrepartie de longs efforts, elle offrira en récompense le déploiement de ses ailes, son chant et peut-être même sa voix.
Sur Goût, la perruche révèle son somptueux plumage. Le faucon, son prédateur naturel, ne la chasse pas, il la protège. La dame qui a dressé le faucon sur Désir, par la rigueur, les contritions et l’ascèse, apprivoisera la perruche sur Goût par la patience, la douceur et l’atmosphère de calme, de sérénité et d’harmonie que sa seule présence suffit à créer. Pour récompenser la dame, la perruche déploie ses ailes. Est-ce qu’elle chante ? Tenant dans ses griffes la perle de l’âme, je penserais plutôt que dans la langue des oiseaux elle nous révèle le mystère, celui du verbe premier dont Dieu fit don à Adam, la prisca sapientia.
L’adoption du petit chien
C’est un « gentil petit chien à sa maman », un bichon, ou une autre espèce domestique, créée de main d’homme. C’est un chien dont la nature même est d’offrir sa fidèle soumission en échange d’un sucre ou d’une caresse.
Sur Désir, le petit chien trône sur un coussin. Il est facile de se cloitrer, de se détacher de tout, comme le fait la dame. Les prières résonnent mieux dans un cœur couvert de vertu. Le résultat est assuré, comme l’affection de ce bichon. Il suffit d’adopter le mode de vie de l’ascète comme on adopte un chien. Mais celui qui prétendra aller au-delà ne se contentera pas d’enchaîner le faucon, il devra entamer avec lui une relation éprouvante, il devra regarder au plus profond de son ombre et apprendre à la maîtriser, comme un fauconnier dresse son faucon.
Sur Goût, le petit chien est rabaissé sur le pan de la robe. Il ne peut se mêler à la plénitude du monde, à la liberté, à la vie sauvage, à tout ce qui vient du dehors, d’ombre ou de lumière. Il est trop habitué à la constance et à la maîtrise que représente la tente de l’ascèse. Le pauvre petit chien ne trouve pas sa place ici. Il porte un collier avec deux grelots, comme un bouffon. Que pourrait-il nous apporter de plus que les oiseaux, ces libres intermédiaires entre l’homme et le ciel ?
L’amour de la licorne
La dame a dressé le faucon, elle a apprivoisé la perruche et elle a adopté le bichon. Qu’en est-il de la licorne ? La première fois, sur Toucher, la dame caresse sa corne. La seconde fois, sur Vue, elle la tient couchée sur ses genoux, dans une parfaite sérénité. Y a-t-il un art du dressage de la licorne ? Il n’existe certainement ni dressage, ni apprivoisement, ni adoption. La licorne ne viendra que de sa pleine volonté, de son plein jugement, de son plein amour. Elle est fougueuse, spirituelle, érotique. C’est par sa pureté que la dame attire la licorne à elle. Seule une vierge pouvait approcher une licorne, ou plutôt un unicorne, selon le genre médiéval.
Je veux bien que la dame soit vierge sur Toucher, mais elle ne devrait plus l’être après le mariage qui se préparait sur Odorat. Quoique, ce mariage est d’une autre nature, c’est le mariage avec la spiritualité, celui d’un amour qui commença au premier regard sur Toucher et qui retrouvera son plein éclat sur Vue. Entre les deux il y a la rupture d’Ouïe et il y a Désir où la dame apprend à maîtriser son ombre. C’est une renaissance spirituelle, la dame est devenue l’initiatrice. Sur Vue, la dame accompagne la licorne dans une rencontre intime du divin, par le franchissement des limites du créé. Qu’il y ait eu ou non mariage consommé entre Odorat et Ouïe, la dame n’est plus vierge sur Vue, car la pleine rencontre et la pleine maîtrise de son ombre impliquent l’expérience de la plus puissante des pulsions, la libido. Alors, si la dame peut à nouveau toucher la licorne, c’est que devenue initiatrice elle a atteint un degré ultime de virginité. Serait-elle devenue une nouvelle Sainte Vierge ? D’une certaine manière. Pour comprendre qui devient la dame sur Vue, il faudra nous placer dans une perspective qui nous est encore étrangère, celle de la femme divine.
Ces différents couples que la dame forme avec le faucon, la perruche, le bichon ou la licorne représentent-ils des relations que la dame connaîtrait avec différents hommes ? S’agit-il de différents moments d’une relation avec un même homme ? Ou sont-ils des allégories des rapports que la dame entretient avec différentes facettes d’elle-même ? Je proposerai une autre lecture. Nous verrons plus loin les enjeux de la dynamique entre le masculin et le féminin, entre l’animus et l’anima. Nous verrons la dimension d’un féminin sacré qui se révèle sur le chemin des Tapisseries. Elles nous montrent un chemin initiatique que nous sommes invités à suivre, femme ou homme, et les dynamiques en jeu font écho aux états successifs de notre âme, à ses humeurs changeantes, sur le chemin de la révélation.
L'apprivoisement, l'adoption et l'amour


Sur Ouïe, le faucon fond sur l’oie qui chute, la même oie qui s’offrait à lui sur Toucher. Il semble qu’en cette fin de Moyen Âge, le Conte du Graal, datant du XIIe siècle, était connu de toute la gente cultivée. Par conséquent, représenter un faucon chassant une oie, était comme aujourd’hui représenter, à la proue d’un navire, une jeune femme les bras écartés, maintenue par son amant, en référence évidente au film Titanic. Une scène qui évoque aujourd’hui un amour impétueux, faisant fi des frontières du couple, et de la confiance de la jeune femme en celui qui la tient, au péril de sa vie. L’image est à l’opposé de celle du faucon chassant l’oie, avec pour Titanic la confiance dans un amour qui élève, et pour Le Conte du Graal l’abandon de l’amour qui blesse. J’aimerais maintenant pousser plus loin l’analyse entamée dans les chapitres précédents, car Le Conte du Graal appelle à différents degrés de lecture. Au-delà de l’abandon et de l’amour qui blesse, regardons ce que nous enseigne une relecture à la lumière du texte d’Henri Rey-Flaud, Le sang sur la neige : analyse d’une image-écran de Chrétien de Troyes [10].
Commençons par un résumé de ce qui précède les trois gouttes de sang, selon l'adaptation en prose moderne de Marie Cadot-Colin [15] :
Perceval arrive au château de Beaurepaire où il demande l’hospitalité pour la nuit. Une jeune fille maigre et pâle l’accueille par ces paroles : « Seigneur, vous l’aurez (l’hospitalité), mais je crains que vous n’ayez à la regretter. Nous ferons cependant de notre mieux pour vous recevoir. » Quatre gardes le conduisent à Blanchefleur, la châtelaine, resplendissante dans « un bliaut de pourpre sombre étoilé d’or et fourré d’hermine. Quant au manteau qui la couvrait, son encolure était bordée de zibeline noire et blanche. Dieu lui avait donné une beauté incomparable : ses cheveux blonds, dénoués sur ses épaules brillaient comme de l’or au soleil. Son front était blanc et poli comme de l’ivoire, et ses yeux vifs et riants avaient l’éclat des étoiles. Son visage au teint de rose mêlait le vermeil et le blanc. Pour ravir le cœur et la raison des hommes, Dieu avait fait d’elle une pure merveille. » Notons l’association du cœur et de la raison, de la licorne et du lion. Le contraste est saisissant entre la désolation du château qui ne mérite plus son titre de Beaurepaire et Blanchefleur, véritable diamant dans la roche. Elle est d’une beauté qui en appelle à la divine création.
Sans hésiter, Blanchefleur saisit la main de Perceval et le conduit dans une belle chambre où elle s’installe côte à côte avec lui sur un lit recouvert de soie dorée. Quel accueil ! Les gardes présents dans la chambre chuchotent entre eux : « S’ils n’étaient pas muets tous les deux, ils iraient parfaitement ensemble. Dieu semble les avoir faits l’un pour l’autre. » Lorsque Perceval et Blanchefleur se décident enfin à parler, nous apprenons que Blanchefleur est la nièce du noble chevalier Gornemant de Goort, le tuteur en chevalerie de Perceval qu’il vient de quitter pour suivre sa quête. Ils partagent un repas frugal, composé de six miches de pain portées par un religieux et d’un chevreuil tué le matin d’une flèche.
La nuit venue, Perceval s’endort dans un lit qui lui a été préparé dans la salle. Blanchefleur, elle, ne parvient pas à dormir et elle se résout à rejoindre Perceval, non par amour nous dit-on, mais pour demander de l’aide à son ami loyal. Vêtue d’un court manteau de soie pourpre sur sa chemise, elle vient s’agenouiller à ses côtés, « pleurant si fort que ses larmes coulaient sur le visage du jeune homme. » Perceval, l’apercevant, l’attire à lui et la prend dans ses bras. Blanchefleur tente de clarifier la situation : « Pour l’amour de Dieu, ne vous imaginez pas que je cherche à commettre quelque folie en venant vous trouver ainsi, presque nue. » Elle lui explique son chagrin et ses tourments. Le lendemain, après une année de siège, le sénéchal Clamadeu des Îles doit s’emparer de Beaurepaire et de Blanchefleur. Elle aimerait mieux se donner la mort. Perceval promet de la sauver, il la prend contre lui et l’embrasse, puis ils passent la nuit côte à côte, dans les bras l’un de l’autre. Le lendemain Perceval triomphe du sénéchal. Il lui fait grâce et l’adresse au service du roi Arthur. Blanchefleur conduit Perceval dans une chambre où ils échangent baisers et paroles tendres. Mais alors qu’ensemble ils coulent des jours heureux, Perceval pense à sa mère, il se demande si elle est toujours en vie après être tombée d’évanouissement à son départ. Il finit par se décider à quitter Beaurepaire, abandonnant Blanchefleur à son profond chagrin.
Tout commença par un amour au premier regard, suivi de la promesse d’une longue vie heureuse, comme sur Toucher et Odorat. Mais Perceval abandonne Blanchefleur, comme sur Ouïe la licorne abandonne la dame. C’est un chagrin qu’il ne faut pas prendre à la légère. Justement la mère de Perceval est morte du chagrin causé par le départ de son fils. La scène se rejoue, Blanchefleur ne parvient pas à le retenir. Prenant conscience du premier mal et tentant de le réparer, Perceval en cause un second qui met en péril le présent pour racheter le passé. Perceval quitte la femme pour retrouver la mère, qu’elle soit morte ou vivante, c’est la fuite de l’homme devant l’inquiétante inconnue de la femme.
Après Beaurepaire, Perceval est accueilli au château du roi pêcheur. Alors qu’il participe au banquet, il voit passer devant lui un jeune homme tenant une lance qui saigne, accompagné d’une jeune fille portant un Graal d’or pur orné de pierres précieuses. « Il vint alors une si grande clarté que les chandelles perdirent la leur, comme les étoiles quand le soleil ou la lune se lève. » Perceval veut demander, mais il reste muet. Le lendemain, il fait la rencontre de la jeune fille éplorée qui tient dans ses bras le corps de son ami décapité. Elle apprend à Perceval qu'il n’existe aucun château à vingt lieues, lui révélant la dimension fantastique du château du roi pêcheur. Elle l’interroge sur la procession et aussitôt elle l’avertit qu'un grand malheur viendrait du fait qu’il n’a pas demandé à qui et pourquoi l’on portait le Graal, que s'il l’avait demandé, le roi en aurait été guéri. Elle lui demande son nom et c’est en le prononçant qu’il apprend qu'il se nomme Perceval le Gallois. Elle lui enseigne que sa mère est morte de chagrin à son départ. Perceval qui avait promis à Blanchefleur de ramener sa mère, qu’elle soit morte ou vivante, ne sait que faire puisqu’elle est depuis longtemps sous terre. Il ne sait quel chemin suivre. Il choisit de venger la jeune fille éplorée et fait la rencontre d’une autre jeune fille, épuisée et désespérée, qui n’est autre que celle qu’il a rencontrée au début de sa quête et dont il a causé le déshonneur par la maladresse d’un baiser. C’est à cet instant que sort du bois l’Orgueilleux de la Lande, son amant décidé à décapiter quiconque renouvèlerait le déshonneur. Perceval triomphe d’un violent combat et accorde grâce à l’Orgueilleux, à condition qu’il accorde pardon à sa dame et qu’il se mette au service du roi Arthur.
Le roi, ayant reçu à sa cour les vaillants chevaliers que sont le sénéchal et l’Orgueilleux, fait serment de trouver et de prendre à sa cour Perceval qui a fait preuve de si hautes qualités chevaleresques et de tant d’honneurs à son égard. Il part sans attendre à sa recherche et le soir venu, il établit son campement dans une prairie, à la lisière de la forêt. C’est par un hasard de l’intrigue que de bon matin, Perceval arrive sur la même prairie et qu’il s’y déroule, au seuil de la rencontre, la scène qui nous intéresse, cette scène des trois gouttes de sang sur la neige (adaptation en vers modernes d’Henri Rey-Flaud [10]):
« Et avant qu’il arrivât aux tentes,
volait une troupe d’oies
que la neige avait éblouies.
Il les a vues et entendues,
car elles étaient en fuite
à cause d’un faucon qui arrivait à grand bruit
derrière elles à toute allure,
jusqu’à ce qu’il en trouvât une à sa portée
qui était séparée des autres.
Il l’a frappée et heurtée,
si bien qu’il l’a abattue contre terre.
Mais il était trop tard, il l’a laissée.
Il ne voulut pas se lier et se joindre à elle.
Alors Perceval se met à éperonner son cheval.
Vers là où il avait vu le vol.
L’oie était frappée au col.
Elle saigna trois gouttes de sang
qui se répandirent sur le blanc :
on eût dit une couleur naturelle.
L’oie n’a ni blessure ni douleur
qui la retînt contre terre,
pour qu’il pût arriver sur les lieux à temps :
elle s’était envolée auparavant.
Et Perceval vit foulée
la neige qui s’était trouvée sous l’oie
et le sang qui était encore visible.
Il s’appuya sur sa lance
pour regarder cette « semblance »,
car le sang et la neige rapprochés
lui rappellent la fraîche couleur
du visage de son amie.
Il y pense tant qu’il s’oublie. »
Perceval s’oublie dans une ressemblance non seulement entre le visage de son amie et le rouge du sang sur la neige, mais entre deux couples, le faucon et l’oie, lui et Blanchefleur. C’est une rencontre avec lui-même, une connaissance impalpable, mais éblouissante de vérité. Le faucon, dans sa chasse amoureuse, a pris l’oie sauvage, elle a chuté. Mais il a refusé de « se lier et de se joindre à elle », termes curieux dans la circonstance et qui évoquent d’évidence autre chose que d’achever sa proie. Le faucon ne va pas au bout, il fuit, comme Perceval vient de le faire en abandonnant Blanchefleur à Beaurepaire. Pourquoi Perceval est-il si hésitant ? Il fait tout à moitié, il reste muet devant le Graal et il ne se lie pas à Blanchefleur. Il en prend subitement conscience et lance son cheval, mais lorsqu’il arrive, l’oie s’est envolée, il est trop tard, le Graal est passé, il a abandonné Blanchefleur à ses larmes et il se sent subitement emporté par le regret.
Que s’est-il véritablement passé ? Dans une étreinte brutale, le faucon a heurté l’oie qui a chuté. Elle n’a eu ni blessure ni douleur, pourtant elle laisse trois gouttes de sang sur la neige. Comme des gouttes de sang sur les draps des amants, ce serait dire que le faucon se serait lié à l’oie. Le Conte nous dit l’essentiel sans nous le dire, comme souvent. Ce que craint Perceval, ce qu’il a fui, au motif de retrouver sa mère, c’est le coït avec Blanchefleur. Henri Rey-Flaud se réfère à une autre ressemblance, celle du manteau rouge sur la chemise blanche dans laquelle Blanchefleur, « presque nue », a rejoint Perceval la nuit de son arrivée à Beaurepaire. Cette nuit et les nuits suivantes, il s’en sera tenu aux baisers, comme il l’avait promis à sa mère.
Ce qu’Henri Rey-Flaud appelle « l’image-écran » est un accès immédiat à l’inconscient dans un songe, dans une révélation directe de ce que Perceval est au fond de lui-même, son envie de se lier charnellement à Blanchefleur. Perceval perçoit l’interdit imposé par la mère, explicitement par l’application du commandement de « se contenter d’un baiser », et plus singulièrement par la figure de la mère qui se dresse contre la femme. C’est une rencontre avec la pulsion, avec la part d’ombre. Perceval découvre le mal qu’il a commis par ses maladresses, de sa mère morte de chagrin à son départ, du roi pêcheur qui par sa faute ne guérira pas, de la jeune fille dont il a causé le déshonneur par un baiser sous la tente, de la jeune fille éplorée dont l’amant est mort en conséquence du premier méfait, et surtout de Blanchefleur, son amour abandonné.
La prairie est l’écran éblouissant de la neige ensoleillée sur lequel se dévoile, telle une troupe d’oies sauvages, le cortège de regrets de Perceval. Avant d’arriver à la rencontre d’Arthur, c’est la véritable quête de Perceval qui s’achève. Il parvient subitement à une pleine compréhension de lui-même. Il est brutalement confronté à ses démons intérieurs, ses pulsions, ses désirs, la raison de sa fuite. Cependant il ne peut plus fuir, il ne peut pas échapper à l’éclat de son ombre qui s’impose si subitement à lui. Nous touchons à la profondeur psychique de Chrétiens de Troyes, qui par un beau hasard ou par volonté, accompagne admirablement le cheminement de la dame dans les Tapisseries.
Les trois gouttes de sang font d’Ouïe un instant de prise de conscience, de révélation douloureuse de la part inavouée, ombrageuse, sauvage de l’être. La dame qui entreprend le noble chemin de la quête spirituelle doit rencontrer son ombre. Aussi grande soit sa soif spirituelle, l’ombre demeurera en elle. Pour que la quête aboutisse, la dame devra la connaître, la maîtriser, la dresser et surtout, la satisfaire. Elle devra réaliser une étrange alchimie d’ombre et de lumière, d’espoirs et de regrets.
Retour sur l’amour qui blesse - Perceval s’oublie devant trois gouttes de sang sur la neige
L’idée que je me suis longtemps faite de l’alchimie tenait à un souvenir télévisé de mon enfance. J’avais vu ce reportage de Faut pas rêver sur France 3, en famille le vendredi après Thalassa. C’était un documentaire sur un alchimiste de notre époque. Il descendait à certaines marées, recueillir l’écume qu’il déposait sur de lourdes toiles qu’il tirait ensuite lentement, veillant à ne pas altérer son fragile trésor, jusque dans son atelier, son laboratoire, où il traitait cette mousse précieuse comme l’or. Elle était d’évidence la matière désignée par un texte ancien, le fruit d’une réduction par l’action des vagues qui changeait l’eau et son sel, qui capturait la brume comme un fragment de nuage. Il allait aussi par une certaine Lune, sur une prairie d’une certaine exposition, prélever une fine rosée née par condensation de l’aurore (ou « l’or or »). Je me sentais porté par ces expressions de quintessence. Je voyais l’alchimiste travailler ce nouvel or avec de longs outils taillés par la main de ses maîtres, usés, mais éternellement intacts, protégés par le mystère alchimique. Il utilisait une toile du lin le plus fin pour filtrer l’infime dépôt, l’infime résidu qu’il décollait avant de le porter au four, ce four entretenu par une flamme qui ne s’était pas éteinte depuis les premiers temps de l’art. L’alchimiste parlait avec des mots dont il changeait les sens (ou « l’essence »). Il me semblait loin devant nous, il disait qu’il attendrait, que ses successeurs attendraient, mais que quelque chose s’accomplirait, qu’en réalité quelque chose s’accomplissait déjà. Je m’étais senti transporté, il y avait une musique tourbillonnante et à la caméra un plan sur l’alchimiste s’éloignant sous les voûtes de son laboratoire.
Je m'étais senti troublé. J’en étais resté là. Puis j'ai lu l’Alchimiste de Paulo Coelho qui était touchant, mais qui ne parlait pas vraiment d’alchimie. Plus tard, j'ai lu Introduction à la philosophie occulte d’Alexandrian qui m’a profondément marqué dans mes cheminements récents et qui élève l’alchimie au même rang que la kabbale, celui d’un occultisme mystique. Je ne sais plus si j’ai trouvé la chose énoncée telle quelle, mais je suis arrivé à l’idée de la réforme de l’âme, de la réforme de l’individu, qui changerait les penchants de l’être, qui le débarrasserait des basses tentations et l’appellerait vers les grandeurs et la lumière. Cette idée de réforme, en contemplant Ouïe et Goût, a pris la tournure d’une transmutation de l’âme dont les Tapisseries m’ont semblé être une histoire, un guide, un chemin. Il fallait que je remonte le fil de cette intuition, que je retrouve que le véritable objet de l’alchimie était l’alchimiste lui-même.
L'alchimie
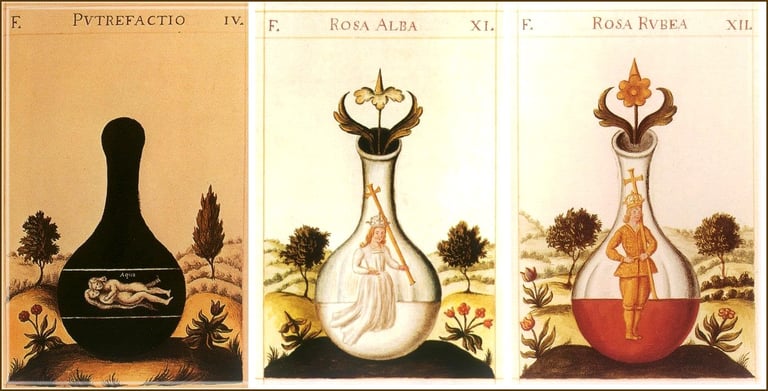

Quelle était-elle, cette alchimie de l’époque des Tapisseries, au crépuscule du Moyen Âge, à l’aube de la Renaissance ? L’œuvre que je vous propose de regarder en introduction est de bien après, de 1795, lorsque l’alchimie était pour de bon séparée de la chimie et abandonnée aux mains d’ésotéristes : L’alchimiste, à la recherche de la pierre philosophale, découvre le phosphore, et prie pour la réussite de son expérience, comme c’était la coutume des anciens astrologues chimistes. Voilà un titre qui en dit long ! On l’appelle aussi L’Alchimiste découvrant le phosphore, de Joseph Wright of Derby. À l’avant, nous voyons un vieillard, ébloui par le prodigieux phénomène dont il est le témoin, un jet de vapeur lumineux s’échappe de l’alambic. Il y aurait une senteur de soufre mêlée à celle des grimoires. Le vieil homme, rendu fou par l’interminable attente, la quête d’une vie, est en extase, il arrête le temps de la main et fait signe à ses apprentis de tenir le silence, devant une vapeur blanche jaillissant des entrailles du four. Agenouillé, immobile, stupéfait, il est tel Moïse devant la manifestation. Son laboratoire est un romantique capharnaüm. L’on voit un globe, des feuillets froissés, une inscription runique sur une pierre fendue à laquelle il manque une partie comme la grande bibliothèque d’Alexandrie oubliée aux flammes. Une urne blanche défie l’équilibre sur un amas de livres au-dessus de sa tête. Au sol, une amphore contient le combustible du feu immortel, un tison repose contre le muret et d'un étrange four en brique jaillit une fumée lumineuse, hermétiquement conduite vers l’alambic. Chaque chose ici a acquis la patine du temps, de la main d’homme, d’un seul homme, l’alchimiste dont la barbe et les rides se sont patiemment formées à l’ouvrage, ici-bas. Une pleine Lune paraît derrière la fenêtre gothique, c’est à sa lumière douce et enchantée qu’éclot le mystère.
Derrière, nous voyons deux jeunes apprentis. Le premier, vêtu simplement, assis à la table de l’étude, éclairé par la flamme de la connaissance, travaille sur un mortier. Le second, debout, lui désigne le vieil homme auquel ils ne daignent, ni l’un ni l’autre, accorder un regard. Les bocaux et les alambics reposent en ordre sur les étagères. Les voûtes rappellent l’assise de la science expérimentale. Le vieil homme leur fait signe de garder le secret, eux n’ont que faire du Grand Œuvre. Ils ne peuvent voir la lumière, masquée par le voile vert de la connaissance, ils ne savent pas encore l’immensité de la découverte. Car c’est bien lui, le fantasque, qui a fait la découverte du phosphore lumineux. Peu après, le vieil alchimiste disparaîtra avec ses arts anciens, il aura fait le lit des sciences modernes qui n’auront que faire de lui et du souffle romantique dont il revêtait la nature.
Les alchimistes nous ont tout juste laissé leur adjectif, « alchimique ». Nous l’utilisons pour parler d’une entente entre deux personnes, comme dans « Il y a eu une alchimie immédiate entre nous. » C’est une façon de dire qu’il y a eu de l’art et de la beauté, de l’écoute et de la grâce. Nous aurions presque pu dire « magique », mais dans « alchimique » il y a une part de sens, une part qui sous-tend l’âme. Nous disons « alchimique » en laissant flotter un mystère, sans dire si nous y croyons, ou non, à l’alchimie. Il faut admettre que le résultat est là, une entente sublime qui porte en elle une part indicible. Presque contre toute attente, les opposés se sont unis. Nous laissons planer une ambiguïté, qu’il puisse en être des esprits comme de la matière, sujets à des forces et à des équilibres, à des réactions complexes, à l’effet d’agents précipitants et de conjonctures thermiques et dynamiques, dont l’art produit des résultats prodigieux. Pour parler de ces réactions, nous ne disons pas « chimique », ce qui serait se rabaisser aux phéromones de la corporalité de nos êtres. Nous voulons donc parler d’une autre chimie. Et à juste titre, car ce qui conjugue les choses dissemblables, ce qui s’observe sans véritablement se comprendre et qui laisse par-là imaginer qu’il y a plus à savoir non sur le mécanisme de la réaction, mais sur la nature de la chose, sur la nature de l’esprit et ses aspirations, touche aux grands secrets. C’est ce pour quoi un homme a consacré sa vie à frapper le métal, à respirer les émanations de soufre, à copier de vieux grimoires où la raison s’égare, et à imposer le silence et l’immobilité de l’extase, lorsqu’à un instant le Grand Œuvre se produisit et qu’il reçut la connaissance sans paroles, la totalité du mystère de la nature des corps, des esprits et des âmes.


L'alchimiste découvrant le phosphore
Revenons aux Tapisseries. L’époque où elles furent tissées, un peu avant ou un peu après 1500, selon qu’on pense qu’elles sont la commande de Jean ou d’Antoine II Le Viste, est le début de l’âge d’or de l’alchimie. Importée d’Orient, elle avait peu à peu séduit les esprits au Moyen Âge, avant de connaître sa pleine expansion à la Renaissance. L’alchimie, cette tradition nouvelle, à la fois art, science et philosophie, séduisait les esprits les plus éminents et rayonnait comme la voix de l’ultime vérité, aussi promesse d’or à profusion et de vie éternelle. Assurément, les Tapisseries sont nées d’un esprit sachant un peu d’alchimie, simplement parce que toutes et tous, à l’époque, en savaient au moins un peu. Peut-être beaucoup, nous verrons, mais un peu suffit d’abord.
À la cour et chez les bourgeois, si ce n’est dans le détail de ses symboles et de ses correspondances, on en savait l’essentiel, l’ambiance et une certaine tournure d’esprit. Je me l’imagine comme nous savons aujourd’hui, sans pouvoir en refaire les démonstrations, sans nous souvenir très bien des termes et des valeurs, l’état d’esprit des sciences, de la médecine, ou de l’astronomie. Nous avons une idée partagée du fonctionnement du corps, de l’esprit et du cosmos. Nous sommes les enfants spirituels des sciences modernes qui ont établi nos limites du possible.
Conscients de cela, pour nous intéresser à l’alchimie dans les Tapisseries, il faudra changer, au moins le temps de nos réflexions, il faudra changer de modus operandi, basculer dans d’anciens référentiels, accepter l’enseignement du légendaire Hermès Trismégiste, le trois fois grand, l’enseignement gravé sur une table d’émeraude, que « Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut ; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une seule chose. » C’est à cette condition que nous approcherons notre regard et notre esprit de l’œil et de la pensée d’un autre siècle.
Des métaux au Grand Œuvre
Littré définissait l’alchimie comme une « chimie du moyen âge, qui, au lieu d’avoir pour but l’étude de la composition des corps, cherchait la panacée, ce remède universel, et la transmutation des métaux. » [8] Voilà une définition qui a traversé les époques, celle d’un résultat opératoire, la pierre philosophale qui change le plomb en or, qui soigne tous les maux et qui offre la vie éternelle. C’est une définition qui laisse entendre un art de charlatans ou d’esprits égarés. C’est une définition assez proche tout de même des racines authentiques de l’alchimie, l’œuvre de corporations de forgerons égyptiens, maîtres dans l’art des alliages auxquels ils savaient donner l’apparence et la brillance de l’or le plus pur. C’est un art qui fit frémir les empereurs, puisqu’il menaçait la valeur marchande de la monnaie la plus universelle, l’or. C’est donc un art qui a tôt été interdit, codifié, qui s’est couvert du voile du mystère pour nous parvenir par des mots en fausse trappe, des allusions cosmiques et des enchevêtrements de symboles.
Heureusement, il y a plus dans l’alchimie que la dimension opératoire. Ce contact avec la matière, les métaux en fusion et les quatre éléments, tout cela allant et venant dans l’athanor (du grec a-thanos, le four dont le feu ne meurt pas), ont constitué le rite d’une spiritualité nouvelle. Le Grand Œuvre, la fabrication de la pierre philosophale, suit le processus suivant : d’abord l’alchimiste doit se procurer la materia prima, ce matériau primitif qui contient toutes les potentialités, égal de la glaise dont Dieu fit Adam et Ève. Cette materia prima tient de la rosée au solstice, ou de la pierre extraite des plus hauts sommets. Déjà les alchimistes nous perdent à savoir ce qu’elle est véritablement, et chaque école garde jalousement sa source secrète. De cette materia prima, par des préparations et des cuissons dont les méthodes sont ici aussi transmises sous couvert du secret, les livres ne parlant presque jamais de fours et de métaux, mais d’allégories fantasmatiques et philosophiques, gardant telle ou telle partie du produit, l’alchimiste va séparer peu à peu le pur de l’impur pour former le mercure, qui est le pôle féminin, fécond, lunaire ; et le soufre, pôle masculin, fécondant, solaire. Par sublimation, l’alchimiste combinera le mercure et le soufre en un matériau composite, androgyne, le lapis. Ce lapis, cette matière surnaturelle, dépassant la perfection de la nature, agira comme un aimant qui attirera à lui, dans certaines conditions propices, l’Esprit universel, le souffle créateur de la Genèse, formant la pierre philosophale, capable de transmuter le plomb en or.
Ce processus suit quatre étapes qui étaient déjà énoncées dans le premier traité alchimique, le Physika kai Mystika (Des choses naturelles et des choses cachées), attribué à Démocrite et devenu relativement célèbre à la fin du IVe siècle : l’Œuvre au noir (nigredo) de mort et putréfaction, l’Œuvre au blanc (albedo) de purification, l’Œuvre au jaune (citrinitas) de sublimation qui unifie les contraires, et l’Œuvre au rouge (rubedo) de l’avènement de l’Esprit universel dans la matière. Partis de ce chemin partagé, il n’y a pas deux expressions du Grand Œuvre qui soient identiques. Les termes et les images changent sans cesse, les étapes se multiplient ou elles s’inversent.
Le Grand Œuvre est œuvre mystique, puisqu’il promet la rencontre de Dieu de notre vivant par l’attraction de l’Esprit universel. Une singularité de la mystique alchimique est qu’elle ne dénigre pas la matière de ce monde. Par purifications successives, par l’association des antipathies, par la sublimation du soufre et du mercure, elle restitue l’androgynat primitif, le lapis, qui tel un aimant, attire en lui l’Esprit universel. Ce qui est en bas a commandé à ce qui est en haut.
La langue alchimique
Les textes alchimiques sont cryptés par la racine, par le mot. Des mots qu’il faut entendre selon la langue des oiseaux, celle qui se fie à l’oreille, selon laquelle « terre » signifie « taire », « la magie » signifie que « l’âme agit », ou « les sens des mots » signifie « l’essence des mots ». Le langage alchimique est aussi celui des allégories. Par une correspondance entre les astres et les métaux, trois lunes indiquent trois mesures de mercure, le soleil représente à la fois le soufre et l’or, on s’y perd, c’est voulu. L’écriture alchimique est une brume qui s’épaissit à mesure qu’on l’observe. On sent de façon oppressante la limite des mots, la punition des langues de Babel, indignes de prononcer les secrets et les mystères. Il faudrait retrouver la langue première, la prisca sapientia, la langue dans laquelle Dieu fit à Adam le don du Verbe, « la langue originelle paradisiaque qui nomme les choses de leur vrai nom ». [16]
Il y a aussi les images, les intrigantes, les magnifiques images alchimiques. Leur frontière avec le texte s’estompe dans un effort d’écrire au-delà du raisonnable, de penser par les yeux le hiéroglyphe, le diagramme ou la tapisserie, avec la simplicité de ce qui s’appréhende tout entier. L’image parle aux deux niveaux de la perception : au voir, passif, du profane ; et au regarder, actif, de l’initié ; puis à nouveau au voir de l’initié, qui laisse venir à lui l’ineffable du mystère. L’image alchimique invoque « l’action de voir » chère à Merleau-Ponty. Elle suscite l’intuition, ce vague pressentiment, cette bordure de la perception à laquelle nous n’autorisons pas aujourd’hui de vie propre, sous le joug de la lumière de la raison. C’est en lisière qu’apparaît l’essentiel, au crépuscule ou à l’aurore. C’est sur la brisure que saillissent les précieux détails.
Cette lisière, cet indécis qui laisse l’esprit compléter sans le dire la part absente, est le propre du délire comme on parle en psychiatrie de délire de mécanisme intuitif. Il y a aussi le mécanisme interprétatif. Ce sont au fond les principaux mécanismes créatifs de cet ouvrage sur les Tapisseries que vous tenez entre vos mains. J’en appelle à la part déraisonnable de votre esprit, celle qui s’éteint sous l’œil de la raison. Les Tapisseries, comme l’alchimie, attendent de nous le délire, le détachement du lion raisonnable, pour une nuit avec la licorne spirituelle. Il faut du délire, il faut dé-lire ce qui a été écrit et voir à nouveau, voir jusqu’à l’envers du miroir. S’en tenir à la raison, ce serait se priver d’une part de nous qui ne demande qu’un peu de place, qu’un peu d’indulgence, pour cesser de fuir sous les mouvements des yeux, et nous révéler, telle la craintive perruche, les hauts trésors spirituels.
L’imagier alchimique et les Tapisseries
L’unique référence directe à l’alchimie que je reconnaisse absolument dans les Tapisseries est le soufflet d’Ouïe, ce soufflet qui transmute la souffrance de la dame en une mélancolique élévation de l’âme. En forçant un peu, je trouverais la licorne, dont la corne était considérée comme le remède de tous les maux, la panacée. Il y a aussi le mercure alchimique qui est le lion vert et la pierre philosophale qui est le lion rouge. La licorne symbolise tantôt le mercure [17], tantôt le soufre [18].
Je dois à un ami très cher la lecture du passage sur les Tapisseries dans l’Alchimie d’Eugène Canseliet [19]. Au sujet de Toucher, Canseliet a l’élégance de refuser l’interprétation scabreuse de la main qui excite la corne à laquelle il préfère l’équivoque « La main doit être experte et pure pour la manœuvre de cette verge, dont dépend que l’eau mercurielle et lumineuse jaillisse du rocher. » Il nous offre ensuite une interprétation de l’héraldique de la famille Le Viste, ces gueules à bande d’azur, meublées de trois croissants :
« La lune de poids tiers, pour la raison que, le sujet étant d’excellente qualité et convenablement préparé, la fraction mercurielle, qui en est recueillie à la fin de la première opération, pèse, à peu de chose près, trois fois moins que la totalité engagée au début. Le lion rouge, portant, en bandoulière, l’écu aux trois lunules en position ascendante, est emblématique de l’esprit lumineux, c’est-à-dire du soufre igné ou sperme minéral, qui illuminera, en l’embrassant et la fécondant, la matière mercurielle, suffisamment mondée pour le recevoir, à la suite des trois réitérations de la même épreuve par le sel et le feu (Pl. XII). C’est alors que l’artiste, comme le lion hermétique, peut faire sien le verset 11 du Psaume XCI de David : « Et mon bien sera élevé comme la corne de la licorne, et ma vieillesse dans la miséricorde féconde. » »
Vous qui êtes déjà un peu initié, vous aurez compris qu’il est question de l’union du mercure féminin représenté par la lune purifiée et du soufre fécondant représenté par le lion solaire, dont l’effet est la descente de l’Esprit universel dans le lapis androgyne, la corne, la panacée, l’élixir de longévité. Tout ceci à la grâce de Dieu, par la main pure et experte de la dame. Alambiqué et hermétique, peut-être, mais assurément merveilleux !
L’alchimie des Tapisseries n’est pas dans les formes, elle est dans la profondeur, dans l’esprit, dans la méthode. Plus je scrute les Tapisseries, plus je les questionne et plus je suis ébloui par leur magnificence, car chaque fois que je cherche, je me trouve récompensé. L’imagier alchimique présente trois caractéristiques et toutes sont présentes dans les Tapisseries. La première de ces caractéristiques communes est la mise en scène d’antagonismes qui opèrent un retour à l’androgynat primitif, tels que l’homme et la femme, le roi et la reine, le Soleil et la Lune comme dans Le poème de Sol et Luna. La seconde caractéristique est l’inscription de notices que l’on qualifiait de hieroglyphica. Amphitheatrum sapientiae aeternae en porte une douzaine, du sol au plafond, et son oratorium rappelle la tente de Désir. La troisième caractéristique est une mise en ordre des images en une série narrative, un véritable scénario du Grand Œuvre, comme dans Splendor Solis, Aurora consurgens ou Donum dei.
Les Tapisseries partagent ces trois caractéristiques. Le principe de dualité est central, la dame est entre le lion et la licorne, la raison et le cœur, le rationnel et l’irrationnel. Désir porte la plus célèbre des hieroglyphicas, le fameux « Mon seul désir », dont nous avons vu les différentes interprétations, entre tempérance et intempérance. Surtout, au nombre de six, les Tapisseries forment une série narrative, il s’agit du chemin même de notre quête.
Selon la lecture classique, les tapisseries des cinq sens ne sont qu'un prélude à la plus grande des tapisseries, celle qui se distingue par sa notice. Les cinq sens sont soumis au sixième, celui du cœur. Pour se référer à Hermès, dans Désir, ce qui est en haut dicte à ce qui est en bas, la puissance divine commande au bas monde. Nous pouvons aussi suivre l’humble chemin des lapins, chemin qui nous conduit à une plus petite tapisserie, Vue, petite comme un terrier, des lapins qui nous conduisent à la suite d’Hermès, là où ce qui est en bas commande à ce qui est en haut, là où s’opère le miracle.
Toucher est le premier contact de la dame avec la licorne. Elle est jeune, belle, audacieuse, triomphante. C’est une révélation, elle fait l’expérience pleine, immédiate, pure, d’une spiritualité qui déborde la raison. Un bref instant, elle a perçu l’étendue des mystères. C’est une illumination complète, sauvage, c’est une explosion intérieure dans un cœur pur, mais entravé, comme les bêtes sauvages dans l’herbe. La dame n’est pas prête pour l’expérience entière de la rencontre mais elle est déterminée à le devenir. Odorat est l’engagement sur la voie spirituelle, ce sont les promesses du mariage, de la fidélité à l’être aimé. La dame s’engage sereinement sur le chemin, insouciante des vicissitudes qui l’attendent. C’est un état qui ne connaîtra qu’un temps, fugace comme le parfum d’une fleur. Ces fleurs coupées faneront bien vite, à la différence des roses de Goût, de ce rosier qui ne cesse de croître et qui fleurit au cycle des saisons. Maintenant, souvenons-nous des quatre étapes du Grand Œuvre : l’Œuvre au noir de la mort et de la putréfaction, l’Œuvre au blanc de la purification, l’Œuvre au jaune de la sublimation unifiant les contraires, et l’Œuvre au rouge de l’avènement de l’Esprit universel dans la matière.
Ouïe est l’Œuvre au noir de la mort et de la putréfaction. La dame est confrontée à la souffrance, à l’amour qui blesse. L’élan spirituel l’a quittée. Dans le ciel, c’est le triomphe du cruel faucon, de la pulsion, de l’ombre. La dame est comme l’oie sauvage qui chute. Ce serait le triomphe de l’ombre s’il n’y avait l’orgue qui change la souffrance en une réconfortante mélopée. Malgré l’épreuve, la dame retrouve le chemin de la quête spirituelle, elle ne s’est pas noyée dans les flots de la mélancolie, elle a rencontré son ombre et elle en sortira grandie. L’étude de Chrétiens de Troyes avec l’image-écran nous a mis sur la voie : la dame rencontre l’ombre, tout est brusquement révélé à sa conscience, le plus violent, le plus honteux, le plus irrépressible s’étalent subitement sous ses yeux. C’est une épreuve que de surmonter ce traumatisme, de s’accepter, d’accepter tout ceci en tant que réalité inévitable, de la saisir, bien que toute déconstruite et morte, pour se reconstruire et renaître.
Désir est l’Œuvre au blanc de la purification. La dame se débarrasse de ses bijoux, elle remonte les bracelets de la servitude et elle ôte son voile. Elle se dirige vers la tente de la prière, elle soumet ses pulsions à « son seul désir ». Le faucon est enchaîné et l’oie est libre. À l’issue de cette purification elle sera pleinement maîtresse d’elle-même, elle aura dressé le cruel faucon qui la défendra le moment venu. Surtout elle renaîtra, dans un rapport nouveau au monde, devenue l’initiatrice de la perruche et de la licorne.
Goût est l’Œuvre au jaune de la sublimation qui unifie l’inconciliable. La dame a dressé le faucon, à présent elle apprivoise la perruche. Ce qui se déroule là, cette parfaite harmonie, le voile bordé de perles soulevé par la brise, le lion et la licorne dans leurs capes de triomphe, l’équilibre entre la spiritualité et la raison, ce qui se trame dans la roseraie, la perruche qui déploie ses ailes tandis que la dame lui offre une perle, cet équilibre nous le devons au faucon que la dame a su dresser, le faucon qui poursuit sa vie d’ombre et chasse la pie du ciel. La spiritualité n’empêche pas la connaissance des périls de ce monde et il est bien légitime de savoir faire preuve de force contre ces menaces, c’est la condition de la paix et de l’harmonie de la roseraie. La dame a dressé l’ombre à son profit. La scène est splendide. La servante agenouillée tient un ciboire rempli de perles, comme l’enfant de chœur porte les hosties au prêtre. La dame vêtue d’or, sous un voile rose bordé de perles, devient la prêtresse d’une religion nouvelle. Elle a uni la perle de l’âme à la perruche, l’oiseau du verbe. Et puisque le verbe formule l’esprit, c’est l’union de l’âme et de l’esprit. La perle manifeste l’âme, elle la fait corps, comme la perruche et la dame sont de chair. C’est l’union absolue du corps, de l’esprit et de l’âme. Bien sûr, la perruche parle la langue des oiseaux, la langue alchimique, ou mieux, la prisca sapientia, celle d’Adam découvrant le verbe. La dame, en grande initiatrice, a accompli la sublimation de l’Œuvre au jaune. Il y a aussi toutes les unions qu’entend l’équilibre de l’harmonie qui règne dans Goût : raison et spiritualité, ombre et lumière, intérieur et extérieur. Mais le plus important est l’androgynat, c’est le lapis, matière digne d’attirer à elle l’Esprit créateur. Je pense à ces paroles de Saul Williams : « get my soul tattooed to my tongue ». Bien sûr je pense également à l’Évangile de Jean : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. »
Vue est l’Œuvre au rouge. Dans une imperturbable solennité, sous son regard mi-clos, la dame présente à la licorne son reflet. L’âme a été unie à l’esprit dans Goût, à présent l’artéfact de la perle ouvre la surface du miroir et la licorne bascule dans son reflet. Comme le prince de l’Hymne s’élèvera dans son reflet à mesure que son corps s’éloignera de la surface du miroir, la licorne monte dans les espaces astraux, demeurant unie à la dame dont l’œil voit au-delà des horizons matériels. La licorne rencontre l’Esprit universel, l’ineffable, le souffle créateur. C’est le dépassement de la perfection du créé, c’est le Grand Œuvre, la transcendance, l’union du matériel et du spirituel. Comme l’alchimie, les Tapisseries ne font pas le procès du monde. Elles en font le vecteur d’une union des contraires qui, par une spiritualisation de la matière, nous unit au divin. Par l’audace d’une opération longue et singulière, la matière a commandé à l’autre monde. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Tentative de rejoindre la pensée d'un alchimiste médiéval


Mondanités préliminaires
Il y a polémique à savoir qui fut le commanditaire des Tapisseries.
Il a longtemps été considéré que Jean IV Le Viste les avait commandées pour sa présidence à la cour des Aides en 1484. [20]. En 2010, l’idée a émergé qu’il puisse s’agir du neveu, Antoine II Le Viste, devenu chef de famille à la mort de Jean IV en 1500 et qui fut prévôt des marchands (équivalent actuel du maire de Paris) et président au parlement de Paris jusqu’à sa mort en 1534 [21].
La lecture courtoise de la devise « Mon seul désir » fait dire qu’Antoine II aurait commandé les Tapisseries pour ses fiançailles avec Jacqueline Raguier (entre 1500 et 1510). Le moment est venu de saluer le travail de Jacky Lorette qui, dans son immense site internet dédié aux Tapisseries [web2], émet l’idée qu’Antoine II ait pu fréquenter un certain Jean Perréal. Bien que nous n’ayons pas de preuve de cette amitié, elle reste vraisemblable. Jean Perréal était premier valet de chambre du roi, peintre de Charles VIII, de Louis XII et de Philippe Ier. Il était aussi architecte et écrivain. Il allait et venait entre sa ville natale de Lyon et Paris, comme Antoine II (et comme une grande partie de la noblesse à l’époque). Donc oui, certainement s’étaient-ils au moins croisés.
Jacky Lorette n’hésite pas à défendre l’idée que Jean Perréal, spécialiste en miniatures, aurait lui-même réalisé les cartons des tapisseries. Peut-être. Les spécialistes de Cluny pencheraient plutôt pour un certain Jean d’Ypres. Ce qui importe est l’ambiance dans laquelle les Tapisseries ont été conçues, c’est de savoir dans quel bain de culture baignaient ces esprits. Concernant Perréal, on en sait justement plus que sur Antoine II. Perréal était d’une façon ou d’une autre lié à Cornelius Agrippa, l’inventeur du terme de philosophie occulte, un homme qui dans une lettre qualifia Perréal « (d’) homme très digne, son tout ami » [22]. Agrippa fut tantôt accueilli pour son érudition, tantôt chassé pour sa liberté de pensée. On sait qu’il fut un temps accueilli à Lyon, peut-être par l’entremise de Perréal ou d’Antoine II.
Vous imaginerez quelle fut mon excitation quand j’appris qu’Antoine II aurait fréquenté en Perréal l’auteur, à l’automne 1516, d’un long poème intitulé La Complainte de Nature à l’Alchimiste errant, ou Remontrances de Nature à l’Alchimiste errant. L’illustration de ce poème, une miniature du même nom, représente un alchimiste devant une belle et jeune effigie de Nature assise au pied d’une sorte d’arbre séphirotique. C’est l’image même que je voyais chaque jour sur la couverture de mon nouveau livre de chevet, l’Alchimie et mystique de Roob [16]. Il y avait à nouveau une coïncidence incroyable, une concordance, qui m’encourageait à continuer sur mon chemin. Un chemin que j’ai suivi et dont je pense avoir tiré bien plus que de l’étude bien rangée des coquetteries de la noblesse lyonnaise et de ses dégoulinades généalogiques. Certes, la date de rédaction de Complainte est ultérieure d’une dizaine d’années aux Tapisseries, mais il y a ce qui importe, l’état d’esprit d’un homme, d’un milieu, d’une époque.
Complainte fut longtemps attribué à Jean de Meung, l’auteur du Roman de la rose. L’erreur était facile, puisque les deux œuvres étaient éditées ensemble, que Perréal n’avait pas signé son poème et que plusieurs de ses vers étaient purement et simplement piqués au Roman de la rose. C’est en 1943 qu’André Vernet découvrit sur l’exemplaire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris cet acrostiche dans les dix-neuf vers du prologue : « IEHAN PERREAL DE PARIS ». Sacré Perréal ! Caché dans les lignes, entre le Moyen Âge et la Renaissance. Il manquait à cet exemplaire la désormais célèbre miniature dont nous parlions à l’instant, qui ne sera identifiée qu’en 1960 dans la collection Wildenstein à New York [23]. Ici encore, je remercie Jacky Lorette pour ses précieuses recherches.
Complainte est un étrange poème que Perréal aurait écrit pour son monarque Philippe Ier. Un poème qui répète encore et encore la même histoire, en lui donnant différentes significations et différentes vertus. Il s’agit du Grand Œuvre alchimique : des corps sont placés dans un récipient, un vaisseau, une durée nécessaire, au feu suffisant sans l’enfumer, à profondeur convenable, sans rien ajouter ni rien ôter, afin que se produise une réduction, une purification, une union, une sublimation, une transmutation. Jusqu’où l’opération devra-t-elle aller ? De quelles natures sont les substances et le vaisseau ? Qui opérera de l’alchimiste, de Nature ou de Dieu ? Cela ne cessera de changer, parfois explicitement, parfois implicitement, souvent sous la forme d’une double négation qui invite ou d’une triple qui interdit, avec des termes équivoques à savoir où nous en sommes dans le compte des moins. C’est un poème que j’ai lu et relu et qui me laisse toujours hésitant, au-dehors, à proprement parler hermétique. C’est un poème qui en définitive pose des questions claires mais nous laisse songeurs quant aux réponses.
Un très bref résumé de Complainte
Le poème commence par une longue remontrance de Nature qui reproche à l’alchimiste son insolence et son orgueil, car il n’est ni de son droit, ni de son pouvoir, à lui, homme, d’engendrer autre chose que ses semblables, comme les bêtes engendrent les bêtes. C’est à Nature et à elle seule qu’il est permis d’engendrer les métaux, d’allier les essences, de réduire l’impur, de séparer le soufre et le mercure, d’allier leurs tempéraments contraires et de faire la pierre qui changera le plus vil des métaux en l’or le plus pur. L’exposé du Grand Œuvre est clair. D'évidence, Perréal sait de quoi il parle. Nature ne conteste pas le procédé alchimique, mais elle reproche à l’homme de prétendre détenir ses secrets et de tenter de faire ce qui lui est réservé. L'alchimiste pourra essayer autant qu’il voudra, de sa main jamais il ne parviendra à engendrer les métaux - « Car ce que se fait par nature, Ne se fait point par créature. » Nature insulte copieusement le vil alchimiste, elle le qualifie d’orgueilleux, de coquin, de voleur, de menteur. Elle défend à l’homme la pratique de l’alchimie dans sa voie des métaux et des fourneaux, qu’elle qualifie d’Œuvre mécanique.
Puis Nature expose à l’alchimiste son problème : malgré ses efforts sans cesse répétés, de sa création, seule la nature humaine demeure imparfaite. Bien qu’elle achève la plus haute perfection dans le corps humain, qu’elle qualifie de vaisseau, ce n’est pas à elle qu’appartiennent l’âme et la pensée. Perfection du vaisseau humain et perfection de l’âme semblent deux natures incompatibles et c’est son grand malheur d’observer qu’au lieu que la volonté commande le corps, c’est le corps, par le désir, par la corruption des sens, par l’âme entachée par le péché, qui commande la volonté. C’est pour parfaire sa perfection et rétablir sa pureté que Nature invite l’alchimiste à suivre une autre voie, une voie qu’elle lui indiquera, mais que lui seul peut suivre, celle de l’Œuvre naturel. Quant à savoir comment opérer cet Œuvre naturel, c’est tout le mystère de Complainte.
Bien des interprétations de Complainte s’arrêtent à ce passage établissant une analogie scabreuse entre l'Œuvre alchimique et la copulation :
« Bref le tout d’un seul vif argent,
Masculin soufre très agent,
Fais un seul vaisseau maternel,
Dont le ventre en ait le fourneau.
Vrai est que l’homme par son art
M’aide fort en chaleur arde,
En infusant en la matière
La matière qui est propice :
Mais autre choses n’y sais faire. »
L’alchimiste retrouve humblement sa place dans la Création : fertiliser la femme comme le soufre fertilise le mercure. Perréal qualifie l’organe masculin de « beau vif argent » qu’il mettra dans « le vaisseau bien clos » et il s’accomplira « ce que savez bien faire », et voilà l’art, l’œuvre « occulte et profonde ». Rappelons-nous que Perréal a été un proche de Cornelius Agrippa, inventeur du terme de « philosophie occulte ». Il y a d’évidence un problème. Perréal avait évidemment plus de considération pour le terme d’occulte. Il n’y a pas besoin d’un poème de mille huit cents vingt-deux vers fait par un premier valet à son roi pour nous dire qu’il est du devoir le plus haut et le plus digne de l’homme et de la femme de procréer (telle en tout cas était la morale du siècle). Cette interprétation ne répond en rien au problème de l’âme et de la volonté qui sont corrompues par le corps et les sens, le désir et le péché. La seconde interprétation suit juste après, ou plutôt elle est entremêlée par les malices de l’auteur. Elle n’exclut pas la première, mais le poème ne nous en fournira pas aisément la clé. Il faudra distinguer trois degrés de lecture de Complainte : la transmutation des métaux dans le creuset, la gestation du fœtus dans le ventre de la femme, et la réforme de l’âme dans l’esprit.
L'Œuvre naturel doit plutôt s’entendre comme une voie philosophique : « Que Raison soit ta nourriture : Ton guide soit philosophie. », une voie dont le matériau premier est l’esprit de l’alchimiste : « matière très notable Par philosophes désignée, Et des ignares peu prisée. » Un Œuvre que l’alchimiste doit conduire en un lieu propice qui lui permettra liberté et secret : «Soffit que sois en liberté, Et en lieu qui te soit propice, Que nul sache ton artifice.» Quel lieu plus libre et plus secret que le silence de la pensée ?
Nature ne dévoile pas explicitement la teneur de cette philosophie, elle évoque les romans de Jean de Meung (auteur de la seconde partie du Roman de la rose), Villeneuve (auteur du Rosarius philosophorum - Le rosaire des philosophes selon lequel l’alchimiste doit se plier aux lois de la nature et agir sur ce qui est dans son pouvoir), Raymond Lulle (auteur de Ars magna : compendiosa inventendi veritam - Le grand art : découverte concise de la vérité, à l’origine du lullisme qui associait alchimie et mystique), Morien (alchimiste d'Alexandrie au XIe siècle), « Hermès qu’on nomme père, À qui aucun ne se compare » (Hermès Trismégiste), Geber (alchimiste perse du VIIIe siècle, son corpus se prolonge jusqu’au XIVe siècle et constitue la majeure partie des sources alchimiques arabes traduites au Moyen Âge) et Albert le Grand (alchimiste allemand du XIIIe siècle). Ainsi s’achèvent les recommandations de Nature à l’alchimiste.
L'alchimiste commence par des excuses et des remerciements à sa très douce mère Nature « La plus parfaite des créatures Que Dieu créa après les anges ». Il reconnaît ses erreurs et promet de ne plus s’adonner à l’Œuvre mécanique. Mais bien vite, c'est à son tour de faire ses remontrances. Il rappelle à Nature qu’elle est responsable de toutes les bassesses de sa créature humaine, incapable qu’elle a été de corriger son erreur. Elle n’est donc pas en droit de se complaindre, de lui reprocher son orgueil et son insolence, son désir d’opérer la transmutation par l'Œuvre mécanique.
À l’invitation de Nature qui promet de lui enseigner la voie naturelle, l’alchimiste répond qu’il ne comprend rien à la philosophie et qu’il est bien incapable de changer sa raison. Nature ne répondra pas à l’alchimiste, le poème n’a que deux parties, la remontrance de Nature et la réponse de l’alchimiste. Désespéré, il se morfond inlassablement au sujet d’« or mort » et de « matière trop épaisse », puis peu à peu il se reprend, il se questionne sur la voie philosophique à laquelle il préfère « la théorique Et spéculative pratique», autrement dit la compréhension réelle des choses telle qu’il en est capable par lui-même, une sorte d’accès au monde des Idées. Surtout, la clé apparaît dans ce passage, absolument essentiel, à mon sens le plus important du poème :
« Après la préparation,
Faites la dissolution,
Et le sec en eau réduisez,
Et jusqu’en l’air conduisez
Par sublimation céleste,
Tant êtes vous sage & honnette :
Enfin, toute seule vous faites
Ce que parfait choses imparfaites. »
L’essentiel tient en deux mots : « sublimation céleste ». Ni l’alchimiste ni Nature ne peuvent unir le corps et l’esprit. Ce sont les Cieux. C’est Dieu et lui seul qui agit sur l’âme et permet sa manifestation en l’homme. De cette sublimation, car là est la perfection, l’alchimiste peut préparer le réactif et le mettre sur le feu de la volonté, de la science et de la philosophie, Nature l’aidera, mais le moment venu, c’est à Dieu et à Lui seul qu'appartiendra le miracle. Car c’est à Lui et à Lui seul qu’appartient l’âme.
Pour la suite du poème, rien ne sera assez clair pour savoir comment appeler sur nous le miracle. C'est donc avec une certaine liberté d'interprétation, avec un certain parti pris, que je poursuivrai la présentation de Complainte. Le vecteur de la Grâce, à mon avis, est l’amour, comme le sous-entend une nouvelle tournure, une nouvelle façon de s’adresser à Nature : « Mieux sauras que moi ma mie, Mon honorée et chère Dame, Que veux servir de corps et d’âme. »
L’image se tisse entre le charnel et le spirituel. Dans ce « servir de corps et d’âme », dans cette nature avec un « n » minuscule qui laisse place à la « Dame » en majuscule et majesté, l’alchimiste s’imagine un service d’amour à « sa » Dame. Un amour dont la perfection œuvre à l’union du corps et de l’âme dans un même élan vers l’être aimé. Un amour dont naît « quelque vaisseau petit, Que le corps elle convertit Avec l’esprit tout en un, Sans y ajouter corps aucun. »
La morale de l’histoire
Complainte est une sorte de montagne russe, l’alchimiste en prend pour son grade, puis Nature lui promet la pierre philosophale, on ne sait bien comment, en suivant la voie d’un Œuvre naturel qui change l’être, comme dirait Baudelaire, presque « de vin, de poésie et de vertu ». La réponse de l’alchimiste est d’abord cinglante, il tient Nature responsable des mauvais penchants de l’homme, de son orgueil. C’est d’une façon de sa faute s’il prétend au Grand Œuvre. Puis il sombre dans le pessimisme, ruminant en de longs vers les causes de son échec à magnifier sa nature, à faire de ses bons penchants, son cœur et son âme, les maîtres de sa volonté, car la satisfaction des pulsions et des tentations des sens est la plus forte. Nous comprenons évidemment qu’il est question d’union du masculin et du féminin en un fils de vertu. Il y a dans cet inlassable poème une réponse à l’imperfection de la créature humaine. Mais ce ne sera jamais assez clair, la répétition se recoupe et se contredit à la fois, sans que l'on sache si l’on nous invite ou si l’on nous dissuade, si l’on se réfère à l'Œuvre mécanique ou à l’Œuvre naturel, si le substrat est la matière, le charnel, ou l'âme.
Le remède est l’amour. L’amour est prodigieux. Il y a quelque part, dans l’amour de deux êtres, la promesse de l’achèvement de l’immense, du tout entier, du dépassement de toutes les limites, la redéfinition des ultimes, que seule la prisca sapientia saurait formuler dignement. C’est dans l’union des altérités, de l’homme et de la femme, aux plans charnel et spirituel que peut s'accomplir l’union en un être unique, qui n’est pas l’enfant à naître, mais l’androgynat du couple, fusionné par l’amour des cœurs et des corps. Le couple est cette union, le lapis qui attire l’Esprit universel. C'est Dieu lui-même qui se penchera sur l'union et opérera la sublimation, la révélation des âmes, vibrant ensemble au souffle de la Grâce. Le « en haut » communie avec le « en bas » dans un service d’amour. La quête alchimique, l’au-delà du miroir, la connaissance et la bascule dans l’Esprit universel, dans le schéma antérieur à la manifestation, trouve son chemin dans un développement supérieur de l'amour, celui d’un alchimiste contemplant sa dame.
Restons encore un peu avec la miniature avant de quitter le poème. L’alchimiste regarde une femme, les hanches simplement couvertes d’un drap, les bras croisés sous ses seins. Elle a des ailes et une couronne portant les sept symboles des sept astres et des sept métaux. Elle est assise sur une souche d’arbre sous laquelle couve un feu. Au-dessus, les branches s’entremêlent comme un arbre de Séphiroth. Derrière, reflétant la clarté du ciel, un lac ou la mer s’immisce entre les îles. On aperçoit au loin une chapelle tendue vers le ciel et des ombres équivoques. L’alchimiste s’est détourné de son laboratoire sur le seuil duquel il est inscrit Opus mechanice (Œuvre mécanique). Sur notre arbre séphirotique s’entrelacent de bas en haut les quatre éléments : terra, aqua, ignys, aera (terre, eau, feu, air), la genèse : gen° - mixtio - spes (génération, mélange, espèces), l’être : indi - vidiu - um (individu). Au sommet, à la troisième conjonction, il est écrit Opus nature (Œuvre naturel), sous une fleur inversée descendant du ciel. Comme dans le poème, l’alchimiste délaisse le laboratoire de l’Œuvre mécanique et se tourne vers la séduisante Nature qui lui indique l'Œuvre naturel, la juste élévation en conjonctions du corps et de l’esprit dans le chemin de l’âme qu’est l’arbre séphirotique. Comme dans les Tapisseries, le charme de la femme emplit l’image d’un fabuleux désir.
Complainte est un indice supplémentaire, une concordance, une impulsion vers ce qui m’a tôt paru être l’évidence : la dame ! Cette dame, belle, telle Athéna sur Toucher et telle Isis sur Vue, est la femme divine, celle d’un amour passionné, entier, d’une spiritualité portée par le vent du désir. C’est une voie de mystère qui ne déçoit pas, qui n’est pas la promesse d’un Simorg brûlé de mille feux, de la rencontre du Roi des Rois ou de la genèse de la pierre philosophale. Le temps viendra de la femme divine.
Jean Perréal et Complainte de Nature à l'alchimiste errant


Nous voici au pied de la promesse selon laquelle la dame des Tapisseries aurait quelque chose à voir avec une certaine femme divine, que la dame n'est pas qu'une actrice, mais qu’elle apporte le sens tout entier, qu’elle seule pouvait créer cet ici, que c'est elle dans la profondeur de son âme qui se métamorphose, qui se sublime, et permet l'avènement d'un spirituel nouveau, ou plutôt oublié, un spirituel qui a du mal, bien du mal, à se frayer une place au premier rang des prières de ce siècle, mais qui agit, qui n'a jamais cessé d'agir dans la ferveur populaire, dans l'imaginaire, dans les fantasmes, dans nos aspirations vers son ailleurs, celui tout proche et si loin, celui que nous promet la femme divine.
Continuons, laissez-vous porter, ne lâchez pas cette main qui vous conduit, le temps d’un livre comme le temps d’un rêve, suspendez votre jugement, selon ce pacte auquel nous invite Shakespeare dans son Songe d’une nuit d’été :
« Si nous, légers fantômes, nous avons déplu,
Figurez-vous seulement (et tout sera réparé),
Que vous avez fait ici un court sommeil,
Tandis que ces visions erraient autour de vous.
Seigneurs, ne blâmez point
Ce faible et vain sujet,
Et ne le prenez que pour un songe »
Laissez-moi vous tenir la main, encore un peu, jusqu'à la fin de cette dernière partie. Le chemin continue de se dérouler, de se tisser, selon une sorte de logique parfois dissolue, décousue, relâchée, mais qui nous conduit assurément quelque part.
Maintenant, retournons-nous. On dit pourtant de ne pas se retourner pour ne pas être pris de vertige, pour ne pas dissiper l'amour. Alors je me retourne pour vous : les lapins qui révèlent le sens véritable des Tapisseries, la symbolique des nombres, la mystique soufie, les gnostiques, la fauconnerie de Frederick II de Hoenstaufen, le Graal, l'alchimie, j'ai même évoqué les satanistes. Une belle panoplie d'occultiste, d'illuminé, de charlatan ! Je m’imagine dans une librairie jaune toute proche de la Seine, tous ces thèmes comme autant de rayonnages, dans une senteur d’encens, les pendules scindant les rayons de soleil sur leur présentoir, les tarots se reflétant dans leur vitrine. Le tintement de la cloche suivant l'ouverture de la porte vous tire de vos rêveries, il reste bien d’autres rayonnages à parcourir, une vitrine entière pour Guénon, Papus et les francs-maçons, en face les ovnis avec les anges, au fond la kabbale, dans la grande pièce les hérétiques, les théosophes de Blavatsky et quelques livres de Jung. Il y a toujours un peu de Jung. Des autres je ne dirai rien, juste un peu de la kabbale, mais Jung est d’une importance toute particulière, il a unifié presque tout ce qui précède dans un exposé non seulement de l'inconscient, mais de l’ensemble des dynamiques irrationnelles. Jung a théorisé la licorne.
Freud lui reprocha de s’endiguer dans « la boue noire de l’occultisme ». Peu après, en conclusion de leur dernière rencontre, il le déclarait définitivement fou. Né en 1875 d’un pasteur luthérien et d’une adepte du tarot et de la chiromancie, le psychiatre suisse allemand Carl Gustav Jung est le père de la psychanalyse jungienne, la psychologie des profondeurs. Il est aujourd’hui un brin suspect, surtout en nos terres freudiennes, ce mauvais fils qui tua trop vite le père. L’on m’a récemment rétorqué à son sujet « Jung ce n’est pas de la psychanalyse, ce n’est que de la psychologie ». Si c’est de la psychologie cela nous suffit, puisque je ne prétends pas allonger sur un divan les dames des Tapisseries pour les soigner d’un quelconque mal, je prétends simplement les comprendre, sans changer quoi que ce soit, et pour cela Jung est notre homme, celui de l'individuation, des archétypes et de l’inconscient collectif, aussi celui de l’occulte, Freud ne s’y était pas trompé, et tant mieux.
Jung mêla sa vie durant la rigueur de l’approche scientifique aux intuitions et à l’écoute de l’âme. Partant de l’observation du singulier, de l'observation d'une ou d'un patient, il alla rejoindre l’universel, par une théorie unifiante, mais plus encore par la mise en jeu de la psyché individuelle dans le grand théâtre, le théâtre de l'inconscient collectif et des invariants humains. Jung nous offrit une considération nouvelle de l’inconscient dans ce qu’il qualifia de soi, dans son interaction avec le moi conscient. Un soi qui se démarque d’un inconscient freudien suspect, répressif, un soi qui ne demande qu'à être compris, accepté, à ce qu’on apprenne à vivre avec lui, à ce qu’on l'intègre dans une harmonie psychique nouvelle, celle d’un moi capable de reconnaître la légitimité des émanations surprenantes de l’inconscient et de l’irrationnel. À ce travail de découverte, d’acceptation et d’intégration du soi par le moi, Jung offrit le nom de processus d’individuation. Et il fit un jour cette constatation surprenante de profondes similitudes entre ce processus d’individuation et le processus alchimique et ses quatre étapes : l'Œuvre au noir, l'Œuvre au blanc, l'Œuvre au jaune et l'Œuvre au rouge.
L’Œuvre au noir, celui de la mort et de la putréfaction, est la confrontation brutale à l’ombre, elle est une chute de l’égo perdu devant des réalités qu’il aurait été plus confortable d’éluder. L’ombre est cette part de nous que nous aimerions mieux ignorer. Elle contient les pulsions et les déviances, un appétit du péché, ces imperfections que nous savons mieux reconnaître chez l’autre qu’en nous-même. L’ombre se manifeste par projection, sur les autres, sur le monde, telle une menace venue du dehors. L'ombre est une part intégrante de nous-même et le nier a pour seul effet de la décupler. L’ombre grandit dans l’ombre de la conscience et se manifeste par débordements.
La rencontre avec ses contenus et ses dynamiques est la première étape du processus d’individuation, elle est l’Œuvre au noir alchimique, elle est une confrontation abrupte à la totalité du soi. La douleur de cette confrontation marque l'entrée dans une dialectique du moi avec le soi. Elle nous plonge dans le lieu de la détresse et de la réclusion nécessaires au processus de la mort et de la putréfaction. Comme le dit Jung, ce processus requiert « l’adieu à la cohérence personnelle et collective et l’entrée dans la solitude, dans le cloître du soi intérieur ». [24]
L’Œuvre au blanc, celui de la purification, de la renaissance dans des dimensions nouvelles, est celle de la connaissance du soi, de la compréhension de ses dynamiques et de leur reconnaissance en tant que parts intégrantes de nous-même. Au sujet de l’ombre, Michel Cazenave nous dit que « à côté des aspects négatifs, elle incarne aussi ce qui a été négligé dans l’édification de la personnalité consciente, le potentiel de l’individu ». [25] Explorer l’ombre c’est retrouver des qualités, des aptitudes et autres trésors intérieurs qui ont un jour émergé avant d’être mis à l’écart et oubliés, pour se conformer aux préconçus, aux exigences personnelles et sociales. La rencontre de notre ombre ouvre sur la pleine expression de nos talents et de nos potentiels. Reconnaître que l’ombre nous habite, c’est rompre avec nos illusions d’un univers physique et psychique d’assurance, c’est aussi savoir reconnaître l’ombre d’autrui, c’est ne pas être dupe de la menace, c’est savoir opposer l’ombre à l’ombre. Passé le traumatisme premier, le soi nous révèle sa richesse, les masques de la persona (ces différentes facettes de nous-même, ces costumes, ces masques que nous échangeons au gré des circonstances, et nous crée différentes identités), l’inconscient collectif, les archétypes, et bien d'autres richesses. Deux dynamiques du soi nous intéressent tout particulièrement : le complexe animus - anima et, bien sûr, l’âme.
Dans son processus d’individuation, l’homme va à la rencontre de son principe féminin, son anima, qui lui prodigue « sensibilité et inspiration ». La femme va à la rencontre de son principe masculin, son animus, qui lui prodigue « force et rigueur de la créativité ». C’est là une chose que je ne comprends pas. Est-ce parce que je suis un homme que l’anima me fascine, qu’elle me semble si proche, si nécessaire ? Il suffit de lire Marie Louise Von Franz, proche collaboratrice de Jung, pour voir que l’anima est, autant pour l’homme que pour la femme, cette grande oubliée, et qu’avec elle c’est toute une dimension de notre psyché qui nous fait défaut. La découverte de l’anima, du principe féminin, dissipera la brume qui nous garde tout proches, mais incapables de saisir la vérité de la dame des Tapisseries.
Quant à l’âme que Jung évoque comme composante du soi, aucune définition ne lui rendra sa juste valeur. Âme dont on ne peut que faire l’expérience. Deux choses à dire toutefois. J’adhère à la définition que Michel Cazenave a donnée de l’âme dans une émission sur France Culture : c’est le lieu de la rencontre avec la divinité. Ça me suffit, c’est le lien intime avec le divin. Comme souvent, Michel Cazenave, je le comprends mieux à l’oral qu’à l’écrit. Dans Le vocabulaire de Jung [25] il écrit : « Jung considère en effet que l’âme humaine est cet espace privilégié où l’anthropomorphose divine entraîne la théomorphose de l’homme. » Au-delà de la rencontre, Cazenave évoque ici une fascinante mise à l’échelle du Créateur et de sa créature dans le jeu des perspectives de l’âme. La seconde chose, Michel Cazenave l’a simplement formulée dans une autre émission : Jung n’a pas prouvé l’existence de Dieu, il a simplement mis en évidence les processus psychiques qui permettent sa représentation et sa présence en soi.
L’Œuvre au jaune, celui de la sublimation, de l’entrée en harmonie des forces contraires, est l’aboutissement du processus d’individuation. C’est une intégration du soi dans une nouvelle dynamique du moi qui tend vers une totalité et un équilibre entre des principes opposés. C’est « un élan vital, biologique et psychique, une dynamique inconsciente qui s’inscrit dans le long temps (comme le processus alchimique), et qui pousse à réaliser, par la mise en tension des opposés, une unité plus complexe de la personnalité ». [25]
L'Œuvre au rouge, celui de la transmutation, de la rencontre du divin attiré par l'androgynat du lapis, était vu par Jung comme une étape à part, sur laquelle le travail de l’analyste avec son patient ne pouvait suffir. Il le rapprochait de l’illumination, de l'accès au nirvana, d’une forme de transcendance. Il n’y a pas de recette pour l’illumination, c'est elle qui viendra éventuellement à nous.
Sans la citer, nous avons déjà fait appel à la psychologie junguienne. Il y a eu de l’ombre dans le serpent écumant de l’Hymne, dans le faucon des Tapisseries et dans le faucon du Conte du Graal. Nous ne sommes pas passés loin du processus d’individuation en parlant de l’individualisation figurée par le Deux dans Toucher. Un processus dont nous avons déjà dessiné le contour en suivant le chemin de la Dame, puisque nous l’avons rapproché du processus alchimique, dont Jung rapproche le processus d’individuation. Le chemin de la Dame, la descente et la remontée du prince, sont deux voyages dont l’une et l’autre reviendront métamorphosés.
L’image de Perceval s’oubliant devant les trois gouttes de sang sur la neige est si éloquente, elle illustre si justement la confrontation de Perceval à son ombre, que nous pouvons nous demander : pourquoi chercher maintenant à appliquer des théories, à nous charger d’un nouveau vocabulaire ? Maintenant que les principes se sont révélés par l’usage, quel intérêt y a-t-il à les reprendre, à nous alourdir l’esprit de complexes analytiques, comme si la quête du Graal et les méandres alchimiques n’avaient pas suffi ? Ce que nous apporte Jung, c’est la mise en langage d’expériences partagées, offrant non pas la possibilité de les fixer au formol pour les passer à la table d’étude, mais d’en étendre les perspectives par la révélation du schéma tout entier là où nous n’avions perçu qu’une partie.
Revoyons maintenant les Tapisseries, ainsi équipés d’un léger bagage théorique. Ouïe, l’Œuvre au noir, est la confrontation à l’ombre et la chute du masque de l’égo qui constituent les premiers pas sur la voie de l’individuation. Sur Désir, la dame quitte les richesses et les plaisirs des sens pour s’isoler sous la tente. À l’issue de cette conquête intérieure, elle saura qu’il y a, au-delà de la raison, tout un pan d’elle-même dont les mécanismes et les contenus sont cachés, inaccessibles, occultés par le voile de l’inconscient. Elle sera heureuse, celle qui acceptera que cohabitent en elle le conscient et l'inconscient, le rationnel et l’irrationnel. C’est à mon sens ce que nous dit Goût, le lion de la raison et la licorne de la déraison triomphent ensemble, sous la protection du faucon de l’ombre. La dame a acquis l’équilibre nécessaire pour tout entendre, tout percevoir, ombre ou lumière. Vue est au-delà de ce qui est écrit. Dans cette vision, dans cette contemplation, il y a du débordement de l’être en réponse à l’appel de l’âme.
La psychologie des profondeurs est une piste précieuse mais elle reste une grille de lecture, universelle, normative. Malgré sa prétention d'atteindre les invariants humains, peut-elle nous transporter au cœur et à l'esprit d'un siècle ? Comme souvent il faut croiser les sources, nous en avons déjà vu un certain nombre avec la fauconnerie, le Graal et l'alchimie, mais ce n'est pas assez intime, comme le serait une histoire que l'on se conterait au coin du feu, peut-être dans une haute salle tendue de belles tapisseries. Après les canons d'une époque, j'aimerais maintenant en savoir plus sur cette simple intimité, sur l'âme populaire du temps des Tapisseries.
Du Grand Œuvre à l'Individuation
Alors que je poursuivais mes réflexions sur les représentations du féminin dans la psyché collective au temps des Tapisseries, c’est dans une librairie qui du dehors paraît minuscule mais qui grandit sans cesse à mesure que l’on progresse (Librairie À tout lire), que je suis tombé sur le fabuleux livre de Marie Louise Von Franz (cette proche collaboratrice de Jung) : La femme dans les contes de fées. [26] J’avais prévu d’illustrer le processus d’individuation par l’histoire du Perroquet blanc selon l’analyse de Von Franz dans L’individuation dans les contes de fées. [27] Mais la révélation qu’a été la lecture de La femme a été telle que je me contenterai de vous envoyer lire L’individuation si ça vous chante, et que je vais m’offrir ce chapitre entier pour essayer de vous dire ce qu’il y a de si fabuleux dans La femme. Il y a précisément dans ce livre ce dont nous avions besoin maintenant : couper les intermédiaires en découvrant l’anima dans ce que nous a transmis le temps des Tapisseries, ce trésor des peuples, le mythe, le conte et ses habitants, ses héros et surtout ses héroïnes, autant de mémoire, de reflet de l'intime, capturé par le miroir populaire.
Les héroïnes des contes ne sont pas des êtres humains, mais des contenus psychiques. Il y a leur naissance, fantastique, annoncée par un animal magique ou par un bon sort qui réjouira un roi et une reine incapables d’avoir des enfants. Il y a l’ambiance onirique, et qui dit rêve dit projection de contenus psychiques : certains contes se finissent par un réveil annoncé par le narrateur, si ce n’est par le célèbre « ils vécurent longtemps et eurent de nombreux enfants » qui forme une ellipse comme celle d’un rêve qui s’achève. Il y a l’étrange identité de l’héroïne, l'on ne sait qu’à peu près où et quand elle vit, elle n’a pas de nom véritable, tout comme les autres personnages d’importance, elle s’appelle « la belle au bois dormant », ou « la jeune fille sans mains ». Il manque tout ce qui contribue à faire un être véritable, et pourtant c’est bien une jeune fille, elle s’amuse, elle s’ennuie, elle prie, elle balaie la cour derrière le moulin. Elle est un intermédiaire de projection de la psyché du lecteur, subtile, plus éloquente qu’une image claire et nette comme un mythe grec. En tant qu’aspect archétypique du moi, l’héroïne est une entrée discrète sur l’immensité du soi. Quel que soit le moteur narratif, les raisons d’un départ, d’une paralysie ou d’une fuite, le véritable dynamisme est de nature psychique. Et ce dynamisme psychique n’est pas celui de la jeune fille, guidée par son intuition, mais celui du lecteur pour qui elle deviendra un alter ego, une identité de transposition, le temps d’une pérégrination riche d’enseignements, qui nous conduira à l’harmonie du moi avec certaines exigences du soi. Alors, enfin, « les potentialités psychiques innées peuvent devenir réalité » et la part positive de l’ombre se révèlera être le véritable trésor.
Dans les Tapisseries, nous pourrions rapprocher de contenus psychiques universels la dame, unique et multiple, accompagnée d’une licorne et d’un lion, sur une herbe rouge, sur une île on ne sait où, et pourtant si vraie, si authentique, si proche. Cela résout la question que je posais quant à la nature des différentes relations que la dame entretient avec la licorne, avec le faucon, avec le chien ou avec la perruche : il s’agit de relations du moi archétypique qu’est la dame avec différents aspects du soi. La citation suivante de Von Franz ne trouve-t-elle pas une juste résonance dans l’épreuve d’Ouïe ? :
« On peut considérer que toute maladie psychique est une initiation en puissance et que les pires choses qui puissent nous advenir sont l’occasion d’une initiation, car elles nous plongent dans un lieu qui nous est propre, et dont nous devons apprendre à ressortir.(…) Toute situation obscure dans laquelle on tombe est l’invite à une initiation. » [26]
La femme des contes de fées
Le conte de La jeune fille aux mains coupées, La fille aux mains coupées ou La jeune fille sans mains, est le conte-type numéro 706 de la classification folkloristique internationale d'Aarne-Thompson. Cette classification qui répertorie les contes de tous pays, de toutes époques, de toutes sources, les plus précieuses étant la culture orale des conteurs. Comme le millier de contes ainsi classés, le fameux conte 706 est défini selon ses étapes essentielles qui produisent un schéma type : a) mutilation, b) mariage avec un prince, c) épouse calomniée, d) heureux dénouement.
Ce conte-type appartient au groupe des contes merveilleux intitulé "Autres contes surnaturels" (contes-type 700 à 749) et à l'intérieur de ce groupe, il appartient au cycle de la femme bannie avec les contes-type 705 (Née d'un poisson), 707 (L'oiseau de vérité), 708 (L'enfant monstre) et 709 (Blanche Neige). Dans ces contes, passive devant l'injustice et la cruauté de son sort, l'héroïne se laisse docilement torturer et bannir, dans un silence irrationnel. La jeune fille aux mains coupées a été particulièrement populaire en France du XIIe au XVIe siècles, comme en attestent les quarante-six versions orales recueillies chez nous. Le conte était également populaire en Irlande, en Angleterre, dans l'Europe de l’Est et même au Canada anglophone avec un recensement total de deux cent cinquante versions. [28]
Ce conte populaire, un conte qui a été poli, transmis, répété, excorié, de sorte qu’il nous en reste un fond puissant de la psyché collective, revêt une valeur inestimable. Il est peut-être ce que l’on peut trouver de plus proche de l’aventure spirituelle d’une jeune femme au temps des Tapisseries.
Les premières versions écrites de La jeune fille aux mains coupées datent du milieu du XIIIe siècle avec Vita Offae Primi d'un auteur anonyme et la Manekine de Philippe de Rémi. La plus célèbre, on peut dire aujourd'hui la version officielle, est celle publiée en 1856 par les frères Grimm, nos premiers folkloristes, à partir du recueil de cinq versions orales. Je reprends dans ce résumé la récente traduction française de Natacha Rimasson - Fertin [29] :
Dans une forêt, un meunier tombé dans la pauvreté rencontre un vieil homme, qui se révélera être le diable, et qui lui offre des richesses extraordinaires contre ce qui se trouve derrière son moulin. Le meunier accepte, pensant qu’il s’agit de son grand pommier, ignorant qu’à cet instant sa fille balaie la cour derrière le moulin. Après trois années que la jeune fille vit dans la foi et sans péché, le diable vient la chercher. Mais elle se lave pour se purifier et trace à la craie un cercle autour d’elle, empêchant le diable de la prendre. Le diable demande au père de priver la jeune fille d’eau, mais lorsqu’il revient le lendemain, la jeune fille a tant pleuré sur ses mains qu’elles sont purifiées. Le diable menace le père de le prendre avec lui et l’oblige à couper les mains de sa fille. Mais lorsque le diable revient le troisième jour, la jeune fille a tant pleuré que ses poignets sont purifiés, il est contraint à renoncer, ayant perdu tout droit sur elle.
La jeune fille préfère s’enfuir plutôt que de rester auprès de ce père qui l’a vendue au diable, quand bien même il la couvrirait de richesses. Elle va dans le monde, les poignets attachés dans le dos. La nuit venue, elle arrive devant un jardin royal où elle découvre des arbres couverts de beaux fruits. Elle invoque le Seigneur et un ange lui vient en aide, il lui fait franchir l’eau qui entoure le jardin dans lequel elle croque une poire à même la branche. Au matin le roi trouve le fruit croqué et la nuit venue il va à la rencontre de la jeune fille. Il l’aime car elle est pieuse et belle. Il la prend pour épouse, lui promet de ne jamais l’abandonner et lui offre des mains d’argent. Après un an, alors que la jeune fille est enceinte, le roi part en campagne, laissant sa vieille mère veiller sur elle.
Lorsque l’enfant naît, la mère du roi lui envoie une lettre, mais le diable profite du sommeil du messager pour l'échanger avec une autre lettre annonçant que la reine a donné naissance à un gnome. Le roi demande en retour à sa mère de bien veiller sur son enfant et sur sa femme. Le diable échange à nouveau la lettre avec une autre demandant de tuer la femme et l’enfant, et de garder pour preuve du crime la langue et les yeux. La vieille mère les épargne et fait égorger une biche dont on coupera la langue et les yeux. Vient alors ce passage enchanté :
« Puis elle parla ainsi à la reine: « Je ne peux te faire tuer comme l'ordonne le roi, mais il t'est impossible de rester ici plus longtemps. Pars avec ton enfant dans le vaste monde et ne reviens jamais. Elle lui attacha l'enfant dans le dos et la pauvre femme partit, les yeux embués de larmes. Elle arriva dans une grande forêt sauvage et se mit à genoux pour prier Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut alors et la conduisit jusqu'à une petite maison qui portait un écriteau avec ces mots: «Ici, chacun peut vivre librement ». Une jeune femme blanche comme neige sortit de la maisonnette en disant: «Soyez la bienvenue, Votre Majesté », et elle l'y fit entrer. Elle lui détacha alors le petit garçon de son dos, le tint près de son sein pour qu'il puisse boire, puis elle le posa dans un joli petit lit aux draps tout frais. La pauvre femme lui dit alors:
- Comment sais-tu que j'ai été une reine ?
- Je suis un ange envoyé par Dieu pour prendre soin de toi et de ton enfant, répondit la jeune fille blanche.
La reine resta donc dans cette maison pendant sept ans et y fut bien soignée, et par la grâce de Dieu, en récompense de sa piété, les mains qu'on lui avait coupées repoussèrent. »
Lorsque le roi revient à son royaume, il comprend que le diable l’a trompé et il prend cette décision : « Je marcherai aussi loin que le ciel est bleu et je ne mangerai ni ne boirai jusqu’à ce que j’aie retrouvé ma chère femme et mon enfant, s’ils n’ont pas péri et s’ils ne sont pas morts de faim entre-temps. » Après sept années à chercher dans toutes les fentes de rochers et dans toutes les cavernes, Dieu le soutient et à son tour, le roi entre dans la grande forêt où il trouve la petite maison.
Le roi ne reconnaît pas sa femme, jusqu’à ce que la Vierge lui présente les deux mains d’argent. « L'ange de Dieu les fit alors manger une nouvelle fois tous ensemble, puis ils rentrèrent chez eux auprès de la vieille mère du roi. Il régna alors partout une grande joie, le roi et la reine célébrèrent une nouvelle fois leur mariage et vécurent heureux jusqu’à ce qu’ils s'endorment dans les bras du Seigneur. »
La jeune fille aux mains coupées
C’est la véritable magie des contes de fées : malgré son ambiance étrange et ses incohérences, l’histoire nous est familière. Elle nous parle. Sans que nous sachions bien l’exprimer, nous pressentons que l’essentiel est ailleurs, au-delà de ce qui est dit. En fait, nous pouvons comprendre, nous pouvons exprimer, à condition de regarder ce que le conte a éveillé en nous. Car, pour reprendre ce que René Char nous disait des mots, le conte en sait plus sur nous que nous n’en savons sur lui. Commençons par nous souvenir que les héros et les héroïnes sont des contenus psychiques. L’héroïne, que nous appellerons pour plus de commodité la jeune fille, bien qu’elle devienne ensuite femme et reine, est assimilable à l’anima, le principe féminin en devenir à travers le conte. Plus précisément, il faudrait parler non pas de l’anima, mais du rapport du moi à l’anima, puisque selon Von Franz, les héros et les héroïnes de contes constituent des aspects archétypiques du moi. Cela vaut pour ce qui suivra, il s’agira à chaque fois de rapports du moi à une composante du soi.
Le père est l’animus négatif. Il est cruel, il sacrifie par deux fois sa fille, la première fois involontairement en voulant céder son pommier au vieil homme, la seconde fois pour échapper au diable. Le roi est l’animus en progression, d’abord il promet à la jeune fille de ne plus la quitter, il lui fait confectionner des mains d’argent, puis il l’abandonne malgré sa promesse, il a pris un engagement qu’il ne peut tenir, un souverain se doit de protéger son royaume. Suite à l’intervention du diable, la jeune fille doit fuir à nouveau. Le roi, comme la jeune fille, devra traverser sept années de solitude. Il errera dans le monde sans boire ni manger.
Les mains sont l’interface avec les choses, avec le monde, elles sont l’identité. La jeune fille commence par en être privée, avant d’obtenir des mains artificielles, stéréotypées, mais opérationnelles, des mains d’argent, ce métal féminin comme la Lune. Ce n’est qu’après sept années passées dans la grande forêt, dans la petite maison où chacun peut vivre librement, que par le temps, par sa piété et par la grâce de Dieu, lui repoussent des mains véritables, agissant de son seul vouloir et sans autres mains pareilles. Le rétablissement de l’identités’est opéré au secret, loin des regards, sous la bienveillante protection de la Vierge. Lorsque la dame a quitté le moulin familial, le moi a fait la subite rencontre de l’ombre. Lorsqu’elle a acquis les mains d’argent, le moi a acquis le masque de la persona, une identité efficiente, mais factice. Lorsque ce sont des mains véritables, authentiques, qui lui ont repoussé, le moi s’est allié à l’anima. Et lorsque le roi a reconnu la reine, le moi a résolu le complexe animus - anima. La seconde noce du roi et de la jeune fille est l’aboutissement du processus d’individuation, la plénitude féconde, la dynamique harmonieuse du moi et du soi.
Dans l’effrayante forêt de l’ombre, la jeune fille a trouvé la petite maison de la solitude et de l’introspection. Le roi, lui, doit courir sans relâche dans le vaste monde. Ainsi va-t-il de l’anima, qui œuvre dans une apparente passivité, et de l’animus, qui s’agite frénétiquement, s’acharnant à prouver sa bravoure. Le principe féminin et le principe masculin se transforment, justement à l’issue des sept années, comme le chiffre Sept de l’achèvement d’un cycle qui ouvre sur un renouvellement, l’animus et l’anima, le soufre et le mercure, le roi et la reine se subliment et ils célèbrent leurs noces une nouvelle fois pour vivre unis jusqu’à leur fin bénie. L’œuvre s’est accomplie avec pour élément central les mains de la jeune fille, coupées par l’animus brutal, réparées par l’animus positif, mais que seule la jeune fille pouvait faire repousser, par sept années passées en elle-même et à la grâce de Dieu, comme il faudra sept années à l’animus positif pour la trouver, par l’aide de Dieu figurée par l’ange et la Vierge. Sept années comme sept lapins sur Désir, une petite maison comme la tente bleue de “Mon seul désir”.
Il est pratique de dire ainsi que le père est l’animus négatif, que le roi est l’animus en devenir, que la jeune fille est l’anima en transformation et que les mains sont la persona. Cela permet de s’appuyer sur des concepts. Cependant, l’histoire est en elle-même d’une troublante authenticité psychique et c’est d’elle qu’il faut apprendre plus que des cadres qu’on pourra lui appliquer. Maintenant que les principes nous ont permis de nous orienter sur le territoire, il est temps de les abandonner. Osons aller vers la réalité d’un cas, la logique de l’anima étant justement celle du particulier là où l’animus est normatif. La jeune fille s’est reconstruite d’elle-même dans une passivité apparente qui dissimule l’intensité de la conquête intérieure. Le roi, lui, a dû aller dans le monde entier, s’infliger la faim et la soif, dans une agitation frénétique, comme le héros classique affronte le dragon et accomplit cent prouesses. Les deux processus sont marqués du sceau du Sept de l’accomplissement d’un cycle ouvrant sur le renouveau, qui dans les Tapisseries précède immédiatement l’harmonie de Goût. Cette opération de la jeune fille privée de ses mains, avant d’en recevoir des factices, avant de fuir à nouveau et de parvenir par elle-même à susciter le miracle, à ce que les vœux formulés dans l’ascèse soient exaucés, que s’unissent le roi et la reine, l’or et l’argent, le Soleil et la Lune, le masculin et le féminin, autour d’un enfant né de l’épreuve, cette opération est fabuleuse et universelle comme ce conte qui a roulé dans tant d’esprits, essaimant des versions si variées. C’est lui qui a précédé, c’est lui l’origine de ce que Jung décrira plus tard. La psychologie est un guide, elle est une carte, mais elle n’est pas l’immensité de la forêt. Comme la jeune fille a retrouvé ses mains authentiques, c’est à nous maintenant de ressentir à nouveau de l’intérieur.
Ce que le conte nous enseigne
Von Franz fait le rapprochement suivant entre la quête de la jeune et fille et celle du roi [26] :
« De l’extérieur, cette retraite peut sembler une période de complète stagnation, alors qu’en réalité, ainsi que nous le verrons plus loin, il s’agit d’un temps d’initiation et d’incubation qui permet qu’une profonde dissociation psychique se répare et que des problèmes se résolvent ; de plus, la personnalité s’enrichit grâce à des expériences intérieures profondes. Ce thème fait contraste avec la quête plus active du héros masculin qui doit souvent s’en aller dans l’au-delà et abattre le dragon, trouver le trésor, ou conquérir la princesse. Il lui faut habituellement faire un long voyage et accomplir quelque haut fait, au lieu de tout simplement s’éloigner de la vie active. Il semble donc bien y avoir une différence caractéristique entre les voies des principes masculin et féminin, la seconde étant plus passive, plus contemplative. »
Cette initiation du héros, Von Franz n’est pas la première à la décrire lorsqu’en 1979 elle écrit La femme. Elle aurait pu faire référence au monomythe, ou « voyage du héros », décrit par l’anthropologue Joseph Campbell en 1949 dans Le Héros aux mille et un visages. Campbell a observé que la quête d’un héros suit les mêmes étapes, quelles que soient l’époque et la culture :
Un personnage, qui souvent s’ennuie, reçoit une invitation à suivre l’appel d’une quête. D’abord il refuse, ou il hésite, puis précipité par le destin, il part à l’aventure. Il rencontre un premier adversaire dont le triomphe représente le franchissement du seuil. Il pénètre dans un monde inconnu où il est aidé par un mentor et des alliés. Il relève de nombreux défis et résiste aux tentations. Il rencontre une première fois son antagoniste, souvent il s’agit d’une figure paternelle. Le héros est vaincu et se trouve plongé dans une grotte où il frôle la mort. Il renaît après que la magie ou l’amour l’a ramené à la vie. Il triomphe de la seconde confrontation et il en est récompensé. Enfin, il retrouve sa terre natale et partage son trésor et ses dons nouveaux.
Une trame aujourd'hui surexploitée. Nous avons l’habitude de prendre l’exemple de Star Wars, mais regardez et vous verrez que le monomythe est partout, souvent dans ce qui s’est fait de mieux, comme Matrix [30] ou Vaiana.
Nous pourrions parler, dans le cas de La jeune fille aux mains coupées, comme dans les contes du cycle de la femme bannie et bien d’autres contes de princesses, de reines ou de pauvres filles adoptives, d’un monomythe au féminin :
L’héroïne est d’une naissance singulière, elle porte en elle une promesse, un destin. Elle est bannie une première fois, souvent c’est une marâtre jalouse qui souhaite sa mort. Elle est recueillie et trouve un abri où elle connaît un premier équilibre. Une menace ou une tentation vient rompre l’équilibre et à nouveau elle prend la fuite, et se réfugie dans la réclusion et le silence. Après une attente, une gestation, un changement vient de l’extérieur, opéré par une force mystérieuse. Alors elle revient au monde transformée, complète, révélée. Elle s’unit au prince qu’elle aime autant qu’il l’aime et par des noces royales ils forment le plus sublime des couples.
Pour valider notre monomythe au féminin, faisons comme nous l'avons fait par la symbolique des nombres pour l’ordre des Tapisseries, et regardons si le monomythe s’applique à d'autres contes de la femme bannie. Des contes qui étaient, comme nous l'avons déjà dit, particulièrement populaires en France au temps des Tapisseries. Avant toute comparaison, voici les résumés de quatre contes, chacun représentant un conte-type du cycle de la femme bannie.
Le monomythe au féminin
Une femme qui n’arrive pas à avoir d’enfant achète au marché « une grenade pour la grossesse ». [31] Quand elle rentre chez elle, elle cache la grenade sous un couvercle de pâte. Son mari rentre, il est affamé et elle lui dit de prendre ce qui se trouve sous un autre plat, mais il trouve la grenade et la mange, maudissant sa femme de la lui avoir cachée. L’homme tombe enceinte et au neuvième mois, lorsqu’il ressent les premières douleurs de l’accouchement, sa femme le chasse, de crainte qu’il soit vu. Elle lui donne de la toile pour ramener l’enfant si c’est un garçon et de la soie pour l’abandonner si c’est une fille. C’est une fille qui vient au monde, son père l’enveloppe de soie et l’abandonne au pied d’un arbre. Un faucon la ramasse et l’amène dans son nid où il l’élève et la nourrit comme un des siens, jusqu’à ce qu’elle devienne grande comme nous.
Le fils du sultan qui refusait de se marier, amène sa jument boire au ruisseau, quand il y voit une lampe à vapeur. Levant la tête il découvre la fille assise au sommet de l’arbre, ressemblant à la lune. Il est saisi par sa beauté et lorsqu’il retourne chez lui, il est déjà malade d’amour. Une vieille dame, comprenant de quel mal il souffre, lui promet d’atteindre pour lui ce qu’il y a sur l’arbre. Elle fait mine d’égorger un mouton par la queue puis par le dos puis par la tête. La fille l’interpelle les deux premières fois et la troisième fois elle demande à l’arbre de se faire petit comme son petit doigt. À peine descend-elle de l’arbre que le fils du sultan la capture et l’épouse.
De retour chez lui il dit à sa mère « Le service que tu voudrais me rendre, fais-le pour ma femme. » Mais lorsque la fille demande un morceau de pain à sa belle-mère, elle lui coupe un bras, et ainsi de suite elle la taille jusqu’à ce qu’il ne reste de la fille qu’un morceau de chair et elle la jette par la fenêtre. La fille tombe sur l’anneau de la royauté et, ayant prié Dieu, l’anneau tel un génie lui demande quel est son vœu. Elle lui répond « redevenir comme avant, dans un jardin et un palais près de celui du fils du sultan, et avoir des fruits qui poussent au grés des saisons ». Le fils du sultan rentre, sa mère se fait passer pour son épouse, elle lui dit que sa mère est morte et que déjà on l’a emportée. Ils couchent ensemble, la mère tombe enceinte du fils, et lui demande du raisin du jardin d’à côté.
Le fils du sultan envoie un serviteur quérir le fameux raisin. La fille lui dit toute la vérité mais à la fin elle demande aux ciseaux de couper un bout de sa langue. Il rentre ainsi muet et sans raisin. Le fils du sultan s’agace et envoie un second serviteur qui connaît la même mésaventure. La troisième fois le fils du sultan va lui-même quérir le raisin mais, comme il est bon avec elle, la fille ne fait couper qu’un bout de son châle. Elle lui enseigne alors qu’elle est son épouse, que sa mère l’a coupée en pièces et que c’est parce qu’elle a prié Dieu qu’elle est redevenue comme avant, que sa mère l’a trompé et qu’elle est enceinte de lui. Le fils du sultan rentre chez lui et asperge sa mère d’essence avant de la brûler. Puis il va rejoindre la fille, son épouse, et ensemble ils vivront heureux.
Conte-type n° 705 (Née d’un poisson) : La fille du faucon
Un roi a trois fils : le prince, le boulanger et le boucher. Alors qu’il chasse dans la forêt, le prince voit au loin une fumée s’élever du fond de la forêt. [web3] C’est une maison où vivent trois princesses. Il fait part de sa découverte à ses frères et le lendemain les trois princesses les accueillent. Bien vite ils forment trois couples et se marient. Mais seul le prince parvient à avoir des enfants. Il convainc sa femme de laisser l’enfant pour aller à la fête et les sœurs jalouses en profitent pour remplacer le garçon par un chiot et l’abandonner sur la rivière. Le garçon est recueilli par un vieux pêcheur qui l’élève avec sa femme dans la profonde forêt. L’histoire se répète, chaque fois le prince convainc la femme d’abandonner l’enfant pour aller à la fête, la petite fille est remplacée par un chaton puis le second fils par un chiot. Les vieux prennent bon soin des enfants et à leur mort ils leur laissent une maison dont ils entretiennent le beau jardin. Le prince reproche à sa femme d’avoir perdu leurs trois enfants, il la chasse et elle ne trouve d’autre refuge que celui de la profonde forêt.
Un jour la jeune fille rencontre une femme aux vêtements déchirés. Elle ignore qu’il s’agit de sa mère, elle l’invite chez elle, la femme accepte, puis elle refuse de rester plus longtemps et en partant elle révèle à sa fille qu’il manque trois richesses à leur beau jardin. À la seconde rencontre la jeune fille lui demande ce qu’il manque, c’est « l’eau qui bouille », l’arbre qui chante et l’oiseau qui dit la vérité. Le premier garçon part à leur recherche, il rencontre un vieux qui le met en garde, le chemin est bordé de dangers et il ne doit pas détourner la tête, sans quoi il sera changé en pierre. À peine a-t-il avancé qu’une explosion l’effraie et, détournant la tête, il est pétrifié. La même mésaventure arrive au second garçon. La jeune fille, ne pouvant rester seule, part à son tour, mais elle demande au vieux de lui bander les yeux et de lui mettre du coton dans les oreilles. Sentant que sa monture est arrivée à l’issue du chemin, elle se découvre et trouve l’eau qui bouille, l’arbre qui chante et l’oiseau qui dit la vérité.
Elle libère ses frères en versant sur eux l’eau qui bouille, et c’est ensemble qu’ils amènent les trois trésors au jardin qui est à présent complet, sublime. L’oiseau fait connaître la vérité au roi et ses fils qui passaient justement dans la forêt. Les deux sœurs sont chassées, les parents s’unissent à nouveau et les enfants vont souvent les voir au château. L’on dit même qu’il leur est permis de l’embellir avec l’eau qui bouille, l’arbre qui chante et l’oiseau qui dit la vérité.
Conte-type n° 707 (L’oiseau de vérité / Trois fils d’or) : L’oiseau de vérité


Un veuf et une veuve se marient. Ils ont déjà chacun une fille, Yvonne la fille du veuf est douce et belle. [web4] Louise, la fille de la veuve est méchante et laide. Lorsque les filles s’ont d’âge à être courtisées, les jeunes hommes qui viennent les visiter n’ont d’yeux que pour Yvonne. Furieuse de jalousie, la marâtre envoie Yvonne garder du soir au matin une vache noire en compagnie de son chien noir Fidèle. Yvonne s’occupe si bien de sa vache noire que de maigre elle devient bien grâce. S’en apercevant, la marâtre fait revenir Yvonne, elle fait tuer la vache et l’on trouve près de son cœur deux souliers d’or. Vient un prince qui s’éprend d’Yvonne, portant ses beaux souliers et avec au cou des colliers d’or que la marâtre lui a fait porter pour l’occasion. Le jour où le prince vient chercher Yvonne pour la noce, la marâtre la fait emprisonner dans un cachot et couvre Louise de tant d’or que le prince, ébloui, ne la reconnaît pas. Le chien Fidèle tente bien de le mettre en garde mais le prince n’entend rien à ses aboiements. Cependant, il fallut couper deux orteils et les talons de Louise pour lui faire chausser les souliers d’or et, la voyant boiter, le prince comprend la tromperie et il la chasse.
La marâtre, furieuse, décide d’empoisonner Yvonne et va demander conseil à une sorcière. Celle-ci lui enseigne un sort, elle doit lui faire manger un chat noir. La marâtre trouve un chat noir qu’elle prépare comme un civet de lapin. Lorsqu’elle l’amène à Yvonne dans son cachot, celle-ci, gentille et candide, ne se méfie pas et mange le prétendu civet. Elle en tombe malade et passe la nuit à rendre. Le matin venu, la marâtre est furieuse de la trouver vivante et retourne demander conseil à la sorcière. Cette fois elle lui fait une recommandation, elle doit se rendre si insupportable que le mari n’aura d’autre choix que de fuir avec sa fille. Cela arrive bien vite et la nuit de leur fuite, alors qu’ils s’apprêtent à prendre le large, arrive la marâtre qui fait revenir le père sous prétexte qu’il a oublié son livre rouge. Alors que la fille est encore sur la barque, la marâtre détache les amarres et du pied elle pousse l’embarcation vers le large.
Yvonne arrive sur une île déserte et trouve un ermitage aménagé dans une grotte. Elle se nourrit de fruits et de coquillages puis, après trois semaines, elle se sent malade et accouche d’un chat noir. Un chat qui parle et qui lui demande de lui faire un bissac sur les épaules. Nageant comme un poisson il rejoint la terre et dans la cuisine d’un château il dérobe à la cuisinière un poulet rôti, du lard cuit, du pain blanc et du vin vieux, et les ramène à sa mère. La seconde fois que le chat noir va au château, le seigneur Rio, qui n’avait pas cru l’histoire de sa cuisinière, descend armé d’un fusil. Mais le chat bondit sur lui, lui enfonçant les griffes dans les chairs. Le chat l’avertit que sa maîtresse entretient une relation avec un homme, qu’elle prévoit de le tuer après une partie de chasse, qu’il sera couché dans le même lit que cet homme et qu’il devra échanger de place avec lui. La fameuse nuit arrive et, tous deux ivres, le seigneur Rio manque de s’endormir lorsqu’il se souvient du conseil du chat noir et échange de place avec l’homme. C’est alors qu’il entend s’approcher sa maîtresse, tenant un couteau qu’elle a aiguisé toute la journée. Elle égorge l’homme et d’un coup de pied elle fait rouler sa tête sous le lit. Le matin elle découvre le seigneur Rio vivant. Elle le fait enfermer et le jour même il est monté sur l’échafaud. Alors que le bourreau s’apprête à abattre sa hache, le chat noir grimpe à son oreille lui dire toute la vérité et c’est la maîtresse que le bourreau décapite.
Le seigneur Rio ne sait comment remercier le chat noir. Celui-ci lui demande d’épouser sa mère et, bien que répugné à l’idée d’épouser une chatte, il accepte par loyauté. Yvonne et le seigneur Rio tombent amoureux l’un de l’autre et célèbrent leurs noces. Le chat noir les suit partout, à la stupeur collective. Lorsque le seigneur Rio veut rencontrer sa belle-famille, le chat noir révèle toute la vérité, il provoque la sorcière en duel, un étrange jeu d’eau, de vent et de feu et la réduit en cendres, ne laissant à la marâtre que le goût des flammes, épargnant Louise qui était trop jeune pour savoir ce qu’elle faisait. Puis le chat noir demande au seigneur Rio de l’éventrer, le seigneur refuse mais le chat insiste, et lorsqu’il éventre le chat, dans son ventre le couple trouve un fils, le plus grand magicien que la terre ait jamais porté.
Conte-type n° 708 (L’enfant monstre) : Le chat noir


Une reine coud en regardant, par la fenêtre en bois d’ébène, la neige qui tombe en d’épais flocons. [29] Distraite, elle se pique le doigt et, contemplant trois gouttes de sang tombées sur la neige, elle souhaite un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang et aussi noir de cheveux que l’ébène de la fenêtre. Elle donnera naissance à Blanche Neige, juste avant de mourir et un an plus tard, le roi reprendra pour reine la plus célèbre des marâtres.
Aux sept ans de Blanche Neige, alors qu’à son habitude la reine demande à son miroir qui est la plus belle du royaume, il lui répond que Blanche Neige est mille fois plus belle qu’elle. Folle de jalousie, la reine missionne le chasseur de conduire Blanche Neige au fond de la forêt et de l’égorger. Le chasseur a pitié de la jeune fille qui lui demande grâce et il l’abandonne, convaincu que les bêtes sauvages de la forêt la mangeront, heureux de ne pas avoir eu à la tuer de ses propres mains. Il tue un marcassin dont il ramène le foie et les poumons à la reine qui les fait cuisiner avant de les manger. Blanche Neige court devant elle, elle regarde derrière chaque feuille, les bêtes de la forêt la frôlent mais ne lui font aucun mal. À la nuit elle découvre la maison où tout est trop petit, elle mange aux sept couverts et essaie les lits jusqu’au septième qui lui va parfaitement. Rentrent les sept nains qui piochent dans la montagne. Ils la découvrent et le septième nain dort une heure dans le lit de chacun des six autres. Le matin venu ils acceptent d’héberger Blanche Neige à condition qu’elle entretienne la maison et leur prépare le repas. Ils la mettent en garde contre la reine et lui défendent de laisser entrer qui que ce soit.
Le miroir apprend à la reine que Blanche Neige est toujours en vie et qu’elle a trouvé refuge chez les sept nains. La reine lui rend visite déguisée en marchande, d’abord Blanche Neige refuse de la laisser entrer. La reine lui présente ses marchandises et Blanche Neige se laisse tenter par un beau ruban. Elle laisse entrer la reine qui, l’aidant à nouer son corset, serre si fort qu’elle l’étouffe. La nuit vient vite et les sept nains, la trouvant comme morte, parviennent tout juste à la sauver. Ils la mettent à nouveau en garde mais bientôt elle se laissera tenter par un beau peigne empoisonné que la marâtre lui passera dans les cheveux. La nuit vient vite et à nouveau les sept nains ont tout juste le temps de la sauver. La troisième fois, la reine amène à Blanche Neige une belle pomme dont le côté rouge est empoisonné. Pour lui montrer qu’il n’y a nul poison dans la pomme, la reine mange le côté blanc. Tentée par le fruit délicieux, Blanche Neige croque dans le côté rouge du fruit et meurt sur le coup. La nuit vient vite mais les sept nains ne peuvent rien pour la sauver. Ils refusent de l’enterrer dans la terre noire et lui confectionnent un cercueil de verre avec son nom écrit en lettres d’or. Chacun leur tour ils gardent le cercueil en haut de la montagne, l’admirant avec les animaux de la forêt qui l’aiment tant. Elle est si fraîche qu’on la penserait endormie. Au château, le miroir répond à la reine qu’elle est la plus belle du royaume.
Un jour, un prince qui s’est égaré dans la forêt trouve refuge chez les sept nains. Blanche Neige lui plaît tant qu’il les supplie de lui permettre d’emmener le cercueil. Les nains refusent, peu importe ce qu’il pourrait leur proposer en échange. Il leur répond qu’il ne peut vivre sans admirer Blanche Neige et qu’il la traitera et la vénérera comme sa bienaimée, comme ce qu’il a de plus cher au monde. Les nains acceptent et l’aident, emportant le cercueil. C’est alors qu’ils trébuchent sur une racine, la secousse délogeant le morceau de pomme qui obstruait la gorge de Blanche Neige. Ayant retrouvé la vie, libérée, elle ouvre les yeux, soulève le couvercle de verre et se redresse. Elle s’éprend du prince et bien vite leurs noces sont célébrées. Alertée par son miroir, la reine tente de se mêler à la fête. Elle est reconnue et on lui fait chausser des fers incandescents avant de la faire danser jusqu’à sa mort rapide.
Conte-type n° 709 (Blanche Neige) : Version des frères Grimm


Qui est-elle, cette jeune fille des contes ? Elle est née d'un homme ayant mangé la grenade de grossesse de sa femme, elle est la fille aux mains coupées par un père tenté par le diable, elle est l'enfant d’un prince et d’une femme vivant au fond de la forêt, elle est la fille du veuf marié à une terrible marâtre qui a une fille méchante et laide, elle est l'incarnation du songe d'une reine s'oubliant devant trois gouttes de son sang sur la neige.
La première fois elle est recueillie, elle est protégée, elle agit bien comme il faut, souvent elle est aimée. Mais elle ne vit pas véritablement, elle n'aime pas en retour, elle ne connaît ni la haine ni la passion. Elle n'est pas confrontée au choix, elle n'a pas à rompre la roue qui la bat. Elle est élevée par un faucon et le fils du sultan la capture, elle est épousée par un prince qui lui fait confectionner des mains d'argent, elle est repêchée par un vieux qui l’élève avec sa femme, elle garde la vache noire, ou elle est accueillie par les sept nains. Mais quelle vie ? Elle est perchée en haut d'un arbre, elle a de fausses mains en argent, elle entretient un jardin au fond de la forêt, elle retourne vivre avec la marâtre et sa fille, ou elle balaie une maison trop petite. Et qu'en dit-elle ? Elle accepte son sort, aussi injuste soit-il, elle accepte sa nouvelle condition, car ce qui compte d'abord, c'est de vivre. Il faut qu'elle soit à nouveau perturbée de l'extérieur, c'est une belle mère qui la découpe en morceaux, c'est le diable qui manigance contre elle, c'est la mère qui révèle inconsciemment à la fille ce qu'il manque à son beau jardin, c'est la belle-mère qui tente de la tuer en lui faisant manger un chat noir, c'est la reine qui sournoisement s'introduit dans la petite maison pour l'empoisonner.
C'est à l'issue de l'épreuve et de la réclusion, après l'intervention d'une force supérieure sous la forme d'un vœu exaucé par l’anneau royal, du miracle de mains qui repoussent, d'un chat noir qui se fait mystérieux justicier, par une monture qui la conduit dans l'ombre et le silence, par une racine qui fait trébucher sept nains à la fois, que la fille parvient à une plénitude, un amour réciproque, un épanouissement qui s'affranchit des menaces. Elle épouse le fils du sultan ou le prince qui l'a cherchée sept ans sans relâche, elle sublime le jardin et l’oiseau fait connaître la vérité, elle épouse le seigneur Rio et ils ont pour fils le plus grand des magiciens, ou elle épouse le prince qui ne pouvait vivre sans l'admirer.
Elle semble bien passive, pourtant survivre à ces épreuves est une prouesse, tout en douceur semble-t-il, mais impitoyable avec la marâtre et ses alliées, elle ne s'opposera pas à leur bannissement ou à leur supplice. Elle attend sereinement dans le jardin et coupe la langue de ceux qui ne doivent pas dire, elle prie et vit pieusement, elle se fait bander les yeux et boucher les oreilles se laissant guider par sa monture, elle attend entre la vie et la mort, dans un semblant de sommeil comme dans une étrange méditation, qu'un beau hasard l'éveille, suscité par celui qui ne peut vivre sans l'admirer. Une profonde sagesse réside dans l'attente, dans la confiance en des déroulements inconscients, dans le temps qui l'épanouira et lui donnera raison, terrassant l'insurmontable adversité. Subitement elle est portée à la plénitude, par une intervention qui semble venue d’ailleurs. Elle a été entendue et elle est changée, enfin complète, authentique. Elle s’unit alors et forme ce couple qui « vivra heureux et aura de nombreux enfants », il s’entend une renaissance dans l’harmonie d’un monde de ténèbres et de lumière. Ce monomythe fonctionne merveilleusement, dans ces contes populaires comme dans les Tapisseries, contemporains de temps, de lieu, de culture et d’esprit.
La dame des Tapisseries est d’une origine mystérieuse, elle apparaît, mêlant l’or à la nuit, caressant la corne d’une licorne, à l’issue d’un tournoi opposant la raison au vent spirituel. Le premier équilibre est celui d’un mariage, elle tresse une couronne de fleurs, tout paraît bien comme il faut dans le paisible foyer que garde le héron. Sous le coup de l’amour qui blesse, la dame est assaillie par l’ombre, l’amour qui blesse d’Ouïe, elle tombe dans la mélancolie et s’isole dans une douce torpeur. Son recueillement se poursuit sous la tente de « Mon seul désir » où elle apprivoise son ombre, le faucon est enchaîné et elle renaît, changée. Vient la réunion, le baptême de la perle, dans l’harmonie de Goût. Ce qui se trame sur Vue est au-delà du monomythe, il y a dans Vue un dépassement, un ailleurs au-delà des mots, il y a la magie unique des Tapisseries, de la magie véritable, celle où « l’âme agit ».
Ce monomythe au féminin n’a pas connu le succès du cycle du héros, comme la divinité féminine a été effacée de notre monde, sans être effacée de nos cœurs. Et ce qui était vrai un jour le reste aujourd’hui, car cette divinité au féminin exprime la nature profonde et inaltérable de l’être. Pour Von Franz, c’est le besoin que nous avons d’établir un lien avec la Déesse, un besoin qui demeure, mais qui a été poussé dans l’ombre, dominé, écarté du conscient. Le monomythe au féminin nous conduit à la rencontre de notre véritable nature, au-delà des conventions. Pour cela, il nous faudra nous séparer des autres pour aller au plus profond de notre être intérieur. Ce lieu, cette retraite, est la forêt intime, la terre vierge ou l’enclos sacré. Il y a l’idée du secret, d’une chose qui se passe sous silence, à l’abri des regards, une chose si fragile que la lumière profane du conscient suffirait à la détruire. Là où Campbell nous parle d’une aventure frénétique, le monomythe au féminin nous parle d’une conquête intérieure, dans une apparente passivité. Un monomythe au féminin qui mène à l’incarnation de la femme divine, par l’intercession d’une force mystérieuse, par la prière, par un merveilleux hasard, par l’oiseau qui dit la vérité ou par la malice d’un chat noir à qui elle donna elle-même naissance.
Il faut dire encore une chose de La fille du faucon. Lorsque la femme commande à l’homme d’aller accoucher loin du village, il y a une inversion du principe féminin. L’homme est répudié par la femme et pourtant il est bien la femme répudiée, des deux il est le plus intrinsèquement féminin, il porte un enfant. Il n’est pas seulement répudié parce qu’il est une anomalie honteuse, il est répudié comme les sociétés primitives ont répudié la femme enceinte et l’accouchement. La distinction entre masculin et féminin n’est pas dans la forme, elle est dans la pensée, dans les épanchements, dans les instants. Le monomythe ne demande qu’à s’opérer en nous toutes, et en nous tous.
Le monomythe appliqué
Un défi
Dans La femme, Von Franz confond volontiers le personnage féminin des contes, le complexe féminin (assimilable à l'anima) et la Déesse. Cette Déesse, ou plus précisément, « la revanche de la déesse », devient l'objet de réflexions et de mises en perspective iconoclastes :
« L’incarnation de Dieu dans le Christ a été vécue comme une expérience religieuse collective de portée immense. Mais, dans le cas de la Déesse mère antique, la tendance vers l’incarnation en une fille humaine n’a pas abouti. Ce qui signifie, au plan pratique que, l’image de la femme n’étant pas reconnue, la femme ne l’est pas non plus. Nulle part ce désir d’humanisation n’a été mené à son terme et ne s’est traduit sous forme d’événement religieux et culturel. Le culte même de la Déesse mère a tourné court et a été réprimé. S’il est réapparu plus tard dans la dévotion à la Vierge Marie, c’est accompagné d’importantes restrictions mentales et de précautions visant à purifier la Déesse de son ombre. On accueillait à nouveau la Déesse mère, mais dans la mesure seulement où elle se soumettait à l’approbation de l’homme et se comportait « convenablement ». L’aspect d’ombre de la Déesse mère antique n’a pas encore fait sa réapparition dans notre civilisation, ce qui nous laisse sur une interrogation, car il est évident qu’avec elle un élément important est absent. »
Von Franz nous met au défi : retrouver l’ombre de la Déesse mère antique. Ce terme est réducteur, il exige l'antique, l’éloigné, et la Déesse mère fait par trop référence aux figurations archaïques de fertilité, celle qui enfanta le monde. Certes, la Déesse est parfois la mère, mais exiger qu'elle le soit c’est se fermer bien des portes, celles de la tentation, de la maîtresse, de l'ensorceleuse, c'est se fermer les portes de l'ombre. Ce qui importe est qu’elle soit femme avant d’être antique, qu'elle ne soit pas la nymphe caressant sa harpe. Parlons d'abord de Déesse, nous parlerons plus tard d'Isis au pluriel, l'Isis aux mille noms, Isis la myrionyme. Nous verrons que la Déesse, ou son incarnation dans la femme divine, est déjà là, toute proche de nous, cachée et pourtant à la vue de tous. Il nous suffira, pour relever le défi que nous lança Von Franz, de la révéler à sa propre lumière.
La justice au féminin
Une dimension négligée du principe féminin est celle de la justice. À la justice masculine qui est égale pour tous, impitoyable, s’oppose le principe féminin de l’exception et de la miséricorde. Il en va de même au niveau divin, par la condamnation aux peines de l’enfer dont la Vierge Marie adoucit le sort, elle qui protège le pécheur sous son manteau de clémence. Mais attention, une justice au féminin persiste, une justice proche de la loi de la Nature qui punit la déviance de l’ordre naturel des choses, écrite en termes d'harmonie et de lois intuitives. C’est une justice qui sanctionne par un effet néfaste, une punition, une vengeance de la Nature ou de la psyché, une malchance, une maladie ou une névrose. Une punition dont nous connaissons la cause, comme une évidence, par un sentiment presque inexplicable de culpabilité. La justice du principe féminin agit comme une réponse de l’inconscient, une réponse négative du soi régissant au moi agissant. Pour être en accord avec ses exigences, il ne suffit pas de s’en tenir aux lois écrites de main d’homme, il faut écouter l’instinct pour agir en accord avec les lois internes de l’être. L’ordre naturel et instinctif des choses vaut au moins celui des lois établies, dont le temps démontre souvent la nature arbitraire. Celui de lois où l’on dit volontiers que « justice est faite », alors que l’injustice est criante. Cette justice au féminin n’est pas que compassion et charité, elle attend de nous équilibre et harmonie. C’est une justice que nous avons perdue de vue et qui continue de nous régir, par les rouages implacables du soi, sous l’ombre de l’anima.
Dans les Tapisseries, cette justice au féminin apparaît sur Désir par la vengeance de la dame sur le faucon, nécessaire à la rédemption, au dressage de l’ombre. Il n’y aurait pas le miracle de l’union de l’âme et du verbe de Goût, par cette liturgie de la perle et de la perruche, s’il n’y avait le faucon chassant la pie du ciel. L’ombre n’est pas le mal nécessaire à l’exercice du bien, elle nous fait accepter un monde de contrastes, de jours et de nuits, d’aubes et de crépuscules.
Divine et divinisante
Pour revenir au conte de La jeune fille aux mains coupées, à l’issue de son séjour au fond de la forêt, la jeune fille reçoit des mains nouvelles, ce ne sont pas les mains d'argent, ce ne sont pas non plus ses premières mains. Ces mains nouvelles sont l'effet d'une amputation suivie d'une sublimation de la souffrance, par le recueillement dans la petite maison où chacun vit librement. Mais ce n'est pas tout, dans ces mains la jeune fille porte la Manifestation, les mains que Dieu lui a faites, car c'est Lui, certes en récompense d’efforts, mais c'est Lui seul qui a opéré le miracle. Un « Lui » au masculin seulement parce que la langue nous l’impose, un Lui ineffable, préalable à la séparation en Adam et Ève.
Les nouvelles mains de la jeune fille, ce lien agissant au monde, sont indissociables de la main de Dieu. La dame est devenue porteuse de Lui, elle agit avec Lui, ce qu'elle touche est touché par Lui. À ce titre, elle n'est pas seulement bénie, ou sacrée. Elle est divine car elle est divinisante, elle dispense la Grâce. Et quand viendra leur fin, Dieu étreindra ensemble la reine et le roi, un roi changé, initié, baptisé par la reine, devenu digne de l’intimité de Dieu. Le processus entier de transformation de l'héroïne du conte, ce processus du monomythe au féminin, fait descendre sur la dame la main de Dieu et elle devient, elle-même, porteuse et médiatrice du divin, elle devient divinisante, elle devient la femme divine.
Du féminin sacré à la Femme divine


Le culte féminin le plus répandu de nos jours est celui de la Vierge Marie, le culte marial. Bien que la Vierge n'apparaisse que bien peu dans les Évangiles, le culte marial a été évident, immédiat, dès les premières années du christianisme. C'est, selon certains, parce qu’il existait une terreau propice qu’il suffisait de convertir, un terreau faite de cultes aux Déesses. [32]
L'assimilation de Diane est un exemple d’assimilation dans le culte marial. Preuve en est que le concile de 430, fameux concile établissant le theotokos (Marie est la Mère de Dieu incarné dans le Christ), s’est tenu à Éphèse. Ephèse où d’après de solides traditions locales, l'apôtre Jean partit s’établir avec la Vierge Marie après l'Ascension du Christ. Ephèse, presque au pied de la quatrième des sept merveilles du monde, le grand temple de Diane, ou plus précisément ses ruines, juste après sa destruction emportant la statue noire de la Déesse. Il fallait que Diane revive, que ses fervents disciples trouvent une nouvelle femme, une réincarnation à aimer, ils trouvèrent la Vierge.
Notre-Dame de Guadalupe au Mexique est un autre exemple d’assimilation, d’intégration de
croyances séculaires dans la Vierge. À l’endroit même où apparut la Vierge, là où un enfant cueillit une rose en plein hiver, imprimant au versant de son habit le visage de la Vierge, à cet endroit même il y avait un sanctuaire dédié à la déesse précolombienne Coatalícue, « Notre Mère ». [32] Lorsque l’enfant, Juan Diego, lui demanda son nom, l’apparition lui répondit « Cuatlapcupeu » : « celle qui vient de la lumière et de la musique comme l’aigle de feu », un nom proche de « Guadalupe », célèbre Vierge miraculeuse qui était vénérée à Cáceres, dans l’ouest de l’Espagne. Ainsi les sons se ressemblent et assemblent les cultes.
La Vierge est populaire, au sens où elle a toujours appartenu au peuple, un peuple qui l’a élevée aux Cieux sans attendre qu’à notre siècle seulement l’Église la reconnaisse « Reine des Cieux ». Concernant la Vierge à chaque fois c'est le peuple qui crut avant que l’Église accepte, en témoigne l'acceptation bien tardive par l’Église de l’Immaculée conception (XIXe siècle) et de l’Assomption (XXe), après des siècles de ferveur populaire. De ces assimilations au nom du peuple exprimant son besoin profond, irrépressible, intrinsèque, la Vierge sort à chaque fois grandie. Elle sera l’impératrice des Cieux, la miséricordieuse, celle dont les larmes lavent le péché du monde, comme les larmes de la jeune fille purifient ses mains. Pour découvrir les racines du culte, pour aller aux profondeurs, nous devons nous intéresser à ce que le culte marial a de moins canonique : le culte des Vierges noires.
Assimilations dans le culte à la Vierge
Le miracle des Vierges noires
Comment en suis-je arrivé aux Vierges noires ? Est-ce par la lecture de Jules Bois ? Ce fameux Jules Bois, l’avais-je d’abord rencontré dans un chapitre de Paris occulte ? [33] Un chapitre consacré à l’affaire de la guerre des mages dans laquelle avec son frère en sorcellerie Huysmans il défia en duel Stanislas La Guaïta et Papus, Papus qu’il rencontra à deux reprises à l’aube, la première fois les balles furent suspendues en l’air par magie, la seconde Bois sortit une épée plantée sous l’aisselle. Ou avais-je rencontré Jules Bois dans une allusion de Huysmans dans Là-bas ?
Toujours est-il que j’ai trouvé les Vierges noires dans ses Petites religions de Paris, cet inestimable documentaire sur le Paris ésotérique de la fin du XIXe. [34] L’auteur nous révèle que son culte à lui était un culte isiaque à la française dont il ne nous reste, hélas, que peu de choses aujourd’hui. Avec nostalgie j’ai tenté de pénétrer son allusion émouvante à « celle qui ne fit jamais pleurer personne ». Dans Les petites religions, il mêle plus ou moins cette résurgence isiaque aux Vierges noires qu’il introduit par une anecdote qui se déroula à Saint-Germain-des-Prés :
« Sur le versant de la colline, nommée depuis la colline Sainte Geneviève, de récentes fouilles autour de la basilique de Saint-Germain-des-Près découvrirent une statue de femme tenant un enfant entre ses bras. Le clergé y crut voir une vierge Marie. Elle opéra des miracles ; mais des archéologues plus tard l’ayant reconnue pour une Isis, elle fut expulsée du sanctuaire comme démoniaque. »
Je retrouvai les Vierges noires dans La Vierge [32], ouvrage précieux pour comprendre la naissance du culte marial dans un entremêlement subtil du canon naissant avec les racines païennes. Ce bel ouvrage qui s’ouvre par la citation de Mircea Eliade : « La désacralisation ininterrompue de l’homme moderne a altéré le contenu de sa vie spirituelle mais n’a pas brisé la matrice de son imagination : tout un déchet mythologique survit dans des zones mal contrôlées. »
Les Vierges noires sont du noir non pas de l’ombre mais de l’obscurité, celle des grottes, les grottes des antiques religions à mystères, ces grottes de la mort nécessaire à la renaissance initiatique. Elles sont noires des entrailles de la terre, car elles sont chtoniennes, réminiscences d’un culte agraire, et elles se révèlent à nous par ce miracle familier dont Jules Bois nous fit un exemple : un paysan trouve dans le sillon creusé par sa charrue une statue, c’est la statue noire d’une femme à l'enfant, on croit au miracle d’une effigie de la Vierge qui n’a pas été créée de main d’homme, on lui fait une jolie couronne, on la place en haute grâce et elle accomplit des miracles. Surgit alors une autorité quelconque, venue d’un peu plus loin, qui crie à l’hérésie, au culte païen, et la fait détruire. Comment auraient-ils pu s’imaginer que ces statues préexistaient à leur Vierge, qu’elles étaient les témoins de Vierges antérieures, que l’on associe à présent à un culte isiaque, un culte à Isis comme il y a un culte marial, un culte à la Vierge ?
D’Isis la myrionyme aux Vierges noires
Les Vierges noires témoignent d’un culte passé, dédié à une divinité féminine, ici en Gaule. Peut-être qu’elles sont des effigies d’Isis, l’authentique, l’Égyptienne, celle d’un culte importé d’Alexandrie par les marchands phéniciens, des effigies teintées du noir de la véritable Isis et de la Diane d’Éphèse. En réalité peu importe que le culte soit importé ou autochtone, car des siècles durant, l’on a utilisé le terme d’Isis pour désigner Cérès, Junon, Minerve, Proserpine, Thélis, Cybèle, Fènus, Diane, Sophia, Bellone, Hécate, la Nature même. Isis était la myrionyme, la Déesse aux mille noms. [34]
Mille Isis semblables, revêtant les mêmes vertus féminines, nées dans le monde entier du même fond intrinsèque de l'humanité. Isis. Une et pourtant multiple. Voici ce que nous enseigne l’Hymne à Isis, un Hymne pour mille Isis, daté du troisième ou du quatrième siècle de notre ère, découvert sur divers rivages de la Méditerranée. [35] :
« Car je suis la première et la dernière.
Je suis l’honorée et la méprisée.
Je suis la prostituée et la sainte.
Je suis l’épouse et la vierge.
Je suis la mère et la fille.
Je suis les bras de ma mère.
Je suis la stérile, et nombreux sont mes fils.
Je suis la magnifiquement mariée et la célibataire.
Je suis celle qui donne le jour et celle qui n’a pas procréé.
Je suis la consolation des douleurs de l’enfantement.
Je suis l’épouse et l’époux, et c’est mon mari qui m’a engendrée.
Je suis la mère de mon père.
Je suis la sœur de mon mari et il est mon fils rejeté.
Respectez-moi toujours.
Car je suis la scandaleuse et la magnifique. »
Il est légitime de parler de culte isiaque en Gaule, dès lors que par Isis on se réfère à une Déesse anté-mariale. Elle était l’objet d’un culte réel, chtonien, un culte de la fertilité, un culte agraire. Il y a cependant plus dans cette Isis, cette Vierge noire, que la fertilité de la grande Déesse mère, et voici comment la divinité peut s’enrichir : elle apparaît ici, de la fertilité, de la terre, avant d’attirer à elle les profondeurs psychiques de l’humanité vibrante et contemplante, elle opère des miracles, elle redonne vie à l’enfant mort-né le temps d’un baptême, elle exauce les vœux de fertilité, elle est l’intermédiaire de l’homme avec les Cieux, elle qui élève les prières selon le « priez pour nous », elle offre sa miséricorde, celle « qui n’a jamais fait pleurer personne », et elle initie, elle révèle les hauts mystères sous son voile.
Mes études sur les Vierges noires m’ont conduit à la lecture de Pierre Gordon, un auteur dont la pensée m’a semblé toute proche, riche en perspectives, capable de relire les Évangiles à la lumière du mythe ou du conte, et inversement, nous conduisant aux survivances de rites païens dans le rituel chrétien. Il y a bien dans le nom d’emprunt qu’est « Gordon » une filiation, à deux lettres près, avec « Guénon », l’auteur du fascinant Aperçus sur l’ésotérisme chrétien. Tout se tient.
Quatre cents statues ont été répertoriées à travers l’Europe, toutes noires. Noir de la Vierge noire de Notre-Dame de Rocamadour, noir de Notre-Dame du pilier de la cathédrale de Chartres, noir de Notre-Dame de Confession de l’abbaye Saint Victor à Marseille. Trois femmes noires, venues de la terre et couronnées de main d’homme, assimilées à la Vierge Marie selon l’enfant qu’elle porte, oubliant qu’Isis aussi portait son fils, amant, et dieu, Osiris. D’après Gordon, le noir est celui de la terre, de la grotte, de la mort nécessaire à la renaissance initiatique. Les Vierges noires nous plongent dans les profondeurs mystérieuses où loge la Mère initiatrice :
« la Madone noire était liée, par essence, à l’univers de sous-terre, à ce royaume de l’ascèse initiatique, où l’homme s’imprégnait de lumière et de force. (…) Notre Dame des Ténèbres, Notre-Dame de la Nuit, celle qui fait luire la clarté dans la prison souterraine où se trouve jeté l’homme, celle qui enfante pour lui la lumière, celle qui lui apporte l’or et le Soleil, celle qui est, en définitive, parce que, - sa couleur le prouve - elle traverse la mort, la fontaine de radiance et la Reine du ciel. » [36]
Curieuse assimilation que celle des Vierges noires. Noires et couronnées d’or. Comme le peuple fit élever le culte de la Vierge Marie, c’est lui également qui empêcha l’Église de détruire ce qui lui appartenait le plus légitimement, les Vierges noires. Habilement, encore, l’Église assimila, jouant des marginalités de la foi. Pour les Vierges noires, il y aura eu l’aide d’un court extrait du Cantique des cantiques, « Je suis noire et je suis belle » dit la servante du Seigneur. Ce fut cependant compliqué, pour quelques-unes entrées au canon beaucoup furent rejetées, brisées, piétinées.
Ici, simplement ici, à Saint-Germain-des-Prés
D’entre les Vierges noires détruites, il y en a une qui me manque plus que toute autre, c’est la fameuse Vierge noire de Saint-Germain-des-Près. Je ne sais pas bien de quelle Vierge noire parle Jules Bois, la nôtre devrait avoir été détruite, mais qui sait, peut-être qu’elle est aujourd’hui exposée dans un musée. Je vais vous dire l’histoire de la Vierge noire de Saint-Germain-des-Prés, qui va de pair avec l’histoire des Parisiens.
Pour commencer, il y a débat sur l’origine du nom de Paris. L’explication d’un certain François Pomerol tient en un mot : par-Isis [37], de Bar-Isis, « bar » signifiant « montagne », donc « la montagne d’Isis », nom ancien de la montagne Sainte Geneviève. De là j’ai laissé mon esprit flotter, m’imaginant Jules César qui, arrivant à Lutèce, se serait exclamé que c’était ici la ville des par-Isiens, ceux qui croient par-Isis. J’ai pris conscience de ces noms : « Saint-Germain-des-Prés » et « Notre-Dame-des-Champs ». Les prés et les champs nous rappellent que nous avons été ici hors de la ville, qu’il y a eu sous ces églises des terres vouées à un autre culte, un culte à Isis.
Dans Dissertations sur les Parisii ou Parisiens et sur le culte d’Isis chez les Gaulois, [38] Jean-Nicolas Déal nous raconte les premiers temps de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, fondée vers 540 par Childebert, neveu de Clovis. Déal cite Dom Jacques Bouillart [39] :
« Saint Germain, plein d’ardeur et de zèle pour l’accroissement du culte du vrai Dieu, sollicita Childebert d’exécuter le dessein qu’il avait déjà projeté de construire une église en l’honneur de Ste Croix et St Vincent. Le lieu qui parut le plus propre fut celui qu’on nommait alors Locotitia, où, selon l’opinion commune, restaient encore les anciens vestiges du temple d’Isis, situé au milieu des prés, proche la rivière de Seine, afin de faire succéder le culte du Dieu du ciel à celui des fausses divinités de la terre. »
Il a de cette façon regroupé une dizaine de citations similaires établissant l’existence d’un culte à Isis, la myrionyme, et que son plus grand temple fut à Saint-Germain-des-Prés. Childebert fit construire une abbaye, mais il ne put détruire l’idole, alors il l’assimila, il la cacha en pleine lumière, au sein même de l’abbaye. Elle y demeura mille ans, sous la forme d’une statue, avant sa destruction au sujet de laquelle Déal se réfère au Dictionnaire de la Fable [40] :
« Cardinal Briçonnet, mort en 1514, fit détruire dans cette même année, étant abbé de St-Germain-des-Près, une idole que l’on disait être d’Isis, et qui était dans un coin de l’église de cette abbaye : des femmes venaient encore invoquer cette idole. »
1514, c’est peut-être l’année de conception des Tapisseries. Il était tout proche, Antoine II le Viste, siégeant dès 1500 au Palais de la Cité, l’actuelle Conciergerie, aussi c’était tout proche de l’emplacement actuel des Tapisseries, au musée de Cluny. C’est une proximité qui alimente mes dérives. Voilà Jules César dans le frigidarium de Cluny, regardant au-dehors le vent caresser la blondeur des blés, s’interrogeant sur la présence ici, en haut de la Gaule, d’un culte venu du bas de la Méditerranée. Elle était déjà quelque part, cette statue de Saint-Germain-des-Prés, peut-être la lui avait-on présentée. Et tout ça aurait été juste à côté des Tapisseries, elles sont maintenant littéralement à l’étage du dessus.
Une femme aux mille visages - Les Vierges noires
Voici une autre histoire qui m'a conduit à la Vierge noire, une histoire qui m’a conduit à son entièreté, à son immédiateté : parallèlement à cet essai, j’ai écrit un roman. Je finissais de l'écrire quand mon second fils est né. Il est vite devenu difficile de rester plongé dans l’imaginaire, j’ai eu peur que tout cela se dissipe, j’ai eu des idées de délire de l’inventeur méconnu. Sur les bons conseils d'un ami, j'ai réécrit cet essai sur les Tapisseries pour me clarifier les idées, peut-être même le publier, on verrait, et de cinq pages je suis aujourd’hui passé à ce petit volume.
Bref, il y a eu un roman au milieu de l’essai, plus précisément un roman qui s’inspire de l’essai. À un moment, le protagoniste s’échappe d’une voiture sur un bord d’autoroute et il va par les champs de blé, jusqu’à la ville de Chevilly où il prend un train vers Paris. J’ai choisi Chevilly parce qu’elle était entre Orléans et Paris, séparée de l’autoroute par des champs de blé et qu’elle avait une gare. Il n’y avait au final que Chevilly qui convenait.
J’ai commencé par visiter Chevilly en street view et j’ai fait une découverte qui m’a convaincu. Je suis tombé sur une statue qui était une nouvelle concordance et j’y suis allé un lendemain de garde. J’ai vu des choses incroyables, un château digne des meilleurs films de Jean Rollin et surtout, il y avait la blondeur des blés. J’ai été jusqu’à l’autoroute, j’ai pris des photos, j’ai enregistré mes impressions et je suis retourné à Chevilly. J’ai marché par les champs, il y avait un bosquet comme une île sur des flots d’or et des biches telles des poissons volants jaillissant des blés comme d’une eau dorée. Je suis arrivé à Chevilly, là j’avais déjà repéré, des pavillons qui bordent les champs avant de s’épaissir jusqu’aux immeubles. Et je l’ai retrouvée, la statue de la Vierge à l’enfant, avec cette inscription sur son piédestal « Notre Dame des champs - priez pour nous ».
J’ai été frappé par ce beau hasard qui se mettait sur mon chemin comme ces statues de la Vierge noire que les paysans trouvaient sous leur charrue. C’était une statue en fonte de la Vierge à l’enfant, couronnée sur son long voile, tenant le blé du pain et le raisin du vin. Avant, comme le montre une ancienne carte postale, la statue était au milieu des champs, les pieds recouverts par les lierres. Aujourd’hui, elle est au bord d’un rond-point, entourée de bégonias. C’est un sentiment déchirant de nostalgie qui m’envahit quand je compare les deux images, la même statue à cent ans de distance. La marche s’accélère, maintenant c’est la Sainte Vierge que l’on a dissimulé à la vue de tous. L’oxydation de la fonte sous la peinture émaillée lui rendait par endroits une teinte noire. Sous la Reine des Cieux elle apparaissait, elle revenait, elle était là, ma Vierge noire. Je me suis agenouillé sous le prétexte des photos, j’ai été saisi par sa grâce, mais je n’ai pas vu immédiatement, c’est mon épouse qui me les a montrés après, ces yeux, des yeux dont le profil s’étire, comme le regard mi-clos de la dame de Vue.
Ma rencontre avec la Vierge noire


Du sacré au divin, du primanoxisme à la hiérogamie du déséquilibre
Pierre Gordon, dans La magie dans l’agriculture - Origine et sens des rites agraires [41], parle parfois de l’union hiérogamique, certes plus chic que hiérogamie. Il s’agit cependant d’un pléonasme puisque « -gamie » signifie déjà « union ». Il reste « hieros », du sacré. Nous parlerons donc de hiérogamie, qui prendra des sens différents selon que nous la déclinerons au sens commun d’union sacrée ou au sens oublié d’union divinisante, ou que nous considérerons l’union charnelle, le mariage, ou l’union spirituelle.
Et qu’est-ce que le sacré ? Dieu est ce terme effrayant comme les Tables de la loi, que je ne peux imaginer autrement qu’en Zeus lançant des éclairs de l’Olympe. Un Dieu frappé de sa propre punition, la langue de Babel l’obligeant à être rabaissé à porter un nom, comme nous l’avons dit plus haut, qui plus est à porter un genre, un Dieu au masculin, Lui qui ne peut se définir que par l’approche, l’immuable, l’ineffable, l’incréé. Il y a le verbe « sacrer », qui se réfère à l’acte, le sacrement du prêtre ou de la prêtresse, comme le sacrement du mariage. C’est la sacralisation de quelque chose qui bascule au-delà, dans la dimension de l’intouchable et du mystère. Il y a aussi l’instant sacré, touché par la Grâce, comme l’alchimiste devant le phosphore.
Gordon parle également de «mana, pour désigner une forme d'énergie sacrée, l’objet de la hiérogamie étant, par la conjonction du rite agraire et du rite hiérogamique, d’attirer le mana dans la terre par l’union sacrée. Dans l’avant-propos de La magie dans l’agriculture, Ange Duino définit ce mana comme une « énergie dynamique, source de toute manifestation et paradis perdu auquel l’homme tâche de se reconnecter depuis la nuit des temps ». Gordon parlera aussi indifféremment de surnature ou de divin. Il y a là l’expression non du geste (sacrer) ou de la chose (sacrée), mais de l’énergie, du mouvement, de l’élément qui anime et qui est transmis, pour lequel je parlerai du divin, propice à être transmis à nouveau, toujours actif. C’est là toute la différence entre la femme sacrée, touchée par le sacrement, et la femme divine, médiatrice du divin, initiatrice et divinisante.
Plus que la distinction entre l’union charnelle et l’union spirituelle, les deux allant de pair dans toute union véritable, la réelle distinction entre les différentes formes de hiérogamie est dans les protagonistes, à savoir qui s’unit à qui. Il y a deux cadres, disons scabreux, qui ne nous intéresseront pas dans leurs détails. Le premier est celui de l’union charnelle d’une jeune femme à un prêtre capable de prendre sur lui la puissance émanant de la perte de sa virginité par une défloration rituelle. Le second est celui de l’union d’un homme à une prêtresse qui, en tant que représentante d’Ishtar en Mésopotamie, sera faiseuse de roi au plus haut degré ou d’adeptes au quotidien [42]. Cette prêtresse, aujourd’hui, est enfouie, rejetée, par assimilation à la grande prostituée de l’Apocalypse, chevauchant la bête à sept têtes.
Dans le cas le plus fréquent, la hiérogamie concernera l’union d’un couple profane suivant un rituel initiatique. C’est le sacrement du mariage qui précède le primanoxisme, la première nuit d’un couple sacralisé.
Il existe une autre forme de hiérogamie, assez caractéristique de la pensée de Gordon, qui consiste dans le rétablissement d’un déséquilibre par union de l’homme à une Déesse ou à une fée venue de l’autre monde. [36] C’est cette forme de hiérogamie qui nous intéressera particulièrement. C’est celle-ci qui parle de la dame faite initiatrice dans Goût et dans Vue. Gordon ne lui a pas donné de nom distinctif, je parlerai de hiérogamie du déséquilibre. Avant, je prendrai le temps de détailler le primanoxisme, d’abord parce qu’il est intéressant d’en apprendre sur les rituels ancestraux du mariage, et parce que certains considèrent que les Tapisseries furent tissées pour les fiançailles d’Antoine II avec Jacqueline Raguier.
Primanoxisme
Le primanoxisme est une initiation de l’homme et de la femme qui les prépare à l’union, à la première nuit. Gordon, dans La magie dans l’agriculture, indique que l’effet attendu est de « restaurer, pour l’homme et la femme, le statut d’origine, statut surhumain, grâce auquel deux « Je » possédaient en commun, dans une indivision totale, un seul et même être (…) (et de) créer, autour de l’acte nuptial, une atmosphère de spiritualité qui le transforme en un acte divin. » Les exemples ne manquent pas à travers les peuples et les époques. Il s’agit de plusieurs jours, souvent trois, pendant lesquels le couple est séparé et où chacun vit selon une liturgie faite de jeûne et de prière. Ce sera idéalement leur première rencontre du divin, la première révélation du secret de la surnature, qui sera immédiatement suivie de l’union, étant encore l’un et l’autre emplis de sacré. Gordon nous indique cet exemple célèbre de sacralisation du couple dans le Livre de Tobie (VIII, 4 des.) :
« « Tobie exhorta la jeune fille, en disant : Sara, lève-toi, et prions Dieu aujourd’hui, demain et après-demain. Durant ces trois nuits, nous serons unis à Dieu, et après la troisième nuit nous vivrons dans notre mariage. Car nous sommes enfants des saints et nous ne pouvons pas nous unir comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. » (…) Alors, ayant reconstitué l’atmosphère rituelle nécessaire, ils pourront se voir nus, et leur union charnelle sera, comme au temps des saints anciens, une union sacrée. (…) S’étant sanctifiés l’un et l’autre, ils étaient préparés à ne plus envisager l’union de la chair comme un acte uniquement profane. Le monde de la surnature était présent à leur esprit ; ils plongeaient en lui ; ils célébraient leur union en qualité d’âmes, et non comme des créatures de matière grossière. C’est pourquoi du reste le « démon de l’ardeur », Asmodée, n’a plus de prise sur Tobie et Sara. » [36]
Hiérogamie du déséquilibre
La hiérogamie du déséquilibre procède par rétablissement d’un déséquilibre du divin. Ici, la hiérogamie est celle des mythes, des légendes et des contes. C'est l'union de l’homme profane à une déesse ou à une fée, une femme venue de l’autre monde. Dans les exemples pris par Gordon dans son article sur le conte de Mélusine publié à titre posthume dans les Cahiers du Sud [36], il s’agit d’une femme divine par naissance, qui s’unit à l’homme profane sous la condition d’un interdit. Cet interdit consiste dans le conte de Mélusine à voir sa femme nue.
C’est un interdit que l’on retrouve dans de nombreux contes de différentes régions et de différentes époques, comme le conte hindou de Purûravas et d’Urvaçi dont Pierre Gordon nous offre une analyse dans son article. Il peut aussi s’agir de garder un secret, de ne pas mentionner la nature mystérieuse de la femme, même des années après, comme dans le conte japonais de La Femme des neiges, magnifiquement filmé par Masaki Kobayashi dans Kwaidan. La femme divine ne doit pas être vue nue, il ne faut pas dévoiler le mystère, elle ne doit pas être connue dans son cadre liturgique. La transgression de l’interdit a pour conséquence sa disparition immédiate et irrémédiable.
À la première lecture, c’est une punition disproportionnée que cette perte sans recours de celle qui fit le bonheur et la richesse de l’amant. L'infime curiosité est punie par l’immensité de la perte. Mais il avait été mis en garde, il ne devait sous aucun prétexte transgresser l’interdit. Aussi puissante soit-elle, l’aura du divin ne supporte pas le sacrilège, l’homme est abandonné aux regrets, à la solitude et à l’errance. La hiérogamie du déséquilibre est souvent un échec annoncé.
Hiérogamie - l'union sacrée
Le plus bel exemple venu de nos terres est celui du conte de Mélusine. Le nom vient de « merveilleuse » ou de « mélodieuse », Mélusine est une jeune fille dont la partie basse du corps est celle d’un reptile, comme la queue d’une sirène. Elle offre à un jeune-homme de faire de lui le plus grand des seigneurs, à condition de respecter un interdit, elle ne doit pas être vue dans son bain. Il ne faut pas profaner l’instant liturgique, l’au-delà de l’autel, dans le moment intime de communion de la femme divine. Le jeune homme s’unit à elle et ils ont des enfants d’un amour heureux. La transgression de l’interdit vient généralement de l’extérieur, de la famille du jeune homme. Dans la version de Jean d’Arras Mélusine ou la noble histoire des Lusignan (1393), c’est inquiété par les médisances de son frère qui accuse Mélusine de forniquer avec d’autres hommes tous les samedis, que Raymondin regarde par la serrure. [43]. Dans une version antérieure, c’est la mère d’Henno qui surprend Mélusine nue alors qu’elle se baigne, par la suite de quoi Mélusine se transformera en dragon et disparaîtra dans les eaux. [44] Le rôle de la mère, ou plutôt de l’image de la mère, qui chasse la femme véritable, est celle de l’anima primitive du jeune homme, conforme aux exigences maternelles, qui chasse l’anima véritable encore mêlée à l’ombre, qu’est la femme qui se présente à lui.
Mélusine a fui, comme la jeune fille aux mains d’argent a fui dans l’épaisse forêt. Deux options se présentent à l’homme : rester hors de l’ombre, dans les jupons de sa mère ; ou partir à la poursuite de la femme, tout abandonner, pour errer dans le monde à sa recherche, pour la rejoindre dans l’ombre de l’épaisse forêt, et suivre le chemin qui conduit à l’anima véritable, dans ce que l’ombre a de précieux à lui offrir. C’est l’union authentique, l’équilibre, l’expérience pleine du divin dans la communion avec le sacré qui ne fuit pas à son contact. Gordon croit en l’existence de telles versions de Mélusine, mais dans celles à notre disposition, l’union échoue irrémédiablement par le malheur d’avoir exposé au grand jour ce qui devait demeurer caché, occulté, mystérieux. Parfois, Mélusine revient la nuit allaiter ses enfants. Cette descendance formera une noblesse populaire. Dans le roman de Jean d’Arras, Mélusine, la « Mère Lusigne », donne naissance à la lignée des Lusignan. Le conte de Mélusine est une hiérogamie à moitié, comme Mélusine est à moitié femme et à moitié serpent. La profanation de la femme-fée, si ce n’est la femme divine, dans son élément, dans son enclos sacré qu’est l’eau, dans sa liturgie, a condamné l’homme à sa condition profane. Il n’aura fait que pressentir la dimension mystérieuse, il n’aura obtenu d’elle que les dons matériels, richesse et bonheur. Il n’aura pas atteint l’autre monde où Mélusine aurait pu le conduire. La Chute se rejoue. Regarder Mélusine dans son bain est une tentation sanctionnée par la séparation, la chute, comme l'a été la tentation première, celle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dans Mélusine, la femme est divine par naissance, elle ne l’est pas devenue par initiation, comme cela est le cas dans La jeune fille aux mains coupées et les Tapisseries. Dans ces deux œuvres, la femme suit l’initiation que nous avons évoquée sous le nom de monomythe au féminin. La femme parvient elle-même au divin, elle suit une liturgie qui semble gravée dans son âme, éveillée par la rencontre de l’épreuve, plongée malgré elle dans la solitude, la privation et le silence propices à l’ascèse, guidée par la Grâce, par œuvre de piété dans l’auberge « où chacun peut vivre librement » ou sous la tente de « Mon seul désir ». Devenue femme divine par ses efforts et par œuvre de la Grâce, elle initie à son tour et c’est en initiant qu’elle atteint sa pleine splendeur, sa pleine divinité. La dame et l’unicorne, son homme, doivent rétablir le déséquilibre initiatique avant de s’unir, sans quoi le couple en resterait au même échec que celui de Mélusine. La dame est prêtresse et se découvre telle dans l’initiation de son homme. La dame des Tapisseries parfait son initiation dans le baptême de la perruche par la liturgie de la perle. Dans la hiérogamie du déséquilibre, l’ultime achèvement est celui d’un couple uni aux trois degrés de l’être. Il n’est plus seulement baigné d’aura sacrée, il bascule dans sa projection céleste, de l’autre côté du miroir.
Nous avons évoqué les Vierges noires, mais elles sont plus du noir de la terre, des profondeurs chtoniennes, que de la noirceur psychique, de la sorcière et de l’appétit pour l’ombre. Le conte de La jeune fille aux mains coupées introduit une autre dimension de la divinité. C’est au début du conte, lorsque la fille a eu les mains tranchées, deux obstacles empêchent le diable de la prendre avec lui : la jeune fille s’est purifiée trois fois, Trois le nombre magique de toutes les incantations, des conjurations et des rituels protecteurs ; et surtout ces purifications ont été accomplies dans le cercle tracé à la craie, le cercle de protection apotropaïque qui forme l’enclos sacré. Ici, est-ce la grâce de Dieu qui protège la jeune fille, ou d’autres forces appelant à l’ombre d’une divinité différente, d’un culte de sorcières, par un principe analogue au pentagramme tracé au sol ? Le diable fuit-il par crainte de Dieu, ou par crainte de la Déesse ?
Von Franz nous parlait de libido et nous avons brièvement évoqué la prostitution sacrée des prêtresses d’Ishtar, mais il y a bien plus à évoquer, à savoir, à reconnaître. Ce serait éluder une réalité précieuse, ce serait fuir l’ombre qui nous habite, qui nous construit, qui nous enrichit, que de ne pas nous laisser aller à la tentation de l’ombre de la femme divine. De sa dualité, nous n’avons en fait vraiment évoqué que la lumière, laissons-nous aller à l’ombre. Pour cela je commencerai, dans une rupture de style, par une invocation entière, brute, de la femme de l’ombre, car il faut aller au plus proche de l’expérience, il faut laisser l’ombre nous pénétrer et connaître ses délices.
Une hiérogamie du déséquilibre - Mélusine
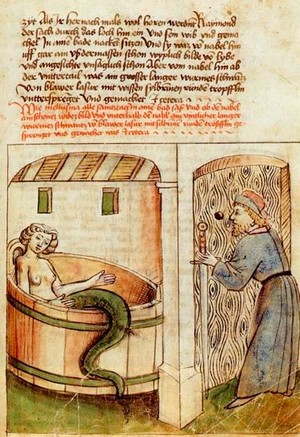

En rester où nous en sommes serait ne pas aller au bout. Il y aurait une mise à distance, une sur-analyse de ce qui nous habite. Il manquerait la sympathie pour l’ombre. Cette sympathie je vais essayer de la partager avec vous par un exercice de style. Je vais tenter un bref instant de vous conduire au cœur du brasier, au cœur d’un interdit qui se transgresse avec plaisir, une rencontre dont l’envie revient parfois, insaisissable. C’est ce que l’on appelle gentiment le romantisme, un terme qui ne rend nullement honneur à son sujet, un terme qui se confond entre l’œuvre littéraire et le sentiment amoureux teinté de fictions rosâtres. Ce serait alors un romantisme teinté de décadence, de morbide, de parfums lointains aux souvenirs âcres et sensuels, de musc et de fourrure. C’est un romantisme qui se teindrait goutte à goutte de volutes noires, c’est la chambre voulue sombre et tendue de velours d’À rebours, c’est la résonance de ce titre, Les fleurs du mal, si l’on songe qu’il n’a été pensé que pour soi.
C’est ce qui se produit si las d’une nuit sans sommeil, l’esprit vagabond, l’on se permettait une promenade en des lieux familiers, à présent couverts d’une indicible étrangeté, soumis aux effets du froid toucher d’une statue au cimetière, du reflet d’ivoire du serpent enlacé et sa morsure au sein de Cléopâtre, de corps purement vêtus du clair de Lune, de chants entêtants, de regards lourds de remords et de torride vengeance. C’est tous les possibles offerts par l’action intérieure, une vie de fantasmes exaucés par la vue, des envies bestiales qu’éveille la peau tendue sous le cou incliné, l’envie de ce que l’on n’ose vraiment se dire, de ce que l’on ne sait bien comment, mais qui agit à couvert en nous, non sans plaisir. Dans cet inacceptable il y a du mouvement de l’ombre de la Déesse, des sillons qu’elle suit en nous, de notre dévotion et de notre liturgie invisible.
C’est l’envie d’un soleil noir, d’une femme aux ailes déployées, d’Ève et du serpent qui s’immisce. C’est l’envie qui naît tandis que nous voyons à la pleine lumière du musée les parts d’ombre à taille humaine, dans les plis de la posture antique, dans l’oubli de la dure pierre sur la tendre peau. C’est l’envie d’un visage qui nous séduirait sous le pourpre brodé de la cape, du pressentiment d’une âme habitée, d’une âme encryptée de symboles, du souvenir au réveil de voluptés fantômes, de griffures qui dessinent une amie lointaine, oubliée, qui cependant promit de revenir, d’un index s'approchant des lèvres, de bras tendus vers le ciel, d’invisibles voilages ceignant la peau, d’une chevelure portée par les flots, d’une lascivité perpétuelle, d’une nudité native, d’une silhouette hors de la brume, et d’un regard, d’un regard qui sait le plus profond de vous, un regard qui a les antiques connaissances, un regard qui est le geste, qui est le toucher, qui s’articule en langage avec vous, victime dévouée, un regard qui continue de vous abreuver dans le chant de cette liturgie intime, de la plongée qu’il suscite dans l’insondable, qui peu à peu émerge et se libère.
C’est une morsure qui réveille au souvenir de l’éclat haut du brasier, à ce qui se trame sur le crépuscule, cet arc-en-ciel de l’ombre, d’étoiles tombantes, d’une ronde nue s’élevant dans le ciel, sur une eau qu’irise la Lune, dessinant la douce blancheur de la peau, des promesses d’un regard, à la lueur de la flamme, de la femme baisant l’ultime soupir, d’un corset qui se délasse, de sucre vert et d’opium, d’un culte de branchages et d’herbes sauvages. C’est la beauté d’un corps, de la Nature qui inlassablement se dévoile, d’ailes déployées qui seules font descendre la lumière. C’est la brisure entre le rouge et le noir. C’est la réponse à l’invitation de l’ombre. C’est l’intrigante beauté de l’ange déchue.
L'ombre de la Déesse - Romance gothique


Un mystère à la taille de celui des Tapisseries est celui d’une figure populaire aujourd’hui si banale que son caractère mystérieux est oublié de ceux qui la voient. Le secret peut demeurer à la vue de tous, précieusement protégé par le peuple. Un peuple que Papus, dans Le tarot des bohémiens, le plus ancien livre du monde qualifiait de dépositaire inconscient de la science occulte : « Le peuple n’a jamais trompé l’attente de ceux qui ont eu foi en lui. Ne comprenant rien aux vérités qu’il possède, il n’a garde d’y changer quoi que ce soit et considère comme un sacrilège la moindre atteinte portée à son dépôt. » [45].
Osons explorer ce qui est à la portée de tous, les tableaux hauts des musées comme les feuilletons télévisés. À la façon des Tapisseries, une figure préservée par le peuple, authentiquement populaire, m’a parlé depuis toujours, inexplicablement : le vampire. J'ai lu des romans et des analyses, j’ai regardé des films et des documentaires, j'ai consulté vampirologues et vampires modernes, mais le mystère reste entier, rien ne parvient à me révéler le « pourquoi » du vampire. Je me sens devant lui comme devant les Tapisseries. Il pourrait y avoir là une clé commune au mystère, dans une facette de la femme, une femme en noir.
Tout commença vers mes sept ans, une nuit d’été dans la Drôme, une chauve-souris entrée par la fenêtre battait follement des ailes au plafond de notre chambre, terrifiant ma sœur. Les jours qui suivirent, mon père me conta l’histoire des vampires. J'ai immédiatement été fasciné par l'ambiguïté entre mythe et réalité, entre homme et bête, avec au-delà une chose qui m’échappe aujourd’hui encore, une chose faite de noir et de sang. Vint cet instant décisif, quand je lui demandai « les vampires, est-ce qu’ils existent vraiment, papa ? » et qu’il me répondit « mais nous sommes tous des vampires ! ». Je fis cette nuit un merveilleux cauchemar qui ne me quitterait plus.
Je lus mon premier livre de vampires après mes vingt ans, presque par hasard, dans un recueil de nouvelles fantastiques de Librio. C’était La morte amoureuse de Théophile Gautier, l’histoire d’une vampire nommée Clarimonde qui séduit un jeune prêtre à l’instant même de son ordination. Il l’entend malgré la distance :
« Si tu veux être à moi, je te ferai plus heureux que Dieu lui-même dans son paradis ; les anges te jalouseront. Déchire ce funèbre linceul où tu vas t’envelopper ; je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie ; viens à moi, nous serons l’amour. Que pourrait t’offrir Jéhovah pour compensation ? Notre existence coulera comme un rêve et ne sera qu’un baiser éternel. Répands le vin de ce calice, et tu es libre. Je t’emmènerai vers les îles inconnues ; tu dormiras sur mon sein, dans un lit d’or massif et sous un pavillon d’argent ; car je t’aime et je veux te prendre à ton Dieu, devant qui tant de nobles cœurs répandent des flots d’amour qui n’arrivent pas jusqu’à lui. »
Malgré le désir qui l’envahit et son dégoût aigu des ordres, il cède, oédiant à la cérémonie d'ordination, il prononce malgré lui le « oui » fatidique. Le voilà prêtre, il part rejoindre sa cure, la mort dans l’âme. Une nuit, un cavalier frappe à sa porte et le supplie de venir donner l’extrême-onction à sa maîtresse. Malgré des chevaux dévorant le chemin de sorte que « les silhouettes noires des arbres s’enfuyaient comme une armée en déroute », ils arrivent trop tard, Clarimonde est morte :
« La pâleur de ses joues, le rose moins vif de ses lèvres, ses longs cils baissés et coupant leur frange brune sur cette blancheur, lui donnaient une expression de chasteté mélancolique et de souffrance pensive d’une puissance de séduction inexprimable ; ses longs cheveux dénoués, où se trouvaient encore mêlées quelques petites fleurs bleues, faisaient un oreiller à sa tête et protégeaient de leurs boucles la nudité de ses épaules : ses belles mains, plus pures, plus diaphanes que des hosties, étaient croisées dans une attitude de pieux repos et de tacite prière, qui corrigeait ce qu’auraient pu avoir de trop séduisant, même dans la mort, l’exquise rondeur et le poli d’ivoire de ses bras nus dont on n’avait pas ôté les bracelets de perles. (…) je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Ô prodige ! un léger souffle se mêla à mon souffle, et la bouche de Clarimonde répondit à la pression de la mienne : ses yeux s’ouvrirent et reprirent un peu d’éclat, elle fit un soupir, et, décroisant ses bras, elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement ineffable. »
Le jour il sera prêtre, la nuit Romuald, noble de Venise. Je vous laisse lire la suite, c’est une hiérogamie, un rétablissement du déséquilibre dans une splendeur d’amour gothique. Clarimonde l’élève à elle et ensemble ils déchirent le voile du réel. C’est un amour qui me laissera habité de regrets, tel l’anglais du Roman de la momie. Ça aura été l’éveil d’une sensualité. Viendraient Carmilla de Lefanu et Ligeia d’Allan Poe. Qu’y a-t-il là ? Il y a plus que la hiérogamie. Laissons à la femme en noir ce qui lui appartient, le goût du sang, l’envie, la bête. Il faut nous piquer la langue sur la pointe des crocs, connaître l’envie de mordre et sentir couler en nous la langueur de la victime. Il y a dans le vampire un éternel regret, une délicieuse lassitude, un désir de l’autre monde.
Y a-t-il dans les Tapisseries quelque chose qui nous parle de vampire ? En tout cas, il existe un lien en moi entre deux mystères et voici où il se fait, par l'ombre au féminin, par le couple infernal de La morte amoureuse et un rétablissement du déséquilibre, accomplissant une élévation de l’homme par la femme en noir, confondant allègrement ombre et lumière. Je trouve aussi que la dame de Toucher, sous sa robe noire aux chaînes d’or, avec sa longue chevelure blonde aux reflets roux, a du charme de Sharon Tate dans le bain du Bal des vampires.
La femme en noir


Von Franz nous mit au défi de retrouver la Déesse mère. En réponse je vous ai promis que « la Déesse, ou son incarnation dans la femme divine, est déjà là, toute proche de nous, cachée à la vue de tous », qu’il suffirait « de la révéler à sa propre lumière ». Voyons maintenant si à cette lumière nouvelle que nous avons acquise, par la lumière et par l’ombre, apparaît la femme divine dans ce que nous avons de plus proche aujourd’hui, le cinéma, le culte de l’écran.
Dans Blue Velvet, réalisé en 1986 par David Lynch, ce sont deux femmes qui incarnent le dualisme de la femme divine. La femme blonde, la femme de lumière, Sandy, retient Jeffrey qui risquerait de sombrer. Elle est l’ancre qui le retient dans la tempête. Mais il n’entend pas ses rappels, lorsqu’elle klaxonne pour l’alerter de l’arrivée de la femme brune, la femme sombre, Dorothy. Jeffrey entre dans le placard mais Dorothy le trouve, elle tient un long couteau de cuisine, elle lui entaille la joue, elle le menace, elle le fait se dévêtir puis lentement elle s’agenouille, elle tient d’une main le couteau et de l’autre le sexe dont elle s’approche. Le couple est en équilibre instable, tendu par le seul désir de la femme sombre. Au seuil du plaisir, voici qu’entre Frank, l’Homme au négatif, Frank l’ogre, l’incarnation du mal. Jeffrey retourne dans le placard, il en sortira changé, marqué par le sceau de la perversion qu’incarne non pas Frank, mais le couple dont Jeffrey aura été témoin des ébats infernaux. Frank abuse de Dorothy, à la fois la mère, la fille et la femme. Peut-être aura-t-elle eu du plaisir. Surtout, Jeffrey aura-t-il eu du plaisir à les regarder ? Après le départ de Frank, après les mots de réconfort, la nature de Jeffrey sera bien facile à faire basculer dans l’ombre et à leur troisième rencontre il incarnera Frank, il cèdera, il frappera Dorothy avant de lui faire brutalement l’amour. Il y a un avant et un après du placard, un avant et un après de l’initiation à l’ombre. Chaque fois il verra Sandy avant de voir Dorothy, mais ce ne sera pas assez pour empêcher les ténèbres, pour empêcher Jeffrey d’aller vers le mystère, vers ce « seeing something that was always hidden ».
À cette femme brune, l’ombre, s’oppose la femme blonde, la lumière, Sandy, un nom qui m’inspire des grains de poussière suspendus dans un rayon de soleil, avec cette scène : c’est le lendemain de la première rencontre de Jeffrey avec Dorothy, Jeffrey a eu des cauchemars habités par Frank, il a les larmes aux yeux. Ils sont dans la voiture de Sandy, devant une église, la lumière traverse les vitraux et la musique d’orgue se mêle au chant des grillons. Une musique qui accompagnera leurs paroles comme celles d’une confession à la prêtresse, une musique qui élève les mots et les habille de lumière. La lumière émane de Sandy, de sa blondeur, de ses épaules dénudées et de sa robe du bleu des Cieux. C’est une ambiance sacrée que sa présence à elle seule suffit à créer, une ambiance dont la lumière, l’orgue et les vitraux ne sont que des émanations. Que se disent-ils alors ? Le voit-elle seulement, qu’il n’est plus lui-même ? Il révèle toute l’intrigue, mais il ne dit pas comment il sait, il ne parle pas de ce qu’il a vu, de ce qu’il a fait. Il semble tout confesser, mais il ne dit pas l’essentiel, il ne dit pas la cause de ses larmes. Lorsqu’il dit « It is a strange world », il dit en réalité qu’il vit lui-même à présent dans ce monde étrange. Lorsqu’il dit « Frank is a dangerous man », il dit en réalité qu’une part de Frank s’est immiscée en lui. C’est un cri à l’aide plein de larmes qu’elle entend lorsqu’elle répète « It is a strange world ». Elle lui répond qu’elle a eu un rêve, elle aussi, un rêve dans lequel le monde était dans les ténèbres, car il n’y avait pas de rouges-gorges, mais les rouges-gorges arrivèrent, nombreux, émanant l’amour et la lumière sur ce strange world. Des rouges-gorges d’amour et de lumière, « the only thing that would make a difference, and it did ». Jeffrey la contemple, pleine de lumière et de grâce, il ne pleure plus, il sourit, « You are a neat girl, Sandy ».
Mais les rouges-gorges ne sont pas encore là, le monde est toujours dans les ténèbres et bientôt Jeffrey incarnera Frank. Dans Blue Velvet, c’est lui, l’homme, qui navigue entre l’ombre et la lumière qui se côtoient à travers lui, mais la lumière peine à pénétrer les ténèbres. L’ombre de Blue Velvet est une ombre dont il n’y a rien à garder. Blue Velvet est la défaite de la femme brune, lorsqu’elle apparaît nue devant la femme blonde, très littéralement nue, à la lumière froide qui jette des ombres moches sur son corps décharné, sur ses seins pendants. Puis elle, Dorothy, la femme sombre, les quitte sur une civière, une ambulance s’éloigne dans la nuit, loin, très loin, avec les mauvais souvenirs. La fin de Blue Velvet clame le triomphe de la femme de lumière, par la profanation de la femme sombre. Elle ne devait pas être vue nue à la pleine lumière, hors de son cadre liturgique, et comme Mélusine elle nous punira de son absence, c’est une part d’elle qui nous manquera à tout jamais, comme elle manquera au bonheur béat d’une famille pavillonnaire qui clôt le film.
Trois incarnations modernes
Blue Velvet
Dans La Dolce Vita, réalisé en 1960 par Federico Fellini, Marcello voit Silvia pour la première fois descendant des cieux, ou plutôt descendant deux fois des cieux, puisqu’elle remonte dans l’avion pour redescendre la rampe vers le tarmac, pour refaire sa sortie, pour que les paparazzi la photographient encore, elle, la Madone. D’ailleurs, comment être certain que celle qui redescend est celle qui est apparue la première fois, qu’elle n’est pas une substitution, le reflet d’en bas de sa jumelle céleste ?
Marcello la revoit à la conférence de presse, elle est la diva, telle Marilyn Monroe elle nous invite à l’imaginer sous un voile de sens « I only sleep in two drops of French perfume ». Marcello la suit au Vatican dans l’ascension de Saint-Pierre, dans l’escalier sous la coupole. Il est essoufflé, elle est inépuisable. Elle porte cette longue robe noire, ce chapeau aux bords droits et ce col blanc, comme volés aux prêtres, la robe qui lui appartient, prêtresse d’un culte oublié. Le mot de Paparazzo, essoufflé dans l’encadrement de la fenêtre : « E quella è un ascensore, sai… » (« elle est un vrai ascenseur, tu sais… ») raisonne autrement dans l’idée de l’Assomption de la Vierge. Silvia invite Marcello à la suivre : « come on », la coupole se courbe plus encore, les cloches sont lancées à pleine volée, alors qu’apparaît un escalier vers une porte de lumière. Sur le balcon elle ôte les lunettes noires de Marcello avant que son chapeau s’envole dans le vertige, laissant flotter sa belle chevelure dans des éclats de rire. La Déesse est née.
C’est sous terre que Marcello la suit, sur la piste de danse, dans ce corps à corps accepté, il tente de l’embrasser. Elle l'évite habilement et il lui dit ces mots qui dépassent l’amour, des mots qui remontent à l’Hymne à Isis :
« Tu sei tutto, lo sai che tu sei tutto, everything. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione, sei la madre, la sorella, l’amante, l’amica, l’angelo, il diavolo, la terra, la casa… ah, ecco che cosa sei, la casa… » (« Tu es tout, sais-tu que tu es tout ? Everything. Tu es la première femme du premier jour de la création, tu es la mère, la sœur, l’amante, l’amie, l’ange, le diable, la terre, la demeure, ah voilà ce que tu es, la demeure… »)
Marcello est interrompu par l’arrivée de Franky Stout, une vieille connaissance de Silvia. Il ne lui manque que les cornes du satyre. Franky la capture et révèle une autre facette de Silvia, endiablée. Après la ronde à travers les combes, le mari de Silvia lui fait de vilains reproches et elle s’enfuit. Marcello court à sa poursuite, ses escarpins à la main. Il la convainc de monter dans sa voiture. Ils arrivent au bord d’un champ et lorsqu’il va l’embrasser, un hurlement venu du lointain l’interrompt. Silvia descend dans la nuit, à son tour elle hurle comme une louve et les hurlements lui répondent, de plus en plus proches. Elle est la louve de Rome, la mère tout entière d’ombre et de lumière. Marcello la tire par la manche, elle sort de sa transe et ils s’enfuient. La voiture va à folle allure jusqu’au quartier de la fontaine de Trevi et là, dans les rues désertes, Marcello cherche du lait. Silvia a recueilli un chaton blanc qu’elle porte sur sa tête, elle est tout en blancheur, une fourrure sur les épaules. Candide, elle suit dans les ruelles l’écho grandissant de la fontaine.
Elle entre dans l’eau, c’est cette scène si célèbre que nous croyons la connaître, qu’il ne reste rien à comprendre. Mais revoyez-la. Elle l’invite et il hésite, il n’hésite pas à entrer habillé dans l’eau, à se tremper pour elle, il hésite car le bord de la fontaine délimite l’enclos du sacré, car cette eau est bien plus sainte que ce qu’il a pu approcher dans les églises. Voilà ce qu’il dit au moment où il se décide à la rejoindre :
« Sì, Silvia, vengo anch’io, vengo anch’io ! Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto, stiamo sbagliando tutti. Silvia, ma chi sei tu ? » (« Oui, Silvia, je viens aussi, je viens aussi. Mais oui, elle a raison, je fais tout de travers, nous faisons tous tout de travers. »).
Marcello prend conscience qu’elle est la femme divine, révélée comme une étoile à la nuit. Il va à elle car c’est ce qui est juste et bon. Il saisit cette totalité qui le dépasse et lorsqu’il arrive à elle, il n’ose l’embrasser, il n’ose la toucher, des mains il caresse son aura. « Chi sei ? » (« Qui es-tu ? »). Il n’y a pas de mot à la hauteur de ce « qui ? ». Elle verse quelques gouttes d’eau sur la tête de Marcello. En prêtresse elle le baptise, lui qui pénètre entier dans la dimension, la pleine dimension de la femme divine. Ce qui suit, nous l’ignorons. S’en souviennent-ils seulement ? Elle lui dit « Ascolta » (« Écoute »), le ruissellement cesse et le plein jour paraît, un jeune homme à vélo les regarde. Qu’a-t-il vu ? De quel ailleurs surgissent-ils à cet instant ?
La suite est une descente en enfer, le mari jaloux qui gifle Silvia et qui frappe Marcello. Dans le village les enfants disent avoir été témoins d’une apparition de la Vierge, tout n’est que fanatisme et bigoterie. Suivent ces mots de Steiner qui annoncent le véritable enfer, tel que je souffre à me le remémorer, celui qui précède la scène où Marcello éloignera Paparazzo pour accueillir la femme de Steiner, elle qui ne sait pas encore. C’est d’abord sur le balcon, à l’écart de la réception, des invités de marque, de la lecture de poésies, des divans et du champagne :
« Non credere che la salvezza sia chiudersi in casa, non fare come me, Marcello. Io sono troppo serio per essere un dilettante, ma non abbastanza per diventare un professionista. Ecco. È meglio la vita di un miserabile – credimi - che l’esistenza protetta di una società organizzata, in cu tutto sia previsto, tutto sia perfetto. Marcello, io posso soltanto esserti amico, e quindi mi è impossibile consigliarti. »
(« Ne crois pas que la sécurité soit de s’enfermer dans une maison, ne fais pas comme moi, Marcello. Je suis trop sérieux pour être un amateur, mais pas assez pour devenir un professionnel. Voilà. Il vaut mieux vivre une vie de misérable, crois-moi, qu’une existence protégée par une société organisée, dans laquelle tout est prévu, écrit, tout est parfait. Marcello, je peux seulement être ton ami, et il m’est donc impossible de te conseiller. »)
Cet enfer qu’annoncent les mots de Steiner dans ce lieu terriblement prémonitoire, à la fenêtre de la chambre de ses enfants :
« Qualche volta, la notte, quest’oscurità, questo silenzio mi pesa. È la pace che mi fa paura, temo la pace più di ogni altra cosa. Mi sembra che sia soltanto un’apparenza, e che la sconta l’inferno. Pensa cosa vedranno i miei figli domani : « Il mondo sarà meraviglioso », dicono. Ma da che punto di vista, se basta uno squillo di telefono ad annunciare la fine di tutto ? Bisognerebbe vivere fuori dalle passioni, oltre i sentimenti, nell’armonia che c’è nell’opera d’arte riuscita, in quell’ordine incantato. Dovremmo riuscire ad amarci tanto da vivere fuori dal tempo, distaccati, distaccati… »
(« Parfois, la nuit, cette obscurité, ce silence me dérangent. C’est la paix qui me fait peur, je crains la paix plus que tout au monde. Il me semble qu’il s’agit d’une simple apparence, et que l’enfer l’apaise. Pense à ce que mes enfants verront demain, « Le monde sera merveilleux », dit-on. Mais de quel point de vue si la sonnerie d’un téléphone suffit à annoncer la fin de tout ? Il faudrait vivre hors des passions, au-delà des sentiments, dans l’harmonie qui demeure dans l’œuvre d’art réussie, dans son ordre enchanté. On devrait arriver à s’aimer au point de vivre hors du temps, détachés, détachés. »)
Comment expliquer le futur geste de Steiner, le meurtre de ses enfants avant son suicide ? Je ne m’en remettrai pas. C’est peut-être ce qu’évoque Von Franz dans La femme dans les contes de fées : « La règle collective prend la place de l’instinct. Ces personnes ont souvent conscience d’avoir en elles une zone morte, maudite. Et la recherche inquiète se poursuit, comme si le diable s’agitait à l’arrière-plan sans vouloir les laisser en paix. », c’est le mal-être d’un homme aux mains d’argent.
Trois incarnations modernes
La Dolce Vita
« Were you there with me ? » demande Spike à Buffy, au dernier épisode de la série Buffy the vampire slayer, réalisé en 2003 par Marita Grabiak pour l'œuvre de Joss Wheddon. Ce « Were you there with me ? »nousdit tout du lieu ineffable où Spike et Buffy passèrent la nuit, dans les bras l’un de l’autre, sur des draps de soie bleue et des coussins brodés d’Orient. Spike a retrouvé Buffy dans une maison abandonnée, abandonnée comme la ville entière de l’éternel soleil de Sunnydale. Soudain, la ville s’est souvenue d’années inexplicables, de monstres et de morts, ici, juste au-dessus de la bouche de l’enfer. Ils ont pressenti l’apocalypse et ils ont fui. Buffy est restée, quitte à en mourir, ce ne serait que la troisième fois, mais certainement la vraie. Buffy chassée de chez elle par sa sœur, arrivée des ténèbres avec tous ses souvenirs, par Giles, le mentor, par Willow, la sorcière, incarnation récente de Khali et bientôt Reine des Cieux, et par Xander, the angle guy de la saison 1, à présent borgne, incapable de saisir le sens de tout cela.
Buffy est abandonnée et elle doute, par sa faute des filles sont mortes. Spike relativise, « casualties of war ». Il lui fait le meilleur des motivational speech et finit ainsi « You are unattainable ». Elle est l’inaccessible, l’intouchable, marquée par le sceau divin. Spike nous parle de l’aura de la femme divine, qui rappelle ce geste de Marcello caressant la silhouette de Silvia dans la fontaine. Buffy qui ne leur en veut même pas, à ceux qui l’ont abandonnée. Elle souhaite leur réussite contre le mal, Buffy la miséricordieuse, Buffy la sauveuse, Buffy the slayer. Buffy figure la justice au féminin, contre les créatures nocturnes, mais surtout contre les maîtres, les mauvais maires, les mauvais prêtres, ces puissants, cette réalité du mal faite de lois et d’autorité. Contre ces démons patriarcaux, ces ennemis de la liberté, Buffy défend toutes les victimes et jamais des sept saisons elle ne cèdera aux tentations du pouvoir. Buffy restera Buffy, sensible jusqu’aux larmes.
C’est donc Buffy et Spike qui créent cette nuit l’ailleurs ineffable. Spike dont il serait trop long de décrire les mille et une volte-face, Spike qui, dans la saison précédente, lorsque Buffy est rappelée du paradis sur cette terre qu’elle qualifie en ces termes : « Everything here is hard, bright, and violent. Everything I feel, everything I touch, this is Hell », a donné à Buffy ce dont elle avait besoin, les ténèbres, des nuits d’ébats dans les décombres, faire que cet enfer soit un enfer de plaisir. Spike qui après s'être battu pour retrouver son âme, se laisse aller à mordre à nouveau, tenté par la soif du sang, et en sera puni, entraîné par le poids de son âme dans les profondeurs d'une effroyable folie. Buffy lui pardonnera ses crimes, elle lui pardonnera le pire, le viol, ou presque. Elle le sauvera de la torture des remords et dans un final grandiose, elle dévoilera à Spike son âme dans un déferlement de lumière et de flammes.
Avant, il y a eu cette nuit où Spike retrouve Buffy abandonnée. Alors ce n’est ni ombre ni lumière, c’est le réconfort d’une union qui ne parle plus d’amour. C’est la compréhension au plus haut degré des âmes, l’harmonie, la paix et le repos.Chacun initie l’autre, Spike conduit Buffy aux tréfonds de l’ombre et Buffy élève Spike à la lumière. Dans cette initiation de Spike, Buffy se révèle, elle se sublime, et c’est ensemble, par le rétablissement du déséquilibre, par la liturgie de la femme divine, dans cet ailleurs, ce dépassement du miroir, dont ils se souviendront tous les deux. Cet ailleurs était un baiser de l’Éternel, la réponse de l’équilibre divin, au-delà de ce que nommera la langue de Babel. Regardez et vous saurez, mais pour cela il ne faut pas regarder la scène, ni l’épisode, il faut regarder Buffy tout entier. Alors vous ressentirez ce lieu que seuls Buffy et Spike pouvaient créer, cette nuit, eux et là, une porte vers le divin qu’ils franchissent ensemble. Cet ailleurs qui m’arrache chaque fois des larmes et que je ne cesse d’écrire « Where you there with me ? ». Comme dans Blue Velvet et La Dolce Vita, l’essentiel est ineffable, comme ce « seeing something that was always hidden » ou ce « Chi sei ? ».
Trois incarnations modernes
Buffy contre les vampires - La fin des temps
En occitan, amour courtois se disait fin’amor. Jean Markale [46] propose trois lectures de ce fin’ : fin' de finesse ; fin' d’un amour poussé jusqu’à sa fin, ses plus extrêmes limites ; fin' d’un amour qui a une fin, un sens, qui conduit « quelque part ». En oubliant le fin’amor, nous ne gardons mémoire que du courtois, ce « qui parle, agit avec une politesse raffinée, avec un grand désir de ne pas déplaire à autrui » [47]. Les scolastiques nous conseillent de lire le Traité de l’amour courtois (De arte honeste amandi), écrit en 1184 par André Le Chapelain. Un traité qui posa les jalons du code courtois, gravant dans le marbre les vertus du service d’amour : être généreux, sincère, aimable, ne pas médire, garder l’amour secret, ne prendre qu’un confident de cet amour, être fidèle à sa dame, ne pas détourner l’amie d’un autre amant, courtiser une dame de noblesse supérieure, courtiser une dame « susceptible de le grandir lui-même en encourageant son action et sa prouesse », être attentif aux commandements de sa dame, et ne pas outrepasser ses désirs. L’essentiel est là. Il y a la courtoisie à laquelle s’ajoutent le secret, la confidence, une dame de rang supérieur, une dame qui fait grandir son courtisan, une dame qui le commande et avec qui il jouira selon son désir à elle. Mais pour appréhender le véritable amour courtois, nous disposons de meilleures sources qu’un traité avec ses alinéas de Code pénal, c'est le chant des troubadours, témoin direct de cœurs brûlant du fin'amor. [48] L'autre source, on ne pourrait en trouver plus intime, est celle du sentiment amoureux dont il vous souviendra sans effort.
Le service d'amour
« Quand je crois penser à autre chose
à votre sujet j’ai un message courtois
mon cœur qui est là-bas votre hôte
vient de votre part ici en messager
il me parle, il me rappelle et me remet en mémoire
votre noble corps gracieux et plaisant
votre belle chevelure dorée
et votre front plus blanc que lis
vos yeux vair et rieurs
et ce nez qui est droit et bien seyant
le teint frais de votre visage
blanc et plus vermeil que fleurs
cette petite bouche, ces belles dents
plus éclatantes que fin argent
et le menton et la gorge et votre poitrine
blanche comme neige et fleurs d’aubépine
vos belles mains blanches
aux doigts fins et lisses
et vos belles manières
où il n’y a rien à reprocher
et vos réparties plaisantes et fines
votre charmante conversation et vos francs propos
et le beau sourire que vous me fîtes la première fois
quand le hasard nous fit nous rencontrer… »
Arnaut de Marolh
L’on penserait qu’elle est là, comme le modèle devant le peintre, pourtant c’est bien de mémoire qu’Arnault de Marohl nous la décrit. D’une mémoire bien particulière, d’une image qui se projette dans son cœur, qu’il le souhaite ou non, quoi qu’il fasse. Elle est la plus belle et la plus charmante des femmes qu’il ait rencontrée. Ce n’est en fait qu’un sourire, ils ne se connaissent pas, ou à peine. Déjà le troubadour est emporté, il n’y a pas de hasard, il a saisi en un clin d’œil toute l’étendue de la beauté. Par ce sourire, peut-être anodin, elle lui fit la plus officielle des invitations à la courtiser. Voici lancé l’élan du service d’amour, voici que se mettent en place toutes les pensées et tous les gestes du courtisan envers sa dame. A-t-il seulement lu le code courtois ? Ce que le troubadour chante est la sève, l’élan vital, l’authenticité première de l’amour. L’essentiel ne figure pas dans le code, c'est le cœur qui dicte les idées et les gestes les plus nobles. Il suffit au troubadour de regarder au-dehors pour y voir la projection de son âme.
« Tout le bien que je dis, je le tiens d’elle.
Pour toute chose je ne pense ni ne rêve
je n’ai ni désir ni envie
excepté pour elle pourvu que je puisse la servir
et faire tout ce qui lui est bien et qui lui plaît
car je ne crois pas que je sois fait pour autre chose
que de faire pour elle ce qui lui plaît
parce que je sais bien que m’en arrivent honneurs et biens
quand je fais tout pour l’amour d’elle. »
Peire Rogier
Le courtisan se soumet aux désirs de sa dame, voici la lecture courtoise de « Mon seul désir ». Il se fie à elle et la laisse vouloir à sa place, car il sait que selon le désir de sa dame, il aura « honneurs et biens ». Une confiance qui demande humilité et patience, le désir de sa dame contrôlera le sien, quoi qu’il lui en coûte. C’est selon la pleine acceptation de cette voie initiatique du service d’amour que le courtisan se révélera, que sa dame l’élèvera à sa noblesse. C’est dans le service des désirs de sa dame que ses pensées et ses actions trouveront leur expression la plus noble. Et s’il ne faillit pas dans son service d’amour, s’il se montre fidèle à sa dame et à ses engagements, il recevra la plus haute des récompenses : elle l’aimera en retour.
« Et la dame qui s’y entend en haut mérite
doit bien placer son savoir
en un preux chevalier vaillant
puis, si elle reconnaît son courage
qu’elle ose l’aimer devant tous
car à une dame aimant au grand jour
les preux et les (chevaliers) avenants
ne lui diront que compliments.
Car j’en ai choisi un valeureux et noble
par qui mérite s’améliore et s’affine
il est généreux, adroit et cultivé
plein de bon sens et de connaissance
je le prie d’avoir confiance en moi
et que nul ne puisse lui faire croire
que moi je commette envers lui une faute
si seulement je ne trouve en lui de défaillance. »
La Comtesse de Dia
Ce chant est des plus précieux, pour une fois la dame s’exprime, elle complète la trame courtoise par le point de vue de l’aimée. Tout commence ainsi : un homme aime une dame qui lui est de rang supérieur, souvent aussi, elle est mariée. Elle lui est inaccessible et elle ne pourrait s’abaisser à l’aimer en retour, elle peut cependant « bien placer son savoir en un preux chevalier vaillant ». Il l’aime cependant. Il est pris d’un amour qui le déborde. Il n’a d’yeux que pour elle, son corps entier ne vibre que pour elle, il n’a plus d’autre envie qu’elle. C’est le plus naturellement et selon ce que lui indique son cœur qu’il entre en service d’amour. Il cherchera sincèrement les vertus courtoises, il sera fidèle, humble, généreux, respectueux, dévoué. Peut-être un jour sa dame le remarquera-t-elle. Elle le soumettra à son désir, elle éprouvera sa patience, parmi d’autres prétendants. Un jour peut-être sera-t-il son amant. Elle promettra de lui être fidèle en amour, de ne pas se lier à d’autres, mais rien ne sera acquis, l’amour restera secret. Souvent ce sera un amour adultère, la dame restera auprès de son époux, le prétendant redoublant de prouesses. Alors, si un jour elle reconnaît que le service d’amour l'a suffisamment élevé en noblesse, elle l’aimera à la vue de tous. Le mérite qu’il aura acquis, sa noblesse en chevalerie d’amour, c’est à elle qu’il les devra. Et c’est à elle qu’il les vouera, éternellement dévoué à sa dame. Le service d’amour est une initiation dont la dame dessine à mesure les épreuves. L’influence spirituelle de la dame grandit doucement au feu de l’amour avant de les recouvrir tous deux de son voile. Peu à peu, de fantasmé le couple se révèle lorsque l’amour en retour embrase le cœur de la dame. Elle l’élèvera en noblesse et lui restera fidèlement tourné vers elle, il ne cessera de la servir.
Aimer en secret, sans amour en retour
« Hélas ! d’amour je n’ai conquis
que souci et chagrin
et rien n’arrive si difficilement
que ce qu’on va désirant
et rien ne me fait plus envie
que ce qu’on ne peut avoir.
(…)
Je ne meurs ni vis ni guéris
et je ne ressens pas le mal, bien qu’il me soit grand
car de son amour je ne suis pas devin
et je ne sais pas si je l’aurai ni quand.
Qu’en elle soit toute la merci
qui peut me relever ou me rabaisser.
Il me plaît quand elle me rend fou
me fait muser et béer
il me plaît qu’elle se moque de moi
et me raille par derrière ou par devant
car après le mal m’en viendra du bien peut-être, si ça lui fait plaisir. »
Cercamon
Tout est ambigu. Son amour est si précieux qu’il n’ose le révéler à sa dame et il se plaint qu’elle l’ignore. Il n’ose l’approcher et il s’agace de la solitude. Il se soumet à toutes les contritions au nom de l’amour de sa dame, et il lui reproche de le torturer. Il y a indéniablement du masochisme, porté fièrement comme une ascèse, un service d’amour, un culte dédié à sa dame. Il y a dans cette souffrance si réelle, si habitée, une magie opératoire de l’être aimé à ses côtés, qui la fait agir, puisqu’elle le fait souffrir. Ainsi, par une falsification de la pensée, ressent-il réellement la présence et le vouloir de l’absente. Il élève au plus haut l’image de sa dame, vaillant qu’il est sous le poids de l’idole. Il l’aime car son salut en dépend. Il espère. Quoi qu’elle fasse, il continuera. Rien ne viendra ébranler son désir d’amour puisqu’il doit aimer malgré tout, malgré elle s’il le faut. Rien ne fera cesser sa liturgie intérieure, à prier le miracle d’un amour en retour.
Nous entendons aussi un jeune homme balbutiant, incapable de dévoiler ses sentiments à celle qu’il aime. Il garde son amour secret par crainte de ne pas être aimé en retour, par crainte de ne pas trouver les mots qui diraient l’entièreté de son sentiment, par crainte aussi que le réel, la dame vivante, pensante et agissante, détruise l’icône érigée en son nom.
La discordance entre l’amour, synonyme de joie et d’allégresse, et la souffrance du secret, la terrible solitude du silence, sans amour en retour, conduit à la folie. À chaque entrevue, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, il espère, de plus en plus. Le moindre geste de sa dame vient alimenter son délire. Elle ignore son amour et pourtant elle se jouerait de lui. D’un clignement de cils, elle peut signifier, par le jeu d’interprétations maladives, aussi bien le salut divin que la damnation éternelle. Et rien ne viendra ébranler son désir d’amour, rien ne viendra ébranler son délire.
« Je m’étonne comment je peux supporter si longtemps
de ne pas lui révéler mon désir (sentiment).
Quand je vois ma dame et la regarde
ses beaux yeux lui vont si bien
à peine puis-je m’abstenir de courir vers elle
et je le ferais, ne serait la peur
car jamais je vis corps mieux taillé et peint
au besoin de l’amour si lourd et tard.
J’aime tant ma dame et la chéris tant
et la crains tant et la courtise tant
que jamais je n’ai osé lui parler de moi
et je ne lui demande rien et je ne lui mande rien
pourtant elle connaît mon mal et ma douleur
et quand cela lui plaît elle me fait du bien et m’honore
et quand cela lui plaît je me contente de moins
afin qu’elle n’en reçoive aucun blâme. »
Bernard de Ventadour
J’ai lu une centaine de chants semblables, les mêmes mots, les mêmes sentiments. Ce n’est pas que les troubadours se soient mis d’accord ou qu’ils aient lu un code commun, qui d’ailleurs n’était pas encore écrit. La raison de ces ressemblances est qu’il y a là l’authenticité d’une constante humaine, d’une constante intérieure, comme il y a une constance dans l’expression de la folie, avec ce que l'on qualifierait aujourd'hui de délire érotomane. L’amour courtois est un amour fou, le prétendant est inaccessible à toute critique, où il est absolument certain de connaître, de partager, de savoir décrypter, les pensées intimes de sa dame. Elle ignore l’amour qu’il a pour elle, pourtant elle répond à son amour et elle le commande en retour. Cet amour qui l’habite et l’obsède chaque jour, cet amour qui est ce qu’il a vécu de plus grand, ne peut être une vue de son esprit. Il faut que ce soit vrai. Il délire, il interprète, car il faut que tout ceci ait un sens. Le moindre geste de sa dame vient alimenter le délire qui ne fait que croître. C’est un amour qui dans un cœur orgueilleux conduit à la haine, ainsi Ventadour conclura son chant par une réprimande contre celle qui attise son désir :
« Ah ! comme il y paraît peu, quand on la voit
qu’elle laisse mourir sans secours
ce pauvre malheureux plein de désir
qui sans elle n’aura jamais le bonheur. »
Mais d’autres, humbles, de réelle noblesse de cœur, dévoués au désir de leur dame, se soumettent aux exigences de cette folie. Ils se complaisent sciemment dans l’illusion et le fantasme. C’est ainsi qu’ils tiennent dans la souffrance et la solitude, jusqu’à ce que leur dame leur fasse, peut-être, un réel signe d’amour en retour :
« C’est folie et légèreté
car malgré vos ordres
je vous aime et néanmoins contre nul (bon) sens
je ne changerais ma folie. »
Bérenguier de Palazol
Quelle meilleure définition de l’humilité ? Voyez comme le code courtois n’est que vaines paroles en comparaison à ce que nous enseignent les chants des troubadours. Rester humble et courtois dans la folie de l’amour, voici des vertus que le prétendant acquiert par le service de sa dame, son initiatrice en chevalerie d’amour. Chaque vertu courtoise va ainsi, le mot est bien en dessous de la réalité du sentiment du fin’amor. Je vous laisse en juger par la définition de la fidélité, du même Bérenguier de Palazol :
« Madame, si je vivais éternellement
toujours je vous serais fidèle.
Étrangement il me plaît de vous aimer,
quelque dommage que j’en puisse avoir
destiné ou à venir. »
L’amour de loin
« Bien me paraîtra la joie quand je lui demanderai
pour l’amour de Dieu, l’auberge de loin
et s’il lui plaît, je logerai près d’elle,
tout près, bien que je sois loin
car ainsi l’entretien sera délicat
quand l’amant de loin sera si proche
qu’avec l’esprit courtois il pourra jouir du plaisir.
(…)
Jamais je ne m’endormais si doucement
que mon esprit ne fût là-bas
avec la belle qui possède mon cœur
où mes désirs vont sur le droit chemin
et il (l’amour) peut bien dire s’il me tue, moi qui l’aime
que jamais il n’aura quelqu’un de si fidèle. »
Jaufré Rudel
Nous avons pressenti la sacralisation de la dame dans la soumission à son seul désir et dans la folie d’amour, mais c’est ici, je pense, que la dame courtoise est véritablement divinisée, c’est dans l’amor de long, l’amour de loin. Comble de l’égoïsme ? La dame telle qu’elle pense et palpite est en effet presque ignorée. Amour de loin qui se pense amour de près. Un amour de loin qui ne voit pas l’incohérence et qui se fait réponse à lui-même, dans les échos de son esprit.
Elle l’a déjà invité, implicitement, par ce bref regard qui signifiait pour lui la plus solennelle des invitations à la courtiser. Cet amour de loin n’est pas une souffrance de la distance de l’aimée, au contraire, il est un plaisir de se sentir tout proche. Le fantasme exauce le désir et l’amour de la dame devient l’amour de l’amour. Il a érigé une idole dans son cœur, et c'est par l'orthodoxie de ses prières qu'il prétend à la vertu courtoise. Toujours au service de sa dame, le prétendant vit dans sa pensée constante et, le temps de l’amour de loin, il passe d’un service d’amour à un service de l’amour. Il faut en passer par là pour grandir en mérite. Et l’amour de près, qu’ils se croisent brièvement ou qu’ils se retrouvent sous le lierre le temps venu de l’amour en retour, sera une rencontre transcendante de la dame et de l’idole.
« Belle dame, courtoise, accomplie
pleine de sens, sans blâme et sans folie
bien que je ne vous voie pas aussi souvent que je le voudrais
ma pensée (mon imagination) allège mes tourments
grâce à elle je me réjouis, me repose et me rétablis
et puisque je ne peux vous voir de mes yeux
je vous vois sans cesse, nuit et jour, dans ma pensée. »
Bérenguier de Palazol
C’est une belle vision que nous offrent les yeux de l’âme. Voici comment l’amour courtois éloigne le prétendant de la réalité de la dame aimée. Comment peut-il si peu se soucier du bien-être de sa dame, de ses plaisirs, de son bonheur ? Je comprends qu’on crie à la misogynie. Il pourrait se satisfaire d'un amour de l’amour. La menace du prétendant, son risque sur la quête courtoise, est celui de tout mystique, de chacune et chacun à la quête de la rencontre : l'égo. À celui qui aimera véritablement sa dame comme il aimerait Dieu, qui la contemplera de la contemplation véritable, telle que son existence réelle, tiendra du miracle, telle que sa personne véritable sera auréolée de la magie du miracle de Vue.
Éloignons-nous des troubadours pour rencontrer, en 1295, Marguerite Porète. Dans le Miroir des âmes simples et anéanties, elle nous parle d’un amour né d’une simple image, qui débordera le cœur du prétendant. Ainsi en est-il du prétendant qui aime sa dame de mémoire. Ainsi en est-il du croyant qui aime Dieu avant de l'avoir rencontré. Le prétendant courtois est comme le mystique devant Dieu, avec dans le texte qui suit des élans de nostalgie du Royaume, des élans d’Hymne au féminin [49]:
« Maintenant, comprenez avec humilité un exemple simple, emprunté à l’amour mondain, et appliquez-le pareillement à l’amour divin :
Il y eut autrefois une demoiselle, fille de roi, au grand et noble cœur, au noble courage aussi, et elle demeurait en un pays étranger. Or il advint que cette demoiselle entendit parler de la grande courtoisie et de la grande noblesse du roi Alexandre, et aussitôt sa volonté l’aima pour son grand renom de gentilhomme. Mais elle demeurait si loin de ce grand seigneur en qui elle avait mis son amour, qu’elle ne pouvait ni le voir ni l’avoir, et elle en était souvent désolée en elle-même, car aucun amour autre que celui-ci ne la satisfaisait. Lorsqu’elle vit que cet amour lointain, tout en étant si proche en elle, était si loin au-dehors, cette demoiselle pensa consoler son chagrin en imaginant quelque figure du bien-aimé dont son cœur était souvent blessé. Aussi fit-elle peindre une image à la ressemblance du roi qu’elle aimait, la plus proche possible de ce qu’elle s’en représentait en son amour, et selon l’affection de l’amour qui l’envahissait ; et grâce à cette image et par d’autres artifices, elle songea au roi lui-même.
L’âme qui fit écrire ce livre : Mais oui, vraiment ! C’est bien là ce que je veux dire : j’ai entendu parler d’un roi de grande puissance, qui était en courtoisie, en très grande courtoisie de noblesse et largesse, un noble Alexandre. Mais il était si loin de moi, et moi j’étais si loin de lui, que je ne pouvais trouver de réconfort en moi-même ; et pour que je me souvienne de lui, il me donna ce livre qui représente en quelque manière son amour. Mais bien que j’aie son image, je n’en suis pas moins en pays étranger, éloignée du palais où demeurent les très nobles amis de ce seigneur, eux qui sont tout à fait purs, raffinés et affranchis grâce aux dons du roi avec lequel ils demeurent.”
Il n’y a en effet qu’un pas de l’amour courtois à la mystique, mais ce serait trahir les troubadours que de clore ainsi. N’oublions pas la source de l’amour, la raison de toutes les prouesses et de la sincère dévotion : la femme, digne de contemplation, qui détourne le courtisan du chemin de l’église et de l’idéal du mariage :
« Je m’étais bien promis
de détourner mon cœur de vous,
mais quand je vois votre beauté
ce beau corps frais et lisse
élancé, svelte, le plus gracieux
qu’on puisse voir
le mieux façonné
tout mon cœur change
de telle sorte, qu’il ne se séparerait de vous
pour nulle autre affaire. »
Bérenguier de Palazol
De la subversion de l’amour courtois
« Ainsi va-t-il de notre amour
comme de la branche d’aubépine
qui la nuit sur l’arbuste tremble
à la pluie et au gel
jusqu’à ce que le lendemain le soleil se répande
dans les feuilles vertes sur le rameau.
Il me souvient encore d’un matin
où nous avons mis fin à la guerre
où elle m’a accordé un don si grand
son amour charnel et son anneau
que Dieu me laisse encore vivre assez
pour que j’aie mes mains sous son manteau. »
Guilhem de Peiteus
Voici, presque pour finir, le chant du premier des troubadours, Guilhem de Peiteus (1071 - 1126), de son nom royal Guillaume IX d’Aquitaine, grand-père d’Aliénor d’Aquitaine. Guillaume II nous présente son amour sous une forme autonome. Les images du jour et de la nuit, de l’hiver et du printemps, nous disent que son amour vit de lui-même, au gré des saisons, plaisir ou douleur, même loin de l’aimée. Le roi délaisse ses richesses, du moins le temps d’un chant, pour se changer en cette branche d’aubépine, tout tremblant dans l’attente de son aimée. Roi et pourtant soumis à l’amour, au désir, à l’inatteignable, à l’interdit qui impose le secret. C’est un anneau adultère qu’il convoite, celui de Dangereuse de L’Isle Bouchard, à qui s’adresse ce chant. Il a été à la guerre pensant sans cesse à elle, comme l’aubépine la nuit couverte de givre. À son retour, Dangereuse lui accorde son amour charnel et leurs cœurs s’embrasent ensemble. Cette union interdite leur coûtera l’excommunion, un prix qu’ils n'hésiteront pas à payer, comme le montre cette célèbre réplique de Guillaume IX à l’évêque chauve : « Tu passeras un peigne dans tes cheveux avant que je renonce à celle que j’aime ». De retour de croisade, c’est en sa dame que Guillaume trouva son Graal par ce simple geste : passer ses mains sous le manteau de Dangereuse. Le couple courtois, couple infernal selon le terme de Jean Markale, s’affranchit d’intermédiaire avec le sacré.
« Et si je vous parle de mon réconfort
ne tenez pas cela pour de l’orgueil
car je l’aime et la désire à un tel point
que si j’étais pressé par la mort
je ne demanderais pas à Dieu avec autant de force qu’il m’accueillît
là-haut dans son Paradis
comme je lui demanderais de me donner la permission
de dormir une nuit avec elle. »
Raimon Jordan
Raimon Jordan nous conduit en des terres singulières qui me rappellent la promesse de Clarimonde à Romuald : « je te ferai plus heureux que Dieu lui-même dans son paradis (...) Je t’emmènerai vers les îles inconnues ; tu dormiras sur mon sein, dans un lit d’or massif et sous un pavillon d’argent ; car je t’aime et je veux te prendre à ton Dieu. » Refuser le paradis pour l’amour de sa dame. Ce n’est pas contre un amour spirituel que le prétendant renonce au paradis, c’est contre l’amour charnel, « dormir une nuit avec elle ». Ne faire qu’un. Le lieu où l’amour courtois les conduit l’un et l’autre se situe au-delà du paradis. Voici le couple infernal, prométhéen, qui brise les chaînes de sa condition. Celui qui trouve mieux son salut dans l’accomplissement de l’amour à tous les niveaux de l’être, que dans l’espoir de la résurrection. Le couple prend ce qui lui revient, la dame se substitue à Dieu et les entraîne tous deux dans un au-delà de lumière.
La forme est prudente, ambiguë, l’on ne sait si c’est à Dieu ou si c’est à sa dame que Raimon Jordan demande d’exaucer son souhait. Ce n’est qu’une habile tournure du troubadour. Demande-t-on la permission de désobéir ?
L'amour courtois ou le couple infernal
L’amour courtois, au fond, est simplement l’amour. « Aimer », c’est un verbe que vous employez quotidiennement, vous aimez toutes sortes de choses. Mais souvenez-vous maintenant lorsque vous avez follement aimé. Souvenez-vous, vous étiez peut-être adolescent. Souvenez-vous de l’atmosphère surnaturelle qui entourait sa présence. Vous voilà seul, ou seule, et le souvenir de son visage resplendit en vous, sa silhouette s’anime et vous communique de plaisantes pensées. C’est une douce langueur qui augmente à la Lune. Elle (ou il) est d’évidence sans défaut, ses gestes sont guidés par la grâce, à l’instant présent elle doit songer à l’aube sur la rosée ou au frémissement des saules. Elle emplit vos pensées, constamment, elle est l’entière étendue de vos désirs. Vous désirez tant la voir, pourtant déjà vous êtes satisfait, elle est déjà avec vous, constamment, dans les mille reflets de votre âme. Pourtant, bien peu paraît au-dehors. Elle ne pourrait deviner les développements magnifiques qu’elle a suscités en vous, ce culte nouveau qui se crée en son nom. Vous seul savez. Peut-être qu’un confident vous viendrait en aide, ce serait le chant de l’oiseau ou le parfum d’avant la pluie. La nuit vous faites de folles prières, qui seules semblent capables d’influer sur le cours mystérieux des choses, seules capables de lui faire connaître votre amour si dévoué, si pur, qu’elle ne pourrait que vous aimer aussi.
Quand vient la rencontre tant attendue, le réel s’adapte à l’imaginaire. Une moue d’amusement devient une promesse. Si elle détourne le regard c’est parce qu’elle ne peut déjà vous révéler son début d’amour, qu’elle partage vos états intérieurs, vos états d’âme. Alors vous l’aimez plus encore, car elle se réserve, car elle appartient aux éléments supérieurs. Le moindre des détails de son doux visage, le moindre reflet de sa chevelure vous possèdent comme un charme. Son image, son parfum, l’éclat de sa voix, la grâce de ses gestes, vous reviennent inlassablement à l’esprit. Elle n’est plus là et pourtant elle demeure à vos côtés. Un instant vous pensez vous satisfaire du désir, de l’amour de l’amour, l’instant d’après vous souffrez au plus profond de vous de l’injustice de l’absence. Au lendemain d’une nuit où vous lui avez dédié chacun de vos rêves, chacune de vos pensées, vous n’avez qu’un souhait, la voir par le beau hasard, par le miracle appelé par vos prières. Le moindre signe de sa part vous assure qu’elle a compris, qu’elle a tout compris, elle qui sait par des dons mystérieux, elle qui perçoit les choses depuis son au-delà. Elle vous invite à l’aimer plus encore et alors un jour, peut-être, vous manifestera-t-elle son amour en retour.
Avez-vous connu ce délire d’amour ? Connaissez-vous l’effet qu’a une nuit de prière sur le cœur de l’aimée ? C’est de cet amour qu’est fait l’amour courtois, le fin’amor, le service d’amour. C’est l’amour d’une image, d’une icône, formée par le cœur du prétendant. Étrangement, cet amour apparemment si spirituel, si pur, garde au fond de lui le désir de la chair. Et là où vous avez placé votre amour, l’embrasser s’imagine comme une communion avec les sphères supérieures, et l’étreindre s’apparente à une fusion dans les dimensions divines. Dépasser cette cristallisation pour aller à elle, véritablement, et que dans l'enclos sacré s'accomplisse le rituel.
L’amour courtois n’est pas qu'amour de loin. Rappelons-nous Guillaume IX qui glisse ses mains sous le manteau de Dangereuse. Nous connaissons aussi Tristan et Iseut qui doivent avoir un rapport avant chaque Lune à défaut de quoi Tristan mourrait. Ils se parlent dès qu’ils le peuvent, ils s’étreignent, ils s’aiment, ce qui n’empêche pas l’amour déifiant d’opérer, ensemble ou séparés. L’amour courtois accorde le fantasme et le vécu. Et ce n’est pas le vécu qui affaiblit le fantasme, c’est le fantasme partagé qui redéfinit le vécu. C’est un couple absolu, faisant fi de tout ce qui l’entoure, un amour au-dessus de tout. C’est un amour qui aura recours à la malice, au mensonge et à la force pour se frayer un chemin dans ce labyrinthe. C’est un amour alimenté d'abord par un vin herbé, mais qui persistera une fois l’effet dissipé. Ce qu’il y aura de juste sera Iseut, ce qui méritera que Tristan tue sera Iseut, ce qui méritera qu’il meure sera Iseut. Iseut sera seule source de vie louable aux yeux de Tristan. Tristan songe sans cesse à Iseut, elle est reine de son cœur, elle est son icône. Et Iseut partage cet amour. Puis ils se retrouvent et à la dérobée, ils s’unissent, confondant le profane et le sacré dans l’amour.
La dame grandit dans le regard de son prétendant et, à un instant, elle se découvre non seulement aimée, mais divinisée. L’engagement courtois veut qu'elle incarne cette image, qu'elle incarne le fantasme, qu'elle incarne la femme divine, et conduise à sa fin la liturgie qui l’élève. Elle consentira alors à élever le prétendant à sa hauteur. Un rétablissement qui attirera sur lui le divin, ainsi que l’établit la hiérogamie du déséquilibre. C’est une intense liturgie érotico-mystique selon laquelle le prétendant n’outrepasse pas le désir de sa dame, son initiatrice. Alors intervient le reflet charnel, la moiteur, l’étreinte, les ébats et les tensions lentes de l’amour qui fixent l’instant dans l’éternité, parvenu au divin qui n’a ni nom, ni histoire, ni temps, lui tout proche qui s’efface sous notre vue, tel un envers de tapisserie.
Un couple infernal aux yeux du clergé, certes, mais divin au-delà, dans une alternative à notre histoire, par une remontée par la transcendance à l’Un, à la matrice primordiale, à l’envers du miroir ouvert, en fait, non par l’âme révélée, mais par la conjonction de deux âmes qui résout toutes les tensions, toutes les attentes et les recherches, une conjonction qui ne désire plus et s'approche du Tout primordial, ineffable. Le jeu du fin’amor aura attiré sur lui l’Union, la troisième Alliance.
La Dame des Tapisseries se passe d'être aimée pour incarner la femme divine. Elle y parvient par une initiation indiquée par le chemin des tapisseries. Sur Vue, à l’écart du lion, elle caresse la licorne, l'artéfact des âmes ouvre le reflet, ils basculent, s'élevant dans les miroitements de leurs âmes.
Souvenez-vous


Ce sera la quatrième rencontre. Les Tapisseries m’ont été cachées pendant pratiquement toute l’écriture de cet essai. Elles ont voyagé au musée des Abattoirs à Toulouse, presque en même temps que j’ai été en Ariège marcher sur les pas des cathares. C’était fantastique, il y aura eu du soleil pour le lac de Fontargente, de la pluie pour Montségur et de la neige pour l’estany de l’Isla. J’aurai été seul avec eux, j’aurai touché la pierre qu’ils ont eux aussi touchée, épuisés, franchissant les cimes des Pyrénées vers le val d’Incles. Tout ça pour dire que je n’ai pas revu les Tapisseries, j’étais ailleurs, je suivais un sillage qui se traçait à mesure que j’avançais. En fait, je les ai assez peu regardées en images, car seul l’effet de la tapisserie véritable est efficace. Je les connais à présent au-delà de la vue, au-delà de ce qu’elles montrent, je les connais en symboles. Qu’y a-t-il donc à attendre d’une nouvelle visite à Cluny ? Le destin fait que si tout va comme convenu j’aurai fini l’essai, il restera de la relecture, mais j’aurai fini. En fait, cette quatrième rencontre a déjà commencé. Comme me l’a dit un ami très cher quand je lui ai demandé s’il était convaincu par mon histoire autour des lapins, « si ça marchait », il m’a répondu que moi seul pourrais le savoir, « que ça viendrait de l’extérieur ». Je n’ai pas compris, je pensais que les nombres, le Mantic, l’Hymne, la fauconnerie et l’alchimie étaient l’extérieur, je lui ai fait préciser : « Tu verras si ça se confirme de l’extérieur, tu retourneras les voir, tu les utiliseras comme un tarot et tu verras si ça se vérifie, tu vas les interroger. » C’est fantastique, vraiment fantastique.
Déjà, elles m’accompagnent. D’abord le faucon, c’est le plus facile. Je reconnais mieux l’injustice, la menace, je suis moins victime, je me permets de me défendre, de m’emporter s’il le faut, je protège mon noyau, ma famille, mon équilibre. Pour que se fasse la rencontre, que s'opère ce moment merveilleux de la perruche et de la perle, du verbe et de l’âme, il faut que le faucon protège la roseraie, il faut un équilibre contre les adversités, car je ne suis pas un moine mystique dans son monastère, je suis un, en continuité, et seule une défense appropriée au temps de la menace m’offre la paix nécessaire au temps de l’enquête intérieure.
Il m’est arrivé une chose. C’était un rêve, sur un marché en Égypte, j’allais entre les étals des marchands, dans un immense dédale, comme la cité de Sarbūg de l’Hymne. Je cherchais des dattes. J’ai trouvé une boutique comme dans le dessin animé Aladin, avec un auvent en tissu maintenu par d’épaisses branches. J’ai sorti un billet grand comme un chèque du Millionnaire, il changeait chaque fois que je le regardais, c’était un billet froissé avec un sphinx qui se changeait en Delacroix, un gros billet qui valait beaucoup d’argent. Mais le marchand le refusait, personne ne me vendrait de dattes, il fallait qu’on me les offre, trois dattes, trois comme le nombre magique des contes de fées. Le lendemain, l'on m’offrit des dattes tout juste arrivées d’Algérie. Elles étaient dans une jolie boîte blanche avec en imprimés un nœud et un ruban rouge. J’en ai parlé à mes collègues, ça les a amusés, surtout le nombre trois. J’ai compris qu’il ne faut pas exposer les mystères, qu’ils perdent leur brillance à la lumière, qu’il ne faut pas profaner le fragile enclos sacré. Les dattes ont eu beaucoup de succès à la maison, surtout avec mon fils de cinq ans, ces dattes exquises, magiques, que je mangeais avec cérémonie, toujours par trois.
Les Tapisseries me permettent de tout regarder, l’ombre et la lumière, confiant que la voie royale est dans l’amour. Je couvre peu à peu le monde de symboles. En vacances dans le Jura, le faucon juché sur un panneau me protège. Au parc Monceau, la perruche cachée dans un arbre me rappelle le verbe divin. Je vois dans le reflet d’une perle tous les reflets de l’âme. Je ne regarde pas encore dans le miroir, je n’en suis pas arrivé là. Dans les moments d’égarement, de tristesse, de questionnement, j’ai ressenti de la mélancolie d’Ouïe, avec l’espoir de Désir et de Goût. Je n’ai pas connu l’illumination, mais ça m’a aidé, il y a eu de la contemplation, confiant dans l’idée de ressources inconscientes, que ça irait mieux, et ça a été mieux. J’ai su garder confiance en ces moments de détresse. J’ai repensé à la brillance d’une perle dans les profondeurs et j’ai écouté Catalina Vicens en boucle. Dans les brefs instants de grâce j’ai reconnu la fulgurance de Toucher et je vis désormais dans l’espoir de Vue, un jour, avec l’amour de ma vie, ma femme divine.
J’ai aussi partagé cet essai avec mon oncle, par courriers successifs, comme un feuilleton. Il m’a répondu, il m’a dit qu’il admirait mon enthousiasme, il m’a mis en garde sur certains aspects de la mystique, au sujet du quiétisme qui marqua la fin de la mystique alla francese. Il m’a encouragé à lire Gershom Scholem et Martin Buber qui m’aideraient. Surtout il m’a incité ainsi : « étudie, étudie : tu ne progresseras que si tu étudies et, si tu progresses, tu deviendras peu à peu toi-même comme, sans doute, tu le veux. » Déjà, les Tapisseries me récompensent de ces encouragements de la part de celui qui m’a accompagné depuis ce jour où il me dit : « tu es un mystique ». Que Dieu ait son âme.
Est-ce que tout ce qui précède, tout cet essai, reflète ma pensée et ma foi ? Il est bien difficile de répondre. Il est bien difficile de se connaître. Ce que je peux dire, sans aucun doute, c’est que les Tapisseries m’habitent. J’ai l’impression de leur prêter le miroir de mon âme pour qu’elles s’expriment à travers moi. Je me sens comme un pantin agité au bout de leurs fils. D’une façon oui, je dois bien y croire, car je dois être « d’accord avec elles », dans le sens d’instruments de musique qui jouent d’un même accord, pour que la mélodie sonne juste, qu’elle ait la pureté du réel, de l’authentique, sans intermédiaire. Il se peut aussi que ce soit les Tapisseries qui soient « d’accord avec moi », alors j'aurai été dans l'écueil du mystique, j'aurai été à l'écoute de l'écho de ma pensée. Ce que je fais à ma petite hauteur, d’autres, que j’ai découverts justement grâce à Gershom Scholem, l’ont fait à la plus haute des échelles, ce sont les kabbalistes, ces mystiques qui ont insufflé une vie nouvelle au Livre, aux lettres, aux symboles, aux clés cachées dans les lettres, dans les mots, dans le texte entier dans lequel est tissé Son nom véritable.
L’expérience mystique, ineffable, s’exprime par transposition, par relecture, par exégèse. C’est ainsi que la tradition se renouvelle, que le mystique vivifie l’expérience sacrée de la religion, franchissant plus ou moins la ligne de l’hérésie. Il y a dans l’exégèse un échange de signifiant et de signifié, de projection et de révélation. Certains supports sont plus propices que d’autres à l’exégèse mystique. Il faut qu’il y ait un échange, une rencontre, que le mystique révèle l’œuvre et que l’œuvre révèle le mystique. Les Tapisseries se sont imposées à moi et elles sont devenues mon langage. Pourquoi elles ? Car elles sont assurément porteuses de la Signature, comme la qualifie Jacob de Boehme [50] « Toute parole, tout écrit et tout enseignement sur Dieu est sans valeur si la connaissance de la signature n’y est point renfermée. »
Épilogue : Quand enfin...
Ça y est, à nouveau après une nuit de travail, j’y suis retourné, à l’instant. Je serai resté deux heures avec elles, prenant les notes qui suivent, d’abord remises en forme sur mon téléphone, dans le jardin de la Tour-Saint-Jacques, vers la plaque de Nerval, puis dans mes nombreuses relectures de l’essai, dans le métro, au café ou le soir quand la maison s’endort, des moments volés, dans un sentiment permanent d’urgence.
« Les Tapisseries me remercient par leur beauté. Je m’aperçois qu’elles sont en relief, dans une épaisseur du tissage sur les crinières ou les pétales de roses. Elles sont riches, raffinées, luxueuses, les visages de trois quarts ont les proportions justes et ce qu’il faut d’ombre pour les détacher. Malgré les siècles, il demeure l’éclat brillant des broderies, de l’or et des pierres. Elles sont impressionnantes, autour de moi, dans le grand cube d’ombre qui nous extrait du temps.
Et je vois, moi seul parmi la myriade de visiteurs, je vois le fruit de deux années d’étude. Elles me disent doucement leur secret à l’oreille, dans un chuchotement de l’autre monde. Je me sens unique, moi, leur véritable gardien. Autour, ça parle, ça passe, ça change. Il aurait été drôle de filmer la scène et de me voir en vitesse accélérée, presque immobile, dans le flot des gens. Je les écoute. Quelle érudition ! C’est chaque fois la même scène, l’homme se gausse et bien fort il dit à « sa » femme, désignant un à un les cinq sens en les montrant du doigt « là c’est le goût, là c’est… et là c’est le sixième sens, le sens du cœur, c’est une énigme, « Mon seul désir » avec le A et le I ». Ça aura été incroyable, la même scène encore et encore avec en guise de fin l’expression tonitruante : « énigmatique ! », qui laisse entendre qu’il en sait un peu plus, mais que certainement elle ne comprendrait pas, que lui, il l’a lu, le dépliant. Et ça y est, on y va, passez c’est fini. Les femmes, elles, disent : « elles sont magnifiques !» Oh, merci mesdames. Je garderai cette sensation magnétique d’avoir été au milieu des Tapisseries, des six dames, et d’avoir été le seul, l’unique, à avoir su les regarder. Oui, je dois être un vantard insupportable. Mais c’est la vérité, c’est ce que j’ai senti. Et si j’avais voulu dire, si quelqu’un m’avait demandé ce que je pouvais bien regarder, planté là dans la contemplation, qu’aurais-je bien pu lui répondre ? Je n’aurais certainement pas su partager ce que je sais, partager en quelques paroles la nature complète de ma vision, l’état où je suis parvenu à l’issue d’une longue initiation.
Toucher, mon Dieu qu'elle est belle, la dame de Toucher ! Mon seul désir.
Odorat, merci à la guide scolaire qui m'a appris qu'il était de tradition que la jeune fille fasse don à son amoureux de cette couronne qu’elle est en train de tresser, confirmant l'idée d'une noce. Je brûlais cependant de lui poser une question : « pourquoi dit-on des Tapisseries qu’elles sont médiévales, puisque tout mène à penser qu’elles sont au plus tôt de 1500 ? » J’observe le contraste entre l'assiette de fleurs que la servante, l’air revêche, tient sous son coude, et le ciboire de Goût (les deux tapisseries sont placées juste à côté), que la servante tient par en dessous, agenouillée, véritable enfant de chœur, enfant du cœur, enfant de l’âme, admirative de sa dame.
Ouïe, six lapins, trois en haut qui gambadent, trois en bas menacés par le renard, le lévrier et le lionceau. Trois et trois, comme les deux triangles du sceau de Salomon, dans l’épreuve du Six, le bas est séparé du haut, la créature est séparée du Créateur. La nappe sous l’orgue, en tapisserie, nous plonge en abîme, nous fait pénétrer la scène, elle nous fait partager l’épreuve.
Désir, des cordes maintiennent la tente de « Mon seul désir », elle est en déséquilibre, seule elle s’effondrerait, elle est contrainte. Bien qu’il soit enchaîné, le faucon veut fondre sur l’oie et l’oie, elle, est prête à le recevoir. L’on ne peut véritablement contraindre sa nature. Les lévriers ont des colliers, le bichon domestique n’en a pas besoin. C’est le lion et la licorne qui tiennent le rideau de la tente ouvert. La dame dépose ses bijoux, mais elle ne peut s’empêcher de garder quelques pierres précieuses sur ses bracelets, sa ceinture et son collier. Elle a juste relevé les bracelets de l’asservissement, elle ne s’est pas véritablement affranchie. Les bijoux qu’elle dépose au coffre ont des perles noires, fruits de l’œuvre au noir dont elle se débarrasse. Elle purifie son âme. Le lion rugit, sous couvert de spiritualité, c’est le triomphe de la raison.
Goût, je ne m’étais presque pas intéressé à elle, pourtant elle est là, centrale, juste à côté de la dame, en miroir de la perruche, la jeune licorne de notre renaissance initiatique. Je m’aperçois de la multitude de perles dans le ciboire, comme les millions d’âmes qui attendent d’être révélées. Les capes du lion et de la licorne sont chacune tenues par une trinité de pierres, même trinité de pierres que sur le pendentif de la dame. Le relief des roses est extraordinaire. Je regarde, je me balance, je souris, je suis perplexe, je m’exclame, comme devant un film. Le faucon fixe la pie de son œil prédateur, il fond littéralement sur elle, suspendue, immobile, la vilaine pie, le faucon est d’une force démesurée, prince du ciel, elle n’a d’autre espoir que de fuir, elle n’a pas compris, il est trop tard.
Vue, il y a cinq arbres, deux chênes côté lion et trois arbres à fruits rouges côté licorne. Sur Désir les cordes sont tendues entre le pain du côté du lion et l’arbre aux fruits rouges du côté de la licorne. En fait, il y a toujours plus de quatre arbres… J’abandonne définitivement la piste des arbres. La tapisserie semble continuer en dessous, trois têtes dépassent : le renard, le singe et le héron. En fait non, les six tapisseries sont aux mêmes dimensions, les bêtes sont littéralement décapitées. Dans un coin, sous couvert d’une patte devant son museau, le lapin révèle son secret au lévrier. Je me souviens que Jacqueline Kelen avait noté ces détails dans ses Floraisons intérieures. Le lion et la licorne sont nus et la dame porte une unique pierre rouge à son cou, fenêtre sur l’Un. La jeune licorne de Goût, celle de notre renaissance initiatique, a disparu, alors peut-être que cette licorne c’est nous, ou plutôt c’est nous, cette licorne de l’autre côté du miroir. Je suis saisi par l’intensité de la liturgie qui émane de ce petit espace au centre, constitué de trois regards, la dame, la licorne et son reflet. Pour pénétrer la scène il faut regarder derrière l’image, même arrêter de regarder, laisser voir, comme le fait la dame, l’œil mi-clos sur notre monde, mi-ouvert sur l’autre, celui du crépuscule, de l’entre-deux fragile où paraît la révélation à la brisure bleue du verre. Elle nous accompagne, elle est présente, tout à fait présente et elle nous conduit après la plus haute marche, elle nous saisit par le regard comme elle saisit la licorne par la crinière. Quelle intensité surnaturelle il y a dans cet échange de regards qui se poursuit de la dame, à la licorne, à son reflet. Elle, l’œil mi-clos, lui (un unicorne…) l’œil grand ouvert sur le mystère. Il y a déjà un bel équilibre au centre de Goût, entre la dame, la perruche et le voile ; mais celui-ci me saisit plus encore, il a quelque chose de magique. Rien ne vient le perturber, il n’y a rien qui vive autour, à l’abri d’un triangle plus large, délimité par l’île à la base et les dos du lion et de la licorne sur les côtés. Et au plein centre de cet enclos, un autre triangle, plus calme, plus plat, celui des trois regards et au centre de celui-ci, c’est le pendentif, la pierre unique de l’Un. Désormais je laisse la pierre capter l’entièreté de mon regard et je m'imprègne de l'œil mi-clos de la dame pour voir la tapisserie sans la regarder, par les côtés, par la brisure. Sereine, la dame est assise, la licorne sur les genoux, licorne qui, tel Osiris, est l’enfant, l’amant, et le divin. Pour voir cette trinité centrée sur l’Un, j’ai dû me mettre à distance, à la place de la dame de Toucher, la première, celle qui comme elle touche la licorne, l’initiatrice se mêle à la profane, il n’y a qu’une seule vérité.
J’ai recompté les lapins, quel soulagement, deux, quatre, six, sept, dix, onze. Je m’aperçois que je les connais littéralement par cœur, par le cœur, ces tapisseries, et que c’est à mon cœur qu’elles parlent. C’est génial, c’est l’œuvre d’un génie. L’enquête n’est pas finie. Je reviendrai, c’est certain, je n’en ai pas vu assez, je ne suis pas entré assez dans le baptême de Goût et dans l’au-delà de Vue.
Et voilà qu’à ma stupeur je tombe dans la boutique du musée sur La Dame à la Licorne et le Beau Chevalier, « un chef-d’œuvre inédit de la littérature amoureuse » datant de 1349 et tout récemment traduit du français ancien. Je me rappelle que, sur un balcon à une soirée, je venais de révéler mes théories sur les Tapisseries et pour seule réponse on m’avait demandé si je l’avais lu, ce livre qui venait de sortir. Quel piètre expert des Tapisseries je faisais. En fait, oui, bel et bien résolu à ce que rien ne pénètre ma vision, je n’ai pas cherché à suivre une quelconque actualité les concernant. Il doit y avoir bien des clés dans ce livre, antérieur de presque deux siècles aux Tapisseries. Et tant pis, ce livre doit parler d’autres tapisseries, elles ne peuvent pas parler de mes tapisseries.
Post-scriptum :
Après une première visite ce matin pour prendre des photos, j’ai été manger quelque chose dans le petit jardin à droite du musée, sur les marches devant la porte. Je commence maintenant à écrire, parvenu de l'autre côté, dans la cour, où je prends un café. Je tape les présentes notes sur mon téléphone, je continuerai dans la salle des Tapisseries. Le nez dans mon écran, il se passe tant de choses.
Il faut les regarder longtemps, il faut les laisser infuser, imprégner, pour peu à peu penser comme elles, penser avec elles et remonter à la pensée, l'intention, le secret de leur créateur et avec de la chance, si elles le veulent ce jour-là, ne pas rester dehors, de l'autre côté, et pénétrer dans l'envie de Toucher, la calme résolution d'Odorat, la mélancolie d'Ouïe, le contrôle de Désir, la douce harmonie de Goût, et l'indicible dépassement de Vue. Il y aura du goût, une chose se passera là sur la langue, une sorte de soif impatiente. Il y aura de la vue, le regard écarquillé, grand ouvert sur chacune des tapisseries, sur Vue surtout, bien sûr, le triangle centré sur la pierre rouge au cou de la dame, la vision de l'au-delà de la tapisserie, de l'au-delà du miroir, tout autour de cet œil qui nous absorbe et nous laisse voir le reste comme un ailleurs.
Sortant de Cluny une perruche m'accueille, rayant le ciel, son chant monte haut dans le marronnier, avec d'autres perruches qui vont et viennent du square Samuel Paty au Collège de France. Des perruches qui tapissent Paris, la couvrent du miracle du verbe et chaque fois me rappellent de leur cri ma mission, le miracle de la perle de Goût, cet essai à écrire, et mon devoir profond, me trouver, révéler mon âme. Le saurai-je seulement que je l'aurai trouvée ? Je me sais en tout cas sur le chemin, celui qui se dessine, qui me conduit par ses échos, et lorsque je suis en plein accord, en pleine résonance avec lui, je retourne voir les dames avec l'espoir d'une émotion neuve, d'une révélation, et chaque fois elles m'accueillent, elles m'attendent.
Pour voir Toucher il faut être devant, le plus loin possible devant pour rejoindre sa taille, être comme elle pour pénétrer la scène. Le lion est laissé dans l'ombre, le regard rond. La licorne et la dame sont dans la lumière, dans la pleine blancheur et encadrent, découpé sur le mille fleurs, le long noir de la robe, comme une ouverture sur la nuit, qui coule tel une rivière parcourue d’une myriade de plis clairs comme des vagues brisant les reflets. Le noir et l'or appellent la lumière, l'étoile et la Lune, la dame et la Déesse, Diane Artémis, son diadème appelant l'Orient et l'envie de percer l'énigme de la nuit.
Regardons Odorat depuis l'entrée de la pièce, par la gauche, du côté de l'accompagnante. Le lion, la dame, la licorne, les animaux et les oiseaux, tous ont l'air bien sages, tout est droit, horizontal comme l'héraldique sur l'écusson du lion, ou vertical comme le héron, apprêtés pour la noce. La dame tresse patiemment la couronne et tout le monde l'attend, elle est le centre de l'attention, elle est la future mariée, et elle garde le regard baissé sur son ouvrage, sous son voile, avec un fin sourire, certainement, la tapisserie sur son visage est effacée, justement, elle est effacée, elle acquiert les mains d'argent, elle s'efface dans mille conventions, mille repères du quaternaire. L’accompagnante aussi la regarde, cynique, altière, tenant le plat de fleurs sous son coude dans une posture désinvolte, de sa distance elle discerne l'artifice, le périssable dans la promesse du perpétuel, elle traite avec mépris ces fleurs dont elle sait que fatalement elles faneront et que la dame souffrira.
Placez-vous à droite d’Ouïe et imaginez l'accompagnante dans sa réalité physique, corporelle, agissante et désirante, la chaleur, la moiteur, les froissements, ses soupirs et la puissante licorne, ivre de désir. La dame derrière son instrument est témoin des ébats, le soufflet anime les notes, il fait vibrer les tubes de l’orgue, et de ses doigts elle module, elle transforme ce souffle de souffrance, de jalousie, d’envie inassouvie, les tubes vibrent et la dame s'oublie dans la mélancolie, bercée par sa musique, elle s'écoute et se laisse porter, la mélodie reflète de plus en plus son état d'âme, elle se découvre, elle se parle à elle-même, elle oublie qu'elle joue, elle lâche prise, et les ébats continuent sur fond d'orgue médiéval.
Désir mérite seulement qu'on s'assoie confortablement sur le banc matelassé du musée, comme le bichon sur son coussin, elle ne mérite pas que nous nous fatiguions les jambes, debout devant elle. Il faut partager le regard du bichon, son ambiance, voir la facilité, la docilité de cet abandon des richesses, cet air un peu niais qu'a la dame, l'air de bonne élève qui se satisfait de quelques félicitations. La tente est la promesse d'un sombre ennui. La dame copiera au mieux les prières et les actes de piété. Elle espère qu'on l'admire, elle, la bonne élève en classe de prières, elle vit dans le regard de la jeune accompagnante et aujourd'hui elle est bel et bien canonisée dans le regard du visiteur.
Pour regarder Goût il faut être là juste devant, agenouillé à ses pieds, dans le reflet doré de sa robe, la voir grandir haut au-dessus de nous, voir la licorne ruer, entendre le lion rugir, être subjugué par le luxe et la gloire. La jeune licorne se fond inévitablement dans la tapisserie, elle ne s'accroche pas à mon regard, elle m'évite, insaisissable, elle me laisse glisser vers le visage de la dame, son sourire, le vent soulevant le voile, je continue vers la perruche, vers la perle et je vois la perruche l'approcher de plus en plus près de son bec, elle se voit, certainement elle voit son reflet dans le petit monde au centre de la perle. La licorne qui regarde à côté nous invite à poursuivre notre chemin, à ne pas en rester là, dans le confort de l'harmonie, à ne pas oublier ma mission, mon entente qui vient de m'être révélée, elle me guide telle la lumière de la perle, à remonter par Sarbūg, éviter Babel et basculer dans mon reflet à la surface du ciel, dans mon jumeau, le plus zélé des donateurs au service du Père, le Roi qui me conduira à la porte du Roi des Rois, qui s’ouvrira par l'artéfact de mon âme.
Où me placer pour regarder Vue ? Vraiment je l'ignore, elle me demande des efforts, bien des efforts avant de m'inviter à elle. D'où voir au mieux ce qui nous invite à l'invisible ? Je me mets près du lion, il ne semble pas malheureux. Je me sens comme le lévrier qui regarde, assis sur le côté. Au-dessus les lapins sont réconciliés avec leurs prédateurs, le lionceau veut jouer, le renard veut faire la course, un lapin révèle son secret au lévrier, un autre lapin attend la belette. Revenant subitement au centre je m'aperçois que la robe sur le torse de la dame est d'or brodé de vert aux reflets altérés et pour la première fois je vois que par endroits la robe est rouge, sans brodure, avec des reflets d'or, comme si la robe s'effaçait, laissant apparaître l’herbe rouge du mille fleurs. Sur Odorat, c’est le regard de la dame qui s’effaçait, ici le regard domine, mi-clos, intensifié par la pierre rouge en pendentif, et c'est le corps qui s'efface, la dame et la licorne quittent notre monde, elles nous oublient, elles nous laissent loin, très loin derrière elles. À moins que nous rejoignions la scène par le reflet, nous voyons la licorne c'est qu'elle nous regarde, nous remontons dans l'œil de son image, puis à l'œil de la licorne, sous l'œil de la dame, nous remontons, ils nous invitent à basculer avec eux, la distance, les siècles écoulés, le musée, la visite, les guides ne sont rien, il n'y a que nous dans la danse vers l'Éternel.
J'aimerais parler avec tous ces gens, tous ces visiteurs, répondre à leurs remarques, partager mes visions, devenir l'inséparable guide, le gardien véritable des Tapisseries. Il y a tant de lectures. Un après-midi, je ne pus m'empêcher de surprendre une conversation, une dame expliquait à sa fille qu’elle avait pour habitude de venir ici quand elle était étudiante à la Sorbonne, elle venait à l’heure du déjeuner et elle s'asseyait là, devant Désir et elle s'interrogeait, la tapisserie était son guide, « Mon seul désir » était la clé de ses ambitions de psychanalyste : aider ses patients à connaître leur véritable désir. Une interprétation nouvelle. Il y a tant à dire, il faudrait un véritable livre d'or des Tapisseries, gardant mémoire de chacune de ces tapisseries intimes.
Sur une nouvelle rencontre


Bibliographie
1. Alain Erlande-Brandeburg. La dame à la licorne. Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1989
2. Élisabeth Taburet-Delahaye et Béatrice de Chancel-Bardelot. La dame à la licorne. Éditions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, 2018
3. Jacqueline Kelen. Les floraisons intérieure, Méditations sur la Dame à la Licorne. La Table Ronde, 2015
4. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Collection Bouquins, 1997
5. Jean-Patrice Taburet-Delahaye. La Dame à la licorne. Le pérégrinateur éditions, L’esprit curieux, 2018
6.Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 0082/023
7. Farid Uddin Attar. Mantic Uttaïr ou Le langage des oiseaux, Poème de philosophie religieuse. Edité et traduit du persan par M. Garcin de Tassy. Benjamin Duprat, Imprimerie impériale, Paris, 1863
8. Émile Littré. Dictionnaire de la Langue Française. Librairie de L. Hachette et Cie, 1863
9. Jacques-Étienne Ménard. Le « Chant de la Perle ». In: Revue des Sciences Religieuses, tome 42, fascicule 4, 1968. pp. 289-325
10. Henri Rey-Flaud, Le sang sur la neige : analyse d’une image-écran de Chrétien de Troyes. In : Littérature, n° 37, 1980. Le détail et son inconscient. pp. 15-24
11. Jean-Paul Roux. Le sang : Mythes, symboles et réalités. Fayard, 1988
12. Buffon. Histoire Naturelle (Oiseaux, Tome 1). Imprimerie Royale de Paris, 1770)
13. Corinne Beck et Elisabeth Rémy. Le faucon. Favori des princes. Découvertes Gallimard, 1990
14. Luis Racionero. Le troubadour alchimiste. Mazarine, 2007
15. Anne-Marie Cadot-Colin. Perceval ou le conte du Graal. Livre de poche jeunesse, 2014
16. Alexander Roob. Alchimie et mystique. Taschen, 1997
17. Andrea Aromatico. Alchimie le grand secret. Découvertes Gallimard, 1996
18. Lambsprinck. De Lapide philosophico. 1625
19. Eugène Canseliet. Alchimie. Etudes diverses de Symbolisme hermétique et de pratique Philosophale. Jean-Jacques Pauvert Éditeur, 1964
20. Souchal Geneviève. Messeigneurs Les Vistes et la Dame à la Licorne. Bibliothèque de l’école des chartes. 1983, tome 141, livraison 2. pp. 209-267
21. de Vaivre Jean-Bernard. Autour de la Dame à la licorne et d’autres tentures I. Antoine II Le Viste, ses parents et alliés. In : Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot, tome 93, 2014. pp. 65-128
22. René de Maulde La Clavière. Jean Perréal dit Jean de Paris : sa vie et son œuvre, Volume 2. In :Gazette des Beaux-arts, 1895
23. Charles Sterling. Une peinture certaine de Perréal enfin retrouvée. In : L’Œil, n° 103-104, 1963, pp. 2-15 et 64-65
24. Carl Gustav Jung. Adaptation, individuation et collectivité. Buchet Chastel Éditeurs, 1971
25. Aimé Agnel, ouvrage collectif. Le vocabulaire de Jung. Ellipses, 2011
26. Marie Louise Von Franz. La femme dans les contes de fées. Traduction de Francine Saint René Taillandier, Albin Michel, Espaces libres, Spiritualités vivantes, 1993
27. Marie-Louise Von Franz. 1977. L’individuation dans les contes de fées. La Fontaine de Pierre, 2016
28. Hélène Bernier. La Fille aux mains coupées (conte-type 706). In : Les archives de Folklore, tome 12, Les presses de l'Université Laval, 1971
29. Les Frères Grimm. Contes pour les enfants et la maison Collectés par Les Frères Grimm. Edité et traduit par Natacha Rimasson, Éditions José Corti, 2009
30. Rafik Djoumi. Matrix Trilogy. Rocky Rama Hors-série 5. 2020
31. El-Shamy, H. The Falcon's Daughter. in: Folktales Told Around the World. R.M. Dorson (General Editor) Chicago, 1975, pp. 159-163
32. Marie-France Boyer. La Vierge - Culte et image. Thames & Hudson Editions, 2000
33. Bertrand Matot. Paris occulte - Alchimistes de l’ombre, spirites inspirés, mages sulfureux, traqueurs de fantômes et astrologues visionnaires. Parigramme, 2018
34. Dom Antoine-Joseph Pernetty. Les Fables égyptiennes et grecques dévoilées et réduites au même principe : avec une explication des hiéroglyphes, et de la guerre de Troye, Tome premier. Chez Bauche - Libraire, 1758
35. P Roussel. Un nouvel hymne à Isis. In: Revue des Études Grecques, tome 42, fascicule 195-196, Avril-juin 1929. pp. 137-168
36. Pierre Gordon. Les Vierges Noires, L'origine et le sens des contes de fées, Mélusine. Editions Signatura. 2003
37. François Pomerol. Origines du culte des « Vierges Noires ». In : Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, Série V, Tome 2, 1901, pp. 83-88
38. Jean-Nicolas Déal. Dissertations sur les Parisii ou Parisiens et sur le culte d’Isis chez les Gaulois. Firmin Didot Père et Fils - Éditeurs, 1826
39. Dom Jacques Bouillart. Histoire de l’abbaye royale de Saint Germain des Prez. Grégoire Dupuis - Éditeur, 1724
40. François Noël. Dictionnaire Historique des Personnages célèbres de l’Antiquité, Princes, Généraux, Philosophes, Poètes, Artistes, etc; des Dieux, Héros de la Fable, des Villes, Fleuves, etc; avec l’Étymologie et la valeur aux termes Bérécynthe et Isis. Le Normant Père - Libraire, 1806
41. Pierre Gordon. La magie dans l’agriculture - Origine et sens des rites agraires. Signatura, 2009
42. Pierre Gordon. La nuit des noces. Dervy, 1950
43. Pierre Bersuire. Reductorium morale. entre 1342 et 1350
44. Walter Map. Henno cum dentibus dans De nugis curialium (Contes pour les gens de cour). XIIème siècle
45. Papus. Le tarot des bohémiens, le plus ancien livre du monde. Hector et Henri Durville - Editeurs, 1911
46. Jean Markale. L'amour courtois ou Le couple infernal. Imago, 1988
47. Larousse de la Langue française. Éditions Larousse, 1992
48. Gérard Zuchetto et Jörn Gruber. Le livre d’or des troubadours. Les éditions de Paris, 1998
49. Marguerite Porète. Le miroir des âmes simples et anéanties. Édité et traduit du français ancien par Max Huot. Albin Michel, Espaces libres, Spiritualités vivantes, 2021
50. Jacob de Boehme. De signatura rerum. 1622
web1. : Arerien : https://www.aerien.ch/articles/1354/Dresser_ou_Apprivoiser_une_Perruche.php
web3.: L'oiseau de vérité : www.aequitaz.org
web4. Le chat noir : https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_populaires_de_Basse-Bretagne/Le_Chat_Noir
Sources des images :
les illustrations des tapisseries sont des photographies prises par l'auteur, diffusées avec l'autorisation du musée de Cluny
les cartes du tarot Perino sont reproduites avec l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur
cliquez sur les légendes
Licence :
6 tapisseries © 2024 de Aowashi Suzuki, notamment son contenu texte, est mis à disposition selon les termes de la licence Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (fr : Attribution / Pas d'Utilisation Commerciale / Pas de Modification)